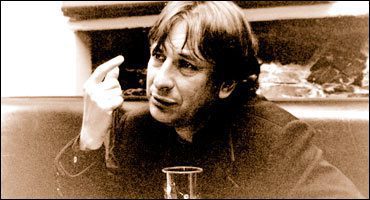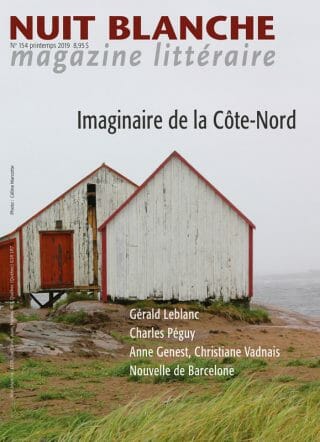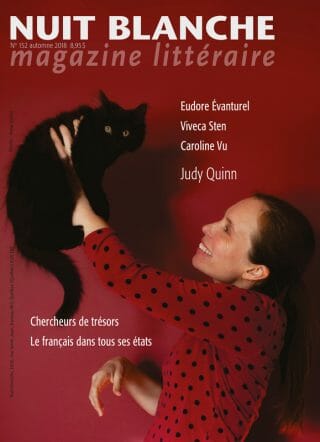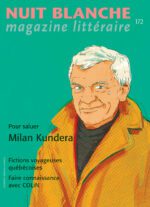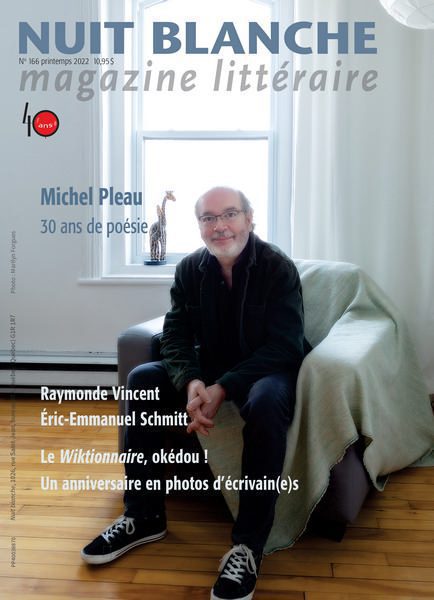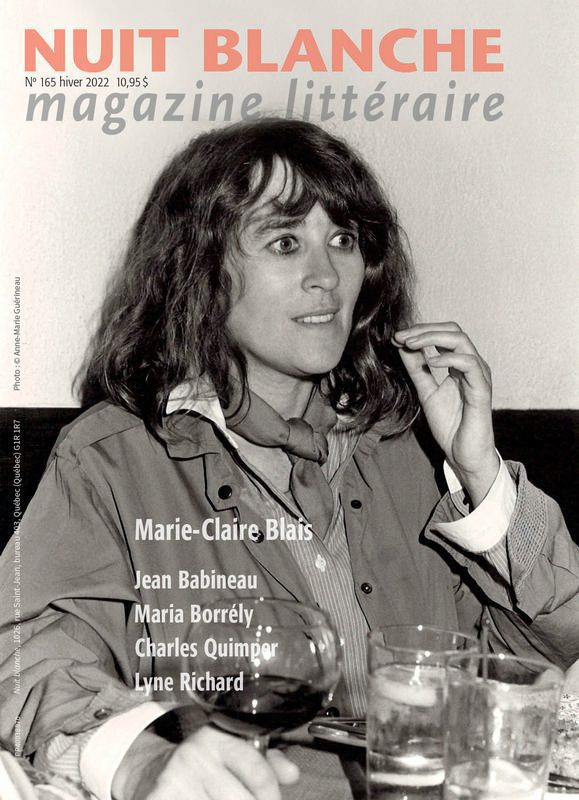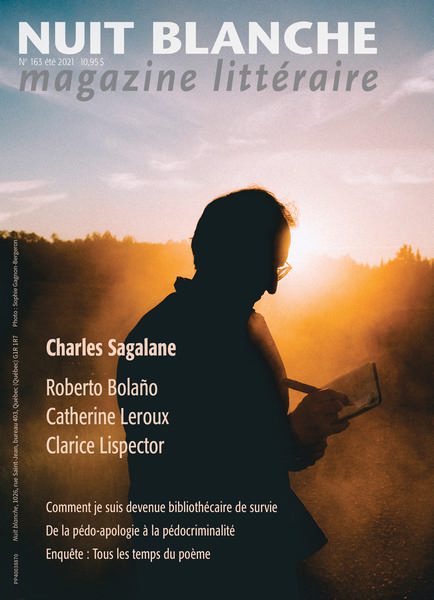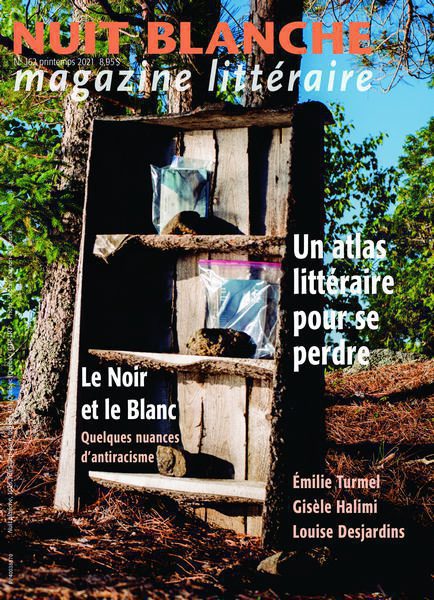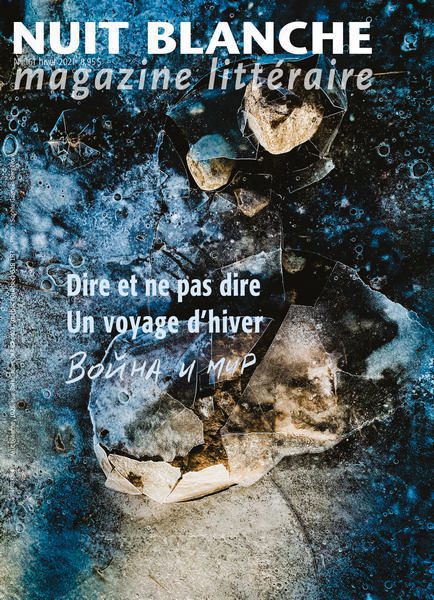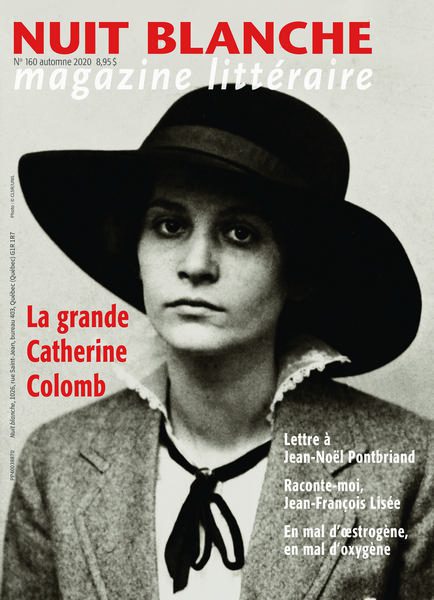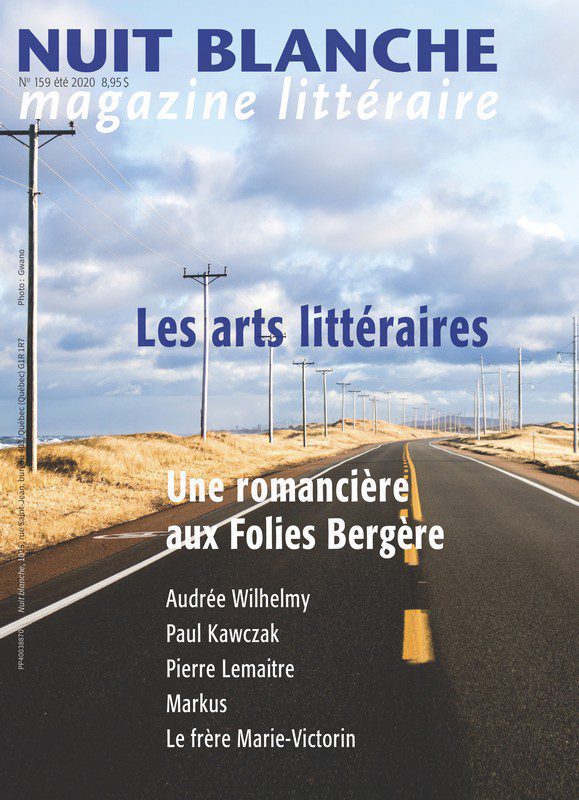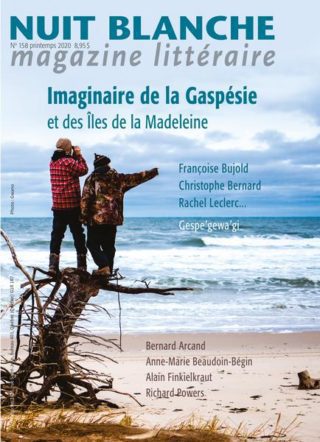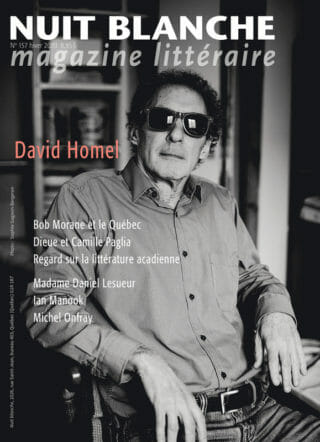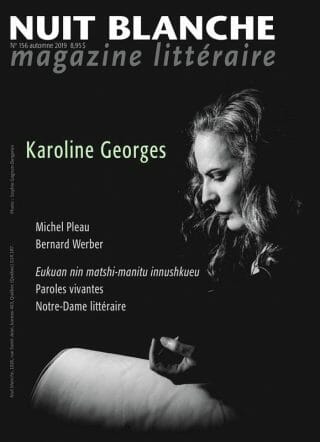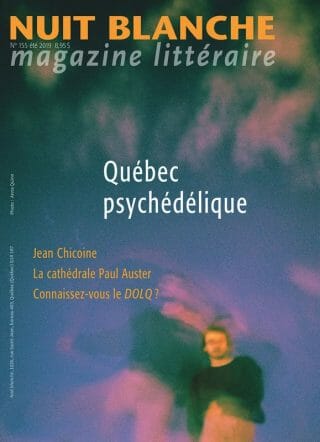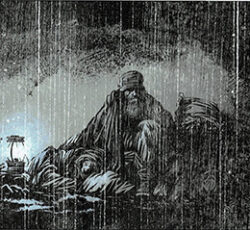Depuis Les champs d’honneur (Prix Goncourt 1990), les romans de Jean Rouaud sont autant de pierres d’un même édifice : la reconstruction imaginaire des origines familiales du narrateur (qui, dans un magistral pied de nez aux théories issues du structuralisme, se donne d’emblée comme l’auteur).
D’un récit à l’autre en effet, les événements sont dépliés sous des éclairages qui montrent la complexité et la subtilité des résonances que les souvenirs ont acquises. Dès lors, cet itinéraire en spirale éclipse la question de la véracité desdits événements, tant il est vrai que la Vérité de chacun – le sens qu’ont pris pour un individu les événements qui jalonnent son histoire – ne saurait être objective. Il suffit d’ailleurs pour s’en convaincre d’évoquer des souvenirs d’enfance avec ses frères et sœurs. Si l’on s’accorde en général assez facilement sur un canevas commun, il y a de ces détails « objectivement insignifiants » – la couleur d’un tricycle par exemple – qui sont de véritables boîtes de Pandore et peuvent déclencher le plus amer des débats.
Avec un grand V
La Vérité de chacun est donc, au sens fort du terme, matière à roman. Et l’on sait que c’est au-delà de l’anecdotique et du factuel que le roman est vrai, qu’il n’est vrai qu’en tant que regard ou point de vue sur les choses. Cela n’a rien de limitatif, c’est au contraire en reconnaître toute la portée. Du coup l’important n’est donc pas tant de raconter sa vie, puisque, en pratique, chacun porte en lui un roman en puissance (le roman de ses origines, justement) ; l’important est d’organiser cette matière pour qu’elle produise du sens. Cela consiste à lui donner une forme à la fois neuve et souple, une forme qui permettra à chaque lecteur de reconnaître une part de ses doutes et de ses hésitations d’être humain tout en laissant à son imaginaire l’espace pour trouver ses propres réponses.
Le narrateur de Sur la scène comme au ciel problématise cette question de la Vérité par le biais de la figure de sa mère, décédée depuis peu d’années. Car c’est bien parce qu’elle est morte que le narrateur s’autorise à écrire sur elle. La mince mais pourtant solide silhouette s’était préalablement immiscée dans Pour vos cadeaux (1998), mais dans l’œuvre de Jean Rouaud avait surtout dominé jusque-là l’imposante stature du père, dont l’ombre avait d’autant plus de portée qu’il était disparu tôt dans la vie du narrateur, un lendemain de Noël. Par la magie de la narration, celle qui était toujours vivante quand les trois premiers romans ont paru (1990-1996) commente maintenant au fur et à mesure le récit de son fils, qui la surprend à bien des égards. Elle se demande par exemple pourquoi son fils a raconté certains événements de telle façon, exagérant parfois les faits ou révélant des secrets de famille dont l’origine n’est même pas certaine. « Où veut-il en venir ? » (p. 12). « Et d’abord, qu’est-ce qu’il en sait ? » (p. 29). En effet, pourquoi a-t-il travesti certains détails, mélangé des dates et des lieux, accordé autant d’importance à une anecdote dont la réalité lui semble, à elle1, douteuse. Elle n’est d’ailleurs pas le seul témoin « objectif » des exagérations ou omissions de son fils : les amis et les contemporains, ceux qui ont vraiment connu ce père souvent absent, qui reste selon eux, pour l’enfant que le narrateur a été, un inconnu, ceux-là se demandent bien pourquoi l’écrivain n’a pas eu recours à leurs souvenirs bien concrets, qu’ils auraient été si heureux de partager…
L’imaginaire à la rescousse
Si la question indirecte est naïve, il n’est cependant pas simple d’y répondre à l’intérieur même de la forme romanesque, c’est-à-dire de façon esthétique. C’est pourtant ce que fait le romancier, de façon aussi efficace que subtile, dans une courte phrase qui tranche avec les longues périodes qui lui sont habituelles : « Celui qu’ils ont connu tiendrait tout entier dans un magnétophone. Pas votre père » (p. 156), répond simplement le narrateur. Dans ce votre que j’ai souligné, tient une part du génie littéraire de Jean Rouaud : il interpelle le lecteur directement au moment où il révèle en quelque sorte de façon intime ce qui le pousse à écrire (et ramène le père à l’avant-scène alors même que le récit était au départ consacré à la mère). Ce père qu’il a à peine connu, il en déplore d’autant plus la perte qu’il est mort juste après lui avoir dit qu’il faudrait qu’ils aient une bonne conversation ensemble. Cet entretien qui n’a jamais eu lieu entre le père et le fils au bord de l’adolescence, quel secret aurait-il révélé au narrateur qui lui aurait permis de mieux vivre ? Aucun sans doute, mais l’essentiel n’est pas là, évidemment. Si, comme nous l’enseigne la psychanalyse, toute individualité se structure autour d’un manque, d’un vide à combler, il est bien évident que la vérité historique de la mort du père donne forme et prétexte à ce vide, un vide qui ne saurait être comblé, pour qui que ce soit, par autre chose que de l’imaginaire.
Ce que je voulais également souligner, c’est que par la facture du texte, l’auteur donne concrètement à un sentiment des plus intimes une portée quasi-universelle. Chacun peut en effet sentir, comme Jean-Jacques2, que l’authenticité de l’anecdote historique ne fait pas le poids devant ce que l’on a éprouvé. On peut errer sur les détails, qu’importe si l’émotion est véritable ? Et mettre le lecteur, comme le fait Jean Rouaud, dans la situation de comprendre au sens étymologique de « prendre avec soi » ce que le narrateur exprime, c’est rendre caduque la question de l’authenticité anecdotique, au profit d’une authenticité beaucoup plus intéressante : celle d’un individu. Cet individu souligne d’ailleurs non sans humour, quelques lignes plus loin, qu’il n’est pas dupe de la rhétorique romanesque dont il manipule avec d’autant plus de brio les ficelles : « Je suis celui-là qui ne se lève pas toujours de son siège pour vérifier dans un ouvrage de la bibliothèque, située à peine plus loin qu’une longueur de bras, la justesse d’une information, préférant livrer un état défectueux de sa mémoire et se laisser porter par le hasard des rencontres, des confidences, des trouvailles, essayant de se persuader que l’imagination, qui comble les blancs souvent avec finesse, fera le reste » (p. 157). En faisant la part belle à l’imagination, Jean Rouaud affirme, au-delà de la question autobiographique que le propos de ses récits soulève, qu’il est avant tout… romancier.
Avec Sur la scène comme au ciel, ce romancier clôt un cycle, une manière de « temps retrouvé », et nous promet du coup que ses prochains romans aborderont une autre thématique. Gageons que s’il ne perd rien de son style aux phrases amples et rythmées et pourquoi le perdrait-il ? nous retrouverons bien quand même l’univers avec lequel nous sommes familiers, puisque, j’y insiste, ce ne sont pas tant les événements racontés que la manière qui font un romancier.
1. Mais n’oublions pas que le narrateur manipule toutes les ficelles de ce dialogue décalé.
2. « [S]’il m’est arrivé d’employer quelque ornement indifférent, ce n’a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire ; j’ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l’être, jamais ce que je savais être faux. » Jean-Jacques Rousseau, Les confessions, Livre I, Garnier-Flammarion, Paris.
Jean Rouaud a publié, aux éditions de Minuit :
Les champs d’honneur, roman, 1990 ; Des hommes illustres, roman, 1993 ; Le monde à peu près, roman, 1996 ; Les très riches heures, pièce de théâtre, 1997 ; Pour vos cadeaux, roman, 1998 ; Sur la scène comme au ciel, roman, 1999.