Depuis la parution de Clinique, Roseline Lambert trace sa voie, entre poésie et anthropologie. Alors qu’elle fait paraître son troisième livre, Lac noir, rencontre avec une figure des plus singulières de la poésie contemporaine.
Valérie Forgues : Tu te présentes comme poète anthropologue et non comme poète ET anthropologue ; nuance importante, comme si ces deux aspects de ta pratique étaient indissociables. Comment ces deux facettes se nourrissent-elles l’une l’autre ?
Roseline Lambert : Oui, c’est important pour moi d’écrire que je suis poète anthropologue. En faisant un doctorat en anthropologie de la poésie, je suis devenue fascinée par le geste d’écrire de la poésie, dans ce qu’il comporte d’universel, puisque la poésie se retrouve dans presque toutes les cultures du monde sous différentes formes. Ce qui m’a frappée et que je n’avais jamais réussi à cerner avant, même si j’écris depuis que je suis enfant, c’est la dimension mantique de la poésie, c’est-à-dire une résonance, que l’on pourrait dire vibratoire, par exemple dans la voix du poète, ou, selon nos penchants et croyances, qu’on peut reconnaître comme étant un acte magique ou surnaturel. Dans notre rationalité blanche occidentale, nous avons tendance à évacuer cette dimension de la poésie, mais nous avons tous des preuves que certains poèmes arrivent à transporter même les âmes les plus scientifiquement rigoureuses ! Bref, quand je me présente, j’aime bien dire être à la fois une scientifique et une créatrice de poèmes, avec tous les égarements que cela peut comporter.
Également, dans ma vie quotidienne, mon métier crée un contexte peu ordinaire d’écriture en déplacement. Je voyage énormément pour mes recherches et dans les six dernières années, j’étais beaucoup plus souvent à l’étranger que chez moi, à Montréal. Être poète anthropologue crée aussi un rapport à la réalité exacerbé. Pour moi, le poème et sa fiction se créent à partir de la matière réelle de ma vie. Je pars en exploration pour écrire des poèmes à partir de ce que j’observe de la réalité, qui dépasse toujours tellement la fiction…
Quand j’ai commencé à fréquenter l’université dans les années 2000, même si j’étais passionnée de littérature, je me retrouvais mieux dans la posture d’anthropologue, qui me permettait de décentrer ma propre voix. Ma voix n’était qu’une voix parmi d’autres très différentes, et j’apprenais à reconnaître des déséquilibres de pouvoir, surtout à partir de ma position privilégiée de Blanche. Dans les départements d’études littéraires où j’errais à cette époque, j’étais choquée de devoir sans cesse qualifier et évaluer la valeur littéraire de grandes œuvres à lire. Ça me mettait très en colère. J’avais besoin d’étudier l’écriture avec une vision plus horizontale et de donner à la littérature une profondeur contextuelle. Encore aujourd’hui, l’anthropologie de la littérature me permet, mieux que les études littéraires, d’accueillir l’écriture en fonction de mes valeurs.
V. F. : Dans Le Devoir, en 2018, Dominic Tardif écrivait que la poésie devrait être l’espace de tous les possibles et que tu refusais de voir l’écriture, de voir la vie autrement. Comment s’est passée cette rencontre entre la poésie et toi ?
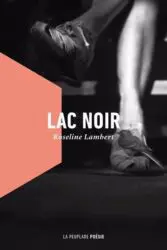 R. L. : Je me nourris viscéralement de matières textuelles tous les jours depuis que je sais lire. Je ne me souviens pas d’avoir eu conscience de rencontrer la poésie ou d’écrire de la poésie. Cependant, quand je regarde des carnets que je noircissais enfant, vers sept ou huit ans, c’était déjà sous forme poétique, en vers, en forme hachurée très graphique. J’ai juste toujours fait ça, comme un geste quotidien qui est là, sans pouvoir me l’expliquer. On dit souvent que la poésie est la forme d’écriture la plus libre. Ça m’émerveille chaque jour : le potentiel de liberté et d’évasion qu’offrent une page blanche et un crayon. C’est un espace ouvert, un espace à prendre. Ça me procure un énorme souffle. Ma vie et la poésie sont intrinsèquement liées ; c’est ce que j’avais dit à Dominic Tardif il y a quelques années, comme tu le rappelles. C’est vraiment encore ma plus grande foi. Je dois agir concrètement dans ma vie pour que les poèmes apparaissent. Ainsi, pour écrire mon livre Lac noir, je suis réellement partie explorer des lacs noirs ailleurs dans le monde.
R. L. : Je me nourris viscéralement de matières textuelles tous les jours depuis que je sais lire. Je ne me souviens pas d’avoir eu conscience de rencontrer la poésie ou d’écrire de la poésie. Cependant, quand je regarde des carnets que je noircissais enfant, vers sept ou huit ans, c’était déjà sous forme poétique, en vers, en forme hachurée très graphique. J’ai juste toujours fait ça, comme un geste quotidien qui est là, sans pouvoir me l’expliquer. On dit souvent que la poésie est la forme d’écriture la plus libre. Ça m’émerveille chaque jour : le potentiel de liberté et d’évasion qu’offrent une page blanche et un crayon. C’est un espace ouvert, un espace à prendre. Ça me procure un énorme souffle. Ma vie et la poésie sont intrinsèquement liées ; c’est ce que j’avais dit à Dominic Tardif il y a quelques années, comme tu le rappelles. C’est vraiment encore ma plus grande foi. Je dois agir concrètement dans ma vie pour que les poèmes apparaissent. Ainsi, pour écrire mon livre Lac noir, je suis réellement partie explorer des lacs noirs ailleurs dans le monde.
V. F. : Dans Lac noir, les lieux sont d’une importance capitale. La plupart des poèmes sont titrés par des coordonnées dont tu donnes le détail à la fin de chaque section. On se déplace avec toi et si certains lieux sont présentés comme des abris, d’autres semblent menaçants. Ce livre a été écrit dans le cadre de quatre résidences d’écriture, en Finlande et en Lituanie. Comment les poèmes se sont-ils construits, à travers les différents espaces explorés ?
R. L. : Comme tu le constates, je me déplace énormément pour des projets de recherche et des résidences d’écriture, où je rencontre toujours beaucoup de gens qui me marquent et que je quitte, et cela a un effet sur ma mémoire. J’écris donc en continu pour m’aider à tenir le fil de ma propre histoire réelle et de mon itinéraire. En écrivant Lac noir, je réalisais que je n’arrivais pas à me souvenir ou à oublier certaines personnes, ni à faire une ligne du temps linéaire de mes itinéraires, ma mémoire me faisant défaut. Les paysages marquent aussi énormément mes souvenirs. J’avais besoin de mettre les coordonnées des poèmes que j’écrivais pour me souvenir des lieux traversés.
Pour le commun des mortels, dans notre logique rationnelle et capitaliste, ça peut sembler fou d’aller par exemple au Monténégro pour trouver un autre lac noir, le Crno Jezero, dans mon cas pour m’y baigner, penser et écrire sur ma grand-mère qui vient de Black Lake. Que tout ce long voyage soit motivé par un poème basé sur une correspondance de noms de lieu. Mais c’est justement là, sur ces exactes coordonnées, que je peux capter mon poème. Cela devient le lieu de mon engagement dans le livre que j’écris et qui se déploie comme une résistance, je dirais, face au non-sens du monde ordinaire. C’est là où je peux toucher une certaine transcendance de l’art ou une dimension mantique. Je me donne la liberté, dans mes actions poétiques, de choisir les métaphores auxquelles je veux donner du sens, du poids, de la profondeur et d’y attacher des correspondances dans le réel tout simplement.
V. F. : En début de livre, tu écris, au sujet d’un homme rencontré : « il est poème où il m’avoue dans le fjord/j’ai peur des profondeurs ». J’ai l’impression, à te lire depuis ton premier livre, que les profondeurs ne t’effraient pas, que tu aimes aller à la racine des choses, des émotions, bravement, avec curiosité, avec rigueur aussi. Je me trompe ?
R. L. : Non ; tu me lis bien, les profondeurs émotionnelles me caractérisent. J’ai cette croyance que le poème permet de creuser plus profond ce que je n’arrive pas à saisir avec ma rationalité. Dans ma vie depuis l’adolescence, j’ai eu la chance de faire de longues années de travail thérapeutique psychodynamique et j’ai appris ce réflexe de plonger au cœur de mes émotions les plus dures, d’aller défaire les nœuds de mes souffrances psychiques. Ça me fascine aussi chez les autres. Je me sens privilégiée quand les autres me donnent accès à leur monde intérieur. Dans Lac noir, le poème où la narratrice plonge dans le lac noir de sa grand-mère avec tant de désespoir, pour finalement y rencontrer la lumière dans les yeux de son aïeule, illustre ce que tu décris dans ta question. Bref, j’aime explorer les profondeurs de nos lacs, dans le réel et au figuré !
V. F. : Tu as choisi d’intégrer des images d’archives anonymes dans ton livre. Comment sont-elles arrivées dans le processus de création ? Comment viennent-elles répondre aux poèmes, les alimenter ?
R. L. : J’étais en résidence à Lapua, en Finlande, où il y avait un petit musée de la photographie et en fouillant dans ses archives, je suis tombée sur la série de portraits qui sont imprimés dans Lac noir. Je me souviens que quand j’ai vu ces photos pour la première fois, j’ai éprouvé une vive sensation physique, j’ai frissonné de tout mon corps, j’avais un choc esthétique : ces portraits étaient l’incarnation visuelle du livre que j’écrivais depuis des années. Ce sont des portraits anonymes en noir et blanc qui ont été déformés et effacés en partie par l’eau et la moisissure, formant des abstractions qui évoquent de la fumée ou des nuages. C’était la parfaite métaphore du deuil dans mes poèmes alors que je tentais de décrire les visages que j’oubliais et qui me revenaient sans cesse. Ce qui prenait également tellement de sens était que les personnes, que l’on ne peut plus reconnaître sur les images, étaient réelles. Elles étaient peut-être oubliées ou elles demeuraient encore vivantes dans les souvenirs des gens de ce village. J’aime ce phénomène chimique sur la pellicule que les éléments naturels aient altéré matériellement le souvenir des visages de ces gens : cela me semble tellement poétique que l’oubli puisse ainsi se matérialiser concrètement dans nos mains. Ces images permettent à mes poèmes d’avoir aussi une dimension organique.
 Je voudrais ajouter que j’écris de la poésie parce que j’ai un immense besoin de transcendance esthétique que je ne peux pas combler par l’écriture scientifique. Je suis attirée par une idée du beau, peut-être un peu gothique, qui en même temps se rapproche de la laideur et se mélange avec des paysages de neige immaculée. C’est l’univers que j’explore dans Lac noir, avec de la pourriture, beaucoup de neige et des corbeaux. Je m’inspire d’un courant littéraire porté par des écrivaines du nord de la Finlande (comme Katja Kettu et Sofi Oksanen), que j’ai lues en traduction et qui arrivent à créer une puissance féministe dans leurs livres à partir d’une esthétique que je qualifierais de punk ou encore de métal, mais qui s’amalgame à la beauté hivernale des paysages de l’Arctique. C’est une conception du beau et de la féminité qui pour moi prend ses racines dans la notion de survie, et ça me bouleverse.
Je voudrais ajouter que j’écris de la poésie parce que j’ai un immense besoin de transcendance esthétique que je ne peux pas combler par l’écriture scientifique. Je suis attirée par une idée du beau, peut-être un peu gothique, qui en même temps se rapproche de la laideur et se mélange avec des paysages de neige immaculée. C’est l’univers que j’explore dans Lac noir, avec de la pourriture, beaucoup de neige et des corbeaux. Je m’inspire d’un courant littéraire porté par des écrivaines du nord de la Finlande (comme Katja Kettu et Sofi Oksanen), que j’ai lues en traduction et qui arrivent à créer une puissance féministe dans leurs livres à partir d’une esthétique que je qualifierais de punk ou encore de métal, mais qui s’amalgame à la beauté hivernale des paysages de l’Arctique. C’est une conception du beau et de la féminité qui pour moi prend ses racines dans la notion de survie, et ça me bouleverse.
V. F. : Les couleurs sont évoquées à plusieurs reprises dans Lac noir. D’abord à travers les titres des différentes sections, puis dans les poèmes, où parfois on cherche à les préserver, où d’autres fois elles tombent carrément du ciel ; aussi, ton précédent livre s’intitulait Les couleurs accidentelles. Peux-tu me parler du lien particulier que tu entretiens avec elles ? Que font-elles naître en toi ?
R. L. : Je suis devenue obsédée par les couleurs dans la poésie quand j’ai réalisé à quel point nous composons des livres presque uniquement en noir et blanc. Alors que nous avons le privilège d’utiliser la forme d’écriture la plus libre, on dirait que les livres de poésie sont emprisonnés dans une matérialité tellement conventionnelle. Pourtant, l’objet-livre pour moi fait aussi partie de l’œuvre littéraire, même si on a tendance à complètement dissocier les deux dans notre littérature québécoise. C’est en lisant le grand Jacques Roubaud, ce poète et mathématicien français qui a poussé la poésie expérimentale très loin, que j’ai eu envie d’écrire en couleurs.
Aussi, l’essai de Sophie Divry, Rouvrir le roman (2017), m’a donné de l’énergie pour repenser le livre en dehors de notre système littéraire romano-centré qui réduit de plus en plus nos formes littéraires en faveur de la popularité et des ventes du roman. Ça referme la littérature sur elle-même. J’adore aussi le roman, mais il faut que la littérature ait de multiples formes pour se réinventer. Je milite pour l’importance de la diversité des genres textuels et matériels du livre. En poésie expérimentale, on peut jouer avec l’alignement des lignes, la couleur, la transparence, l’ordre des pages : tout est permis ! Dans mon œuvre, la métaphore de la couleur est que le texte en noir et blanc est la version textuelle de la vie, alors que la vie, elle, dans sa réalité, se déroule en couleurs. Ça me permet de faire converger fiction et réalité matériellement dans mes pages.
V. F. : À travers les poèmes, certains mots sont écrits en gris pâle, comme si tu souhaitais attirer notre attention sur ceux-ci. Tu avais fait l’exercice dans Les couleurs accidentelles, justement, où certains mots étaient écrits en couleur. Je le vois un peu comme un jeu de pistes, d’indices, un nouveau tracé que tu dessines pour nous à travers le livre. Peux-tu me parler de ce procédé ?
R. L. : Pour Lac noir, je me suis inspirée du travail de poésie graphique de Gail McConnell, une poète queer irlandaise que je vous suggère vivement de lire. Son livre est massivement orange et a ce titre fabuleux : The Sun is Open; il a été publié en 2021 au Royaume-Uni, chez Penned in the Margins, une de mes maisons de poésie préférées. Récemment, j’ai vu que Darby Minott Bradford, qui vit plus près de nous, avait lui aussi écrit en gris dans son livre Dream of No One but Myself, paru également en 2021. Quand je me suis mise à travailler Lac noir avec des mots en gris, j’ai été happée par la force métaphorique de mon nouveau jeu graphique. Les mots gris apparaissaient à la fois plus forts dans la page tout en étant plus cachés. C’était le parfait pendant typographique des portraits en noir en blanc qui s’effacent. L’effacement des visages, l’effacement des mots, je pouvais les frôler partout dans mes pages. Les mots en gris, les mots choisis du deuil, je cherchais à les retenir en les imprimant tout comme à les oublier. Je pouvais tracer concrètement ma métaphore de l’oubli dans mes pages. Cela demandait aussi une nouvelle attention des yeux. Ces dispositifs me permettent de créer des objets-livres toujours plus libres, plus ouverts, comme le soleil, comme les poèmes !
V. F. : Lac noir est traversé par l’introspection, les rencontres, le désir, mais aussi par ces échanges avec le fantôme de ta grand-mère, à qui tu dédies le livre. Sa présence se fait murmures, chuchotements ; elle est guide, oracle. Comment la voix de ta grand-mère s’est-elle faufilée à travers ta poésie ? Quelle empreinte y a-t-elle laissée ?
R. L. : Dans tous mes livres il y a une lignée de femmes qui me précèdent. Elles sont ce qui les met au monde. Ma grand-mère est réellement née à Blake Lake en 1920, un village qu’elle a fui toute seule à 16 ans. Ma lignée maternelle est une lignée de femmes qui se taisaient et qu’on n’écoutait pas. Elles n’avaient pas la liberté que j’ai aujourd’hui de dire ce que je pense, d’écrire et de me déplacer. J’explore dans Lac noir l’idée poétique que cette grand-mère vient d’une étendue d’eau noire l’incitant à la fuite vers ailleurs, idée qu’elle transmet à la narratrice. Elle se met en mouvement dans le livre pour découvrir d’autres lacs noirs du monde. Ce que j’ai fait réellement dans ma vie en écrivant ce livre. Tous les jours, je trouve ça difficile d’écrire, même si c’est un geste que je ne peux pas empêcher. Ma lignée maternelle est ce qui me permet de dire des choses, de ne pas rester silencieuse, et je dirais que j’honore une dette en me penchant sur la douleur et la dureté de ces vies-là qui me précèdent et qui m’ont permis, à moi, de voyager, de dire, de m’échapper. C’est l’écho de ces voix que je tente de libérer dans mes livres.
EXTRAITS
Ma page se déchire il calcule la vitesse
magique du vent est quatorze mètres
par seconde bientôt on l’atteindra
Lac noir, p. 20.
je capture le ciel dans de petits carrés
je l’aligne et le mets en ordre
même s’il est beaucoup trop grand
Lac noir, p. 45.
Dans la cabane je crache à haute voix
ça prend du feu pour écrire un poème
Lac noir, p. 73.










