 Quiconque possède des connaissances sommaires de l’histoire de la littérature québécoise peut généralement nommer quelques titres associés au roman du terroir : Maria Chapdelaine de Louis Hémon, Trente Arpents de Ringuet ou Le Survenant de Germaine Guèvremont, par exemple. On le sait, certains de ces classiques figurent souvent au nombre des lectures obligatoires des étudiants du collégial.
Quiconque possède des connaissances sommaires de l’histoire de la littérature québécoise peut généralement nommer quelques titres associés au roman du terroir : Maria Chapdelaine de Louis Hémon, Trente Arpents de Ringuet ou Le Survenant de Germaine Guèvremont, par exemple. On le sait, certains de ces classiques figurent souvent au nombre des lectures obligatoires des étudiants du collégial.
La terre maternelle d’Anne-Marie Turcotte fait écho à La terre paternelle (1846) de Patrice Lacombe, ouvrage historiquement considéré comme pionnier du genre. A priori, ce premier roman de l’auteure ne partage que très peu d’éléments avec l’œuvre du XIXe siècle. Toutefois, le simple fait de s’y associer de manière explicite par le choix d’un titre clairement connoté suggère une sorte de filiation que le lecteur tentera d’élucider.
De son côté, Rudesse, d’Audrey Lemieux, brosse un tableau de la vie sur une ferme familiale par le biais d’un discours désenchanté qui n’a rien d’une représentation magnifiée du monde paysan. Dans cette œuvre sombre, la ruralité prend davantage l’allure d’une contrée inhospitalière de laquelle on souhaite s’échapper.
Le Témiscouata légendaire d’Anne-Marie Turcotte
Sur un mode qui flirte avec l’autofiction, La terre maternelle retrace le parcours d’Anne, de son adolescence jusqu’au début de sa vie d’adulte. L’action se déroule principalement dans le Témiscouata, une MRC tampon du Bas-Saint-Laurent située entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick. Au début du récit, la protagoniste termine le secondaire. Elle part ensuite pour Rimouski afin de poursuivre ses études : le cégep, puis l’université. Du point de vue de la jeune femme parfaitement épanouie dans sa petite communauté, ce déracinement constitue un passage difficile. Anne l’affirme sans détour : « Je n’ai jamais eu l’impression d’appartenir au territoire du Bas-Saint-Laurent. Le BSL, c’est Rivière-du-Loup, Rimouski ou Trois-Pistoles ». En fait, dans le roman, le territoire joue un rôle qui n’a rien d’accessoire : on le nomme, on le raconte, on va presque jusqu’à lui accorder une entité propre. Sur le plan toponymique, les lieux sont nettement désignés ; aussi, l’auteure dresse une topographie méticuleuse de l’espace dans lequel est ancrée l’action.
L’éloignement de sa région natale comporte assurément des défis, mais Anne tient bon. Peut-être parce que durant les mois estivaux, elle regagne sa localité d’origine pour occuper divers emplois. Entre autres, elle apprend le métier de serveuse à la Bouffathèque, un établissement reconnu pour sa poutine, une institution dont la mission est de « [f]aire connaître, partager et rendre hommage aux plats nationaux du Québec dans le respect des traditions et des saveurs authentiques ». Dans ce restaurant, elle tisse des liens avec certaines employées. Le contact avec ces femmes plus âgées affine sa compréhension de la vie et contribue à son cheminement vers le monde adulte.
Quelques années plus tard, elle décroche un poste de commis d’accueil dans un parc provincial. Elle y rencontre Shaun, un Manitobain venu parfaire son français au Québec. À la fin du récit, on apprend qu’elle est enceinte de cet amoureux d’un été, lequel ayant malheureusement coupé les ponts… Anne, qui chérit l’idée d’une maisonnée grouillante d’action depuis longtemps, qui valorise les familles nombreuses comme celles de ses ancêtres, renonce donc à la tentation d’un avortement. Elle choisit de donner naissance à l’enfant, cela malgré l’absence du père. De la sorte, elle concrétise une volonté de perpétuer la culture francophone en Amérique : « [l]es hommes ont transmis leur nom, mais les femmes, on a transmis la langue. Parce que personne ne transmet une langue maternelle comme nous ».
Roman à tiroirs
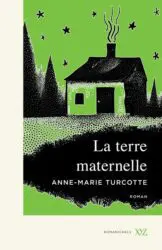 « De version en version, l’histoire déformée par les changements de raconteur fait son chemin jusqu’aux oreilles de tout le monde. »
« De version en version, l’histoire déformée par les changements de raconteur fait son chemin jusqu’aux oreilles de tout le monde. »
Enchâssées entre les passages où la narratrice relate des événements associés à un passé relativement récent, se trouvent des histoires tirées d’une époque plus lointaine. Le Témiscouata, région légèrement méconnue, possède aussi ses légendes ! On pourrait d’ailleurs établir une correspondance, sur le plan formel, entre La terre maternelle et certaines œuvres du XIXe siècle comme Forestiers et voyageurs de Joseph-Charles Taché ou Les anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé père. Jalonnant de façon ponctuelle la trame narrative principale, apparaissent une quantité appréciable de récits s’inspirant de la tradition orale. Ainsi, la narratrice cède fréquemment la parole à des voix secondaires (oncle, père, etc.) qui racontent des histoires issues d’une époque révolue. En ce sens, la corrélation avec les œuvres phares mentionnées auparavant s’impose. De même, on relève une réactualisation de l’histoire de « Rose Latulippe et du diable beau danseur » figurant dans L’influence d’un livre de Phillipe Aubert de Gaspé fils. Turcotte s’inspire de cette légende très répandue pour alimenter l’intrigue de son roman. Elle donne du réputé personnage, incarnation du mal et de la tentation, l’image d’une créature polymorphe subissant de multiples transformations à travers les âges : « [l]e Diable a donc ben son nez fourré partout. Serait-il caché derrière plus d’histoires ? »
Ajoutons que, d’un point de vue théorique, le discours légendaire s’inscrit généralement dans le temps et dans l’espace d’une manière précise afin de provoquer un maximum d’effet. Au contraire du conte, qui d’abord est envisagé comme un objet de divertissement purement fictif se situant dans un il était une foisindéterminé, la légende doit être associée à un lieu identifiable et à un cadre temporel défini. La légende vise à faire vrai. Elle fonctionne tel un objet de croyance partielle, comme une menterie apte à semer le doute. La façon d’offrir un cadre spatial détaillé et un univers référentiel qui s’arrime dans le réel favorise donc cet aspect de véracité recherché. Et dans le meilleur des mondes, Turcotte peut espérer confondre la perplexité des plus incrédules, ou du moins convaincre ses lecteurs de la dimension légendaire du Témiscouata.
Un univers rural désenchanté
L’univers fictionnel d’Audrey Lemieux ne suggère pas le même envoûtement. Le mal n’est pas personnifié sous les traits d’un inconnu séduisant. Il prend davantage la forme d’un démon intérieur, d’une force obscure que l’on doit combattre.
« C’était donc cela, l’effet d’un visage qu’on défonce ? Je n’éprouvais rien de particulier, ni horreur ni contentement – je trouvais la confirmation, dans mes sensations, de ce que j’avais si souvent imaginé. Je savais me battre, on me l’avait appris, il m’avait fallu frapper et frapper dans des poches de moulée, mais dans la chair, sur des corps, jamais. »
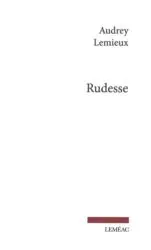 Rudesse s’ouvre sur une scène de violence au travail : une collègue reçoit un coup de poing brutal au visage de la part de la narratrice. De retour chez elle, l’assaillante ressasse son passé, repense à son enfance sur la ferme familiale en compagnie de ses sœurs et de son frère. Elle se souvient de ses parents et de leur intransigeance à la limite de la cruauté. Anticipant son congédiement, elle se cloître chez elle, enveloppée dans un nuage d’incertitudes comme autant de noires réminiscences.
Rudesse s’ouvre sur une scène de violence au travail : une collègue reçoit un coup de poing brutal au visage de la part de la narratrice. De retour chez elle, l’assaillante ressasse son passé, repense à son enfance sur la ferme familiale en compagnie de ses sœurs et de son frère. Elle se souvient de ses parents et de leur intransigeance à la limite de la cruauté. Anticipant son congédiement, elle se cloître chez elle, enveloppée dans un nuage d’incertitudes comme autant de noires réminiscences.
« Il a bien fallu sacrer notre camp. Trop de terre dans les poumons – nous étouffions. »
Teintée d’un pessimisme consommé digne de l’Autrichien Thomas Bernhard, l’écriture de Lemieux n’offre que très peu de similitudes avec celle d’Anne-Marie Turcotte. Ici, la ruralité ne présente rien de bucolique, ne suggère aucun charme pastoral. La vie en dehors d’un centre urbain semble plutôt synonyme d’une solitude frôlant l’ennui mortel. « Nous parlons souvent du désir de mort. Nous en parlons comme les gens parlent, d’ordinaire, des meubles de patio acquis en solde. La mort. Imprimé citron. »
Ajoutons que les narrateurs sont anonymes, tout comme la plupart des personnages qui ne portent aucun prénom : « la mère », « le père » ou « le voisin ». Aussi, l’identité de ce « je » s’exprimant d’une page à l’autre semble incertaine et flottante. Est-ce la voix de cette narratrice apparaissant au début du récit, toujours la même, qui raconte ou est-ce plutôt celles des enfants de la famille qui s’échangent alternativement la parole ? La question mérite d’être posée. Surtout, le parti pris narratif adopté par l’auteure encourage cette ambiguïté. De même, sans être identifiés, les lieux physiques des actions narrées ne sont que sommairement décrits. Tout semble abstrait, voire désincarné. L’écriture met l’accent sur l’intériorité des personnages. Elle se désintéresse des descriptions de la vie matérielle à la faveur d’une analyse psychologique triturée, d’un discours intérieur qui tourne dans la plaie d’une vieille blessure.
« [Q]uand les vaches ruminent, ce n’est pas la rage qui leur remonte par la gorge, mais une nourriture mal dégrossie et encore indigeste qu’elles remâcheront sans plaisir. Au fond, je ne me distingue pas des bêtes, je n’ai jamais rien fait d’autre que cela, ressasser les vieux souvenirs, comme pour en extraire l’essence et m’en nourrir, au lieu de chercher à m’en défaire, à les recracher, à me délivrer de ce que j’ai dans le ventre. »
Chez Lemieux, cette terre maternelle est ainsi associée à un passé douloureux qui a laissé un stigmate indélébile. « Je ne voulais pas revoir la maison, mais elle n’y est pour rien, la maison est en moi, je la connais par cœur – j’ai surtout horreur de l’admettre. »
 L’auteure insiste également sur le rapport difficile qu’entretient la narratrice avec sa mère, un personnage dont la description s’oppose à l’image de la figure maternelle aimante et bienveillante : « [t]ant qu’elle vivrait, elle règnerait de toute son ombre sur la campagne, elle continuerait, épouvantail sec, avec ses jupes longues et ses chignons serrés, à faire fuir toute espèce de créature, ailée ou non, et elle finirait peut-être par se demander pourquoi ces enfants-là – cette engeance-là, comme elle se plaisait à nous appeler – lui rendaient si peu souvent visite ». Il est d’ailleurs possible d’établir des corrélations entre Rudesse et L’ossuaire, précédent roman de Lemieux paru en 2017, qui plonge dans les profondeurs de l’ennui d’une jeune fille issue d’un village dévitalisé. La narratrice est caissière dans l’unique supermarché des environs et habite seule avec une mère obsédée d’ordre et de propreté. À l’exception d’une collègue de travail et du voisin, un vieil agriculteur solitaire, son réseau de contacts avec le monde extérieur semble très limité. Éventuellement, son amie caissière se suicidera et le vieux voisin décédera. Un jour, elle part en République tchèque pour visiter un site archéologique. Tout au long du roman, c’est une narratrice à l’âme éteinte qui s’exprime, une jeune fille qui analyse son rapport à la mort, qui décrit sa relation conflictuelle avec sa mère et qui manifeste son sentiment de claustration lié au fait de vivre au bout d’un rang de campagne.
L’auteure insiste également sur le rapport difficile qu’entretient la narratrice avec sa mère, un personnage dont la description s’oppose à l’image de la figure maternelle aimante et bienveillante : « [t]ant qu’elle vivrait, elle règnerait de toute son ombre sur la campagne, elle continuerait, épouvantail sec, avec ses jupes longues et ses chignons serrés, à faire fuir toute espèce de créature, ailée ou non, et elle finirait peut-être par se demander pourquoi ces enfants-là – cette engeance-là, comme elle se plaisait à nous appeler – lui rendaient si peu souvent visite ». Il est d’ailleurs possible d’établir des corrélations entre Rudesse et L’ossuaire, précédent roman de Lemieux paru en 2017, qui plonge dans les profondeurs de l’ennui d’une jeune fille issue d’un village dévitalisé. La narratrice est caissière dans l’unique supermarché des environs et habite seule avec une mère obsédée d’ordre et de propreté. À l’exception d’une collègue de travail et du voisin, un vieil agriculteur solitaire, son réseau de contacts avec le monde extérieur semble très limité. Éventuellement, son amie caissière se suicidera et le vieux voisin décédera. Un jour, elle part en République tchèque pour visiter un site archéologique. Tout au long du roman, c’est une narratrice à l’âme éteinte qui s’exprime, une jeune fille qui analyse son rapport à la mort, qui décrit sa relation conflictuelle avec sa mère et qui manifeste son sentiment de claustration lié au fait de vivre au bout d’un rang de campagne.
« [J]e suis habitée d’un monde si tellement hanté de taches, de ratures et de marques que l’on découvrira certainement, lors de mon autopsie, que mon cerveau est aussi noir que mes poumons. La mère me polluait tout entière, elle refusait d’ouvrir les fenêtres, mais sans cesse faisait brûler du benjoin, de l’encens ou du charbon dans une guerre éperdue contre les mauvais esprits. »
Un envers et un endroit
On l’aura compris, ces auteures offrent deux visions contrastées de la ruralité, deux visions opposées également de la mère de famille. Dans le premier cas, la campagne implique une vie communautaire riche au centre de laquelle la maternité renvoie l’idée de transmission et de tradition. Dans le second cas, le monde rural est synonyme d’enfermement. Aussi, la figure maternelle joue le rôle d’une détestable geôlière. Cela dit, si on devait se pencher plus longuement sur le sujet, on constaterait possiblement que ce rapport dualiste se manifeste depuis presque toujours en littérature québécoise. Chacune à leur façon, Turcotte et Lemieux perpétuent et réinventent la tradition du terroir et de l’anti-terroir.
Livres lus pour cet article :
Anne-Marie Turcotte, La terre maternelle, XYZ, Montréal, 2023, 208 p.
Audrey Lemieux, L’ossuaire, Leméac, Montréal, 2017, 120 p.
Audrey Lemieux, Rudesse, Leméac, Montréal, 2023, 128 p.
EXTRAITS
Mais notre mère était une spécialiste des serrures.
Audrey Lemieux, Rudesse, p. 31.
Le climat, à la maison, était terrible. On aurait parfois dit qu’il passait dans nos nerfs un influx différent, modulé par les lignes à haute tension qu’on voyait par la fenêtre de la cuisine.
Audrey Lemieux, Rudesse, p. 60.
De retour dans mon village après ma première année de cégep. Je ne pensais pas y arriver, mais finalement, au fil des travaux de session et des exposés oraux, je m’en suis sortie. Je reviens tout de même à Dégelis chaque fin de semaine, une escale indispensable à ma santé mentale, refaire le plein de forêt, de conseils de Papa et de sauce à spag de Maman.
Anne-Marie Turcotte, La terre maternelle, p. 104.
Les femmes comme Jeanne devraient être reconnues de la même manière que les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Donner la vie une douzaine ou une quinzaine de fois, parfois au péril de sa vie, ça vaut autant que de donner sa vie sur un champ de bataille. En Amérique, une chance qu’on les a eues, ces femmes, pour nous défendre dans cette guerre linguistique contre l’assimilation.
Anne-Marie Turcotte, La terre maternelle, p. 62.










