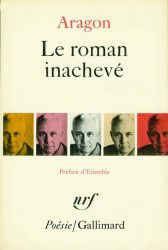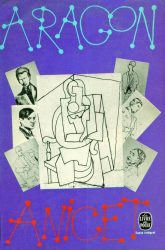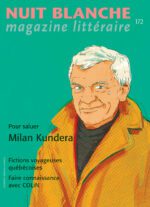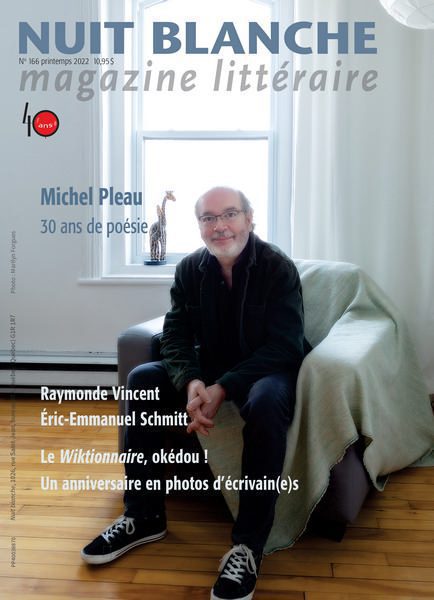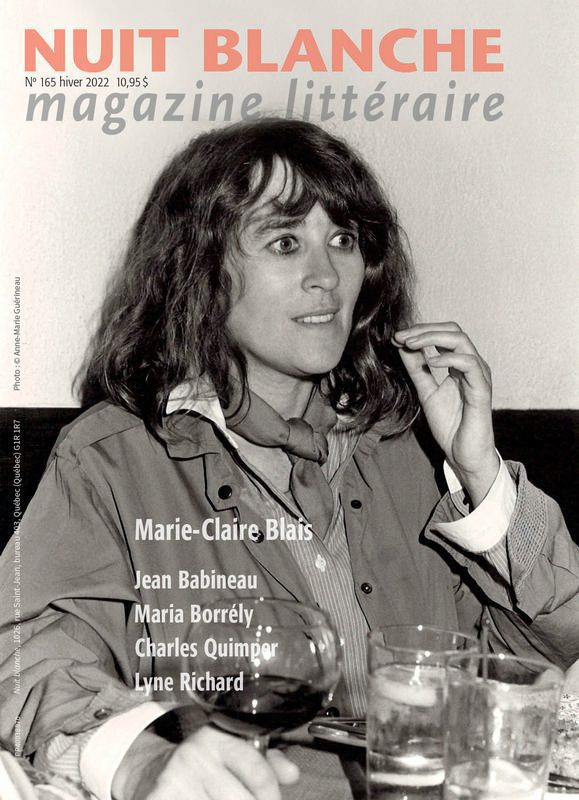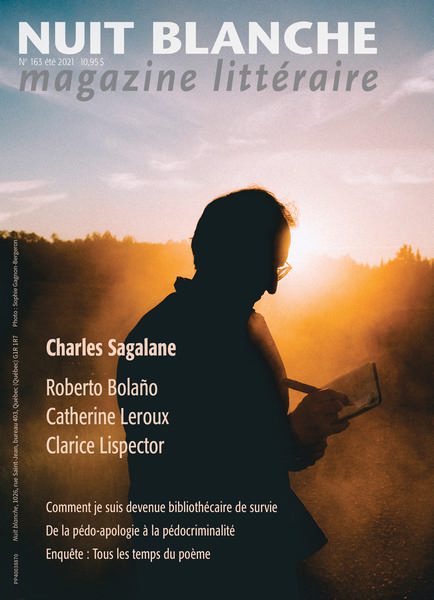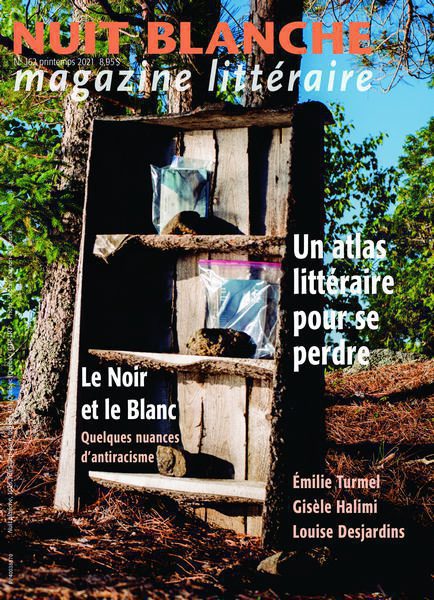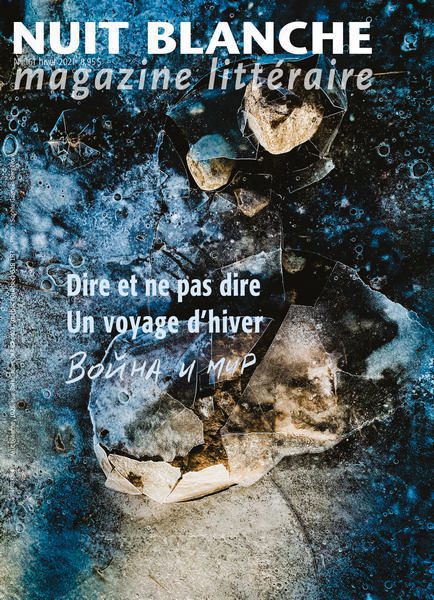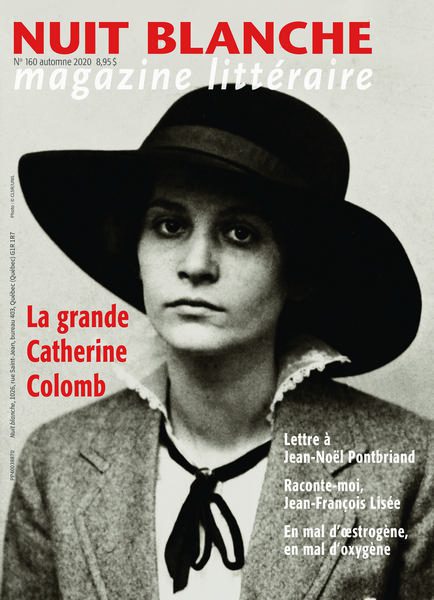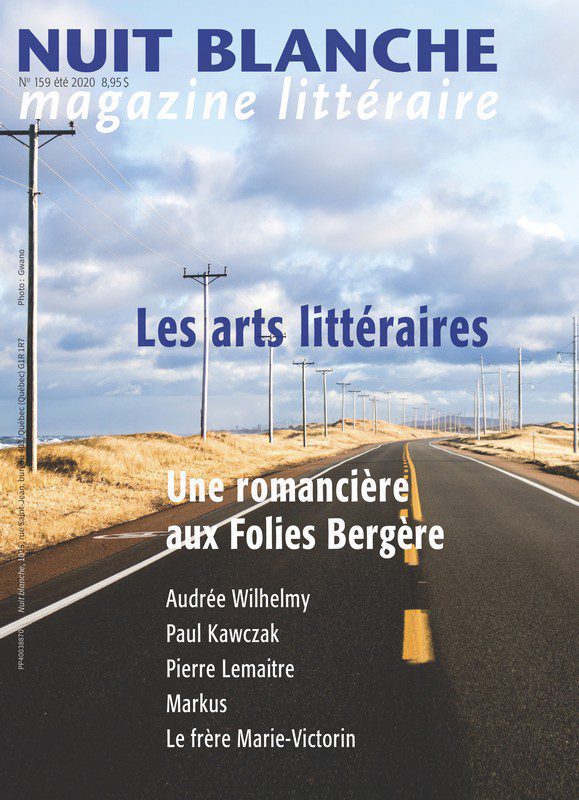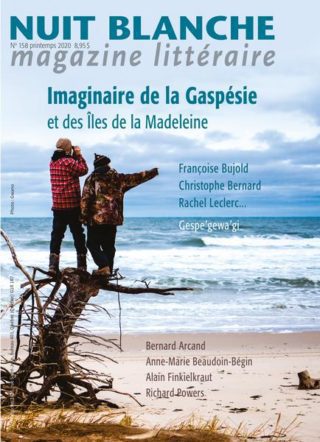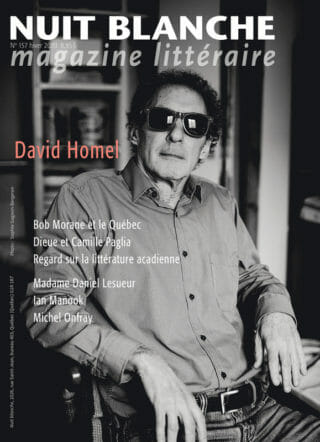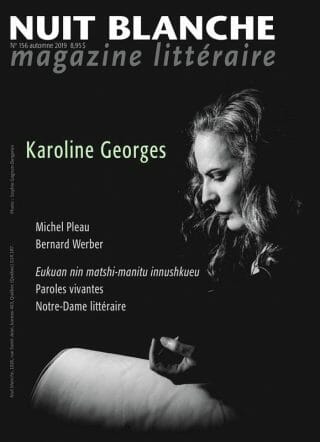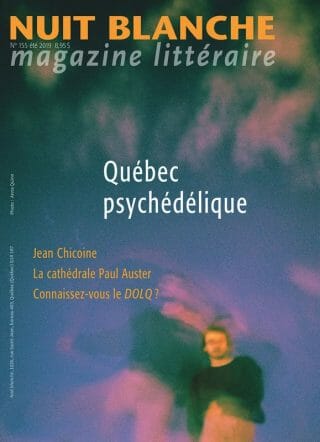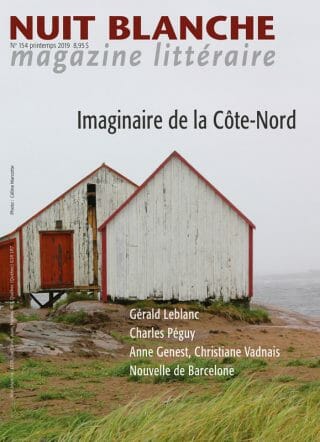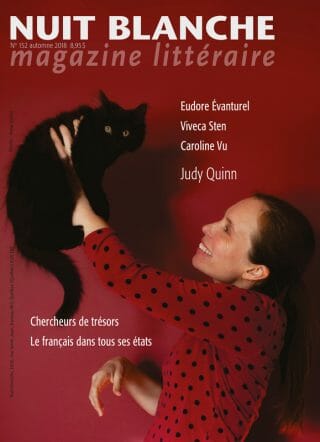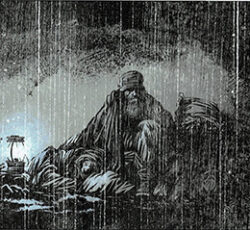Difficile de cerner Aragon. Sélectifs, nombre d’analystes ne scrutent qu’une facette de sa polyvalence : pour l’un, la poésie ; pour l’autre, son bilan de militant communiste avant, pendant et après la guerre de 1939-1945 ; pour un troisième, le contraste entre, d’une part, ses fidélités à Elsa et au rôle public de l’intellectuel et, d’autre part, les trahisons de sa mémoire.
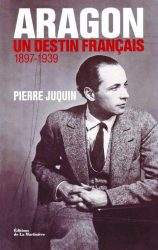 Dans les deux tomes d’Aragon, Un destin français1, Pierre Juquin, tout en privilégiant la dimension politique du personnage, réussit à restituer à Aragon son unité en même temps que sa fabuleuse créativité. Travail monumental, minutieux, enveloppant, qui exigeait une certaine proximité des convictions et, plus encore, un biographe au franc parler.
Dans les deux tomes d’Aragon, Un destin français1, Pierre Juquin, tout en privilégiant la dimension politique du personnage, réussit à restituer à Aragon son unité en même temps que sa fabuleuse créativité. Travail monumental, minutieux, enveloppant, qui exigeait une certaine proximité des convictions et, plus encore, un biographe au franc parler.
Biographe et camarade
De Pierre Juquin, le public québécois sait peu de choses. Né en 1930, il a côtoyé Aragon. Député communiste et chargé par ce parti (PCF) de tâches diverses, surtout en matière d’éducation, il se dissocia suffisamment du communisme institutionnel pour encourir l’expulsion en 1987. Bien au courant des couleuvres qu’Aragon a jugé bon d’avaler par obéissance à Moscou, Juquin adhère pourtant aux mêmes valeurs que lui. Pourquoi pas ? Après tout, l’individu n’est-il pas, comme les deux l’affirment, « une forêt d’hommes » ?
D’un âge respectable, le biographe met son lecteur en garde : ne pas lire le passé à travers le prisme d’aujourd’hui. « En 1930, un communiste français trouve naturel d’avoir deux références : son parti et l’Internationale. Celle-ci intervient en permanence. Tout se discute à Moscou et avec les émissaires de Moscou. Aragon n’est pas le seul communiste français, tant s’en faut, à en appeler plus ou moins directement à l’Internationale de telle décision du PCF. Mais que d’erreurs d’appréciation il commet ! » Juquin admettra d’ailleurs qu’il fut lui-même, à l’époque, un inconditionnel des poèmes d’Aragon, y compris ceux qu’il faisait monter vers Staline comme un encens.
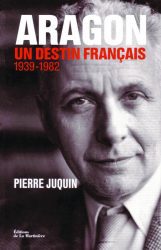 L’auteur admet qu’Aragon fut en partie responsable des tensions qui l’ont écartelé. Il tenait tellement à servir de pont entre l’Internationale et les intellectuels français qu’il sollicitera son adoubement par Moscou. « En 1928, écrit Juquin, il lui faut devenir le Maïakovski français. » Au risque d’y perdre distance et dignité. Il fut une proie facile quand Moscou l’amena à préférer le giron communiste à l’amitié de Breton et des surréalistes ; il en pleurera plus tard, stérilement.
L’auteur admet qu’Aragon fut en partie responsable des tensions qui l’ont écartelé. Il tenait tellement à servir de pont entre l’Internationale et les intellectuels français qu’il sollicitera son adoubement par Moscou. « En 1928, écrit Juquin, il lui faut devenir le Maïakovski français. » Au risque d’y perdre distance et dignité. Il fut une proie facile quand Moscou l’amena à préférer le giron communiste à l’amitié de Breton et des surréalistes ; il en pleurera plus tard, stérilement.
Autre grand mérite de l’auteur, celui de percevoir à quel point éthique et esthétique se tressent chez Aragon. Créer la beauté est pour lui LA tâche qu’exige sa conscience. Que les poètes aient été parmi les premiers à oser la Résistance, voilà qui apparaît infiniment normal pour Aragon. « Pour lui, l’être humain est un animal imaginant. Il ne peut rêver qu’en recourant à ce qui pourrait être. » D’où l’adhésion d’Aragon au réalisme soviétique. D’où aussi la fusion qu’il tente entre son métier d’intellectuel et son militantisme politique. Rendre la beauté accessible à tous, tel est l’objectif poursuivi sur le double front de l’art et de la politique. La synthèse de Juquin joint des valeurs que d’autres opposent l’une à l’autre.
Par monts et par vaux
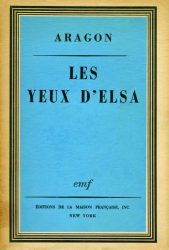 Juquin ne cache pas qu’Aragon a beaucoup batifolé avant de trouver ses assises. Nanti, malgré sa naissance illégitime, d’une copieuse formation distillée par son milieu d’adoption, il élargit encore son horizon culturel en lisant tout ce qui lui tombe sous la main. Les littératures latine, allemande, britannique, étatsunienne lui sont familières dès l’adolescence si ce n’est avant. Stendhal à douze ans ! Juquin, sans jouer les Freud à la petite semaine, laisse entendre que l’enfant, équipé d’un prénom arboré par des ancêtres détestés et privé du patronyme de son géniteur pour motif de bienséance, ne voulut compter que sur lui-même pour se construire une identité. Pas question que ses parents déguisés en oncle et en grande sœur fassent de lui, contre son gré, un médecin. Aragon étudiera la médecine pendant plusieurs années, mais sans conclure. Ni son héroïsme comme médecin-auxiliaire pendant le conflit de 1914-1918, ni les honneurs que lui valut cette conduite ne l’attachèrent à cette profession. En revanche, le jeune Aragon sera de toutes les rébellions culturelles : il épousa le surréalisme durablement, le dadaïsme pendant quelques lunes, l’automatisme le temps d’un soupir, l’écriture fulminante en catimini (Le con d’Irène…). Le biographe montre encore Aragon attaché, un lustre durant, aux subventions du riche couturier Doucet ou chevalier servant de la riche héritière de la Cunard. Années flottantes d’un agité génial et dont Juquin rend compte sans moralisme.
Juquin ne cache pas qu’Aragon a beaucoup batifolé avant de trouver ses assises. Nanti, malgré sa naissance illégitime, d’une copieuse formation distillée par son milieu d’adoption, il élargit encore son horizon culturel en lisant tout ce qui lui tombe sous la main. Les littératures latine, allemande, britannique, étatsunienne lui sont familières dès l’adolescence si ce n’est avant. Stendhal à douze ans ! Juquin, sans jouer les Freud à la petite semaine, laisse entendre que l’enfant, équipé d’un prénom arboré par des ancêtres détestés et privé du patronyme de son géniteur pour motif de bienséance, ne voulut compter que sur lui-même pour se construire une identité. Pas question que ses parents déguisés en oncle et en grande sœur fassent de lui, contre son gré, un médecin. Aragon étudiera la médecine pendant plusieurs années, mais sans conclure. Ni son héroïsme comme médecin-auxiliaire pendant le conflit de 1914-1918, ni les honneurs que lui valut cette conduite ne l’attachèrent à cette profession. En revanche, le jeune Aragon sera de toutes les rébellions culturelles : il épousa le surréalisme durablement, le dadaïsme pendant quelques lunes, l’automatisme le temps d’un soupir, l’écriture fulminante en catimini (Le con d’Irène…). Le biographe montre encore Aragon attaché, un lustre durant, aux subventions du riche couturier Doucet ou chevalier servant de la riche héritière de la Cunard. Années flottantes d’un agité génial et dont Juquin rend compte sans moralisme.
Les deux ancrages
Vint la trentaine (1927) et Aragon troqua son vagabondage contre deux fidélités : Elsa et le communisme. Juquin n’est pas dupe du mythe créé autour d’Elsa, mais il sait cette femme indispensable à Aragon. Elle-même romancière de race, belle-sœur du légendaire Maïakovski, de taille à affronter son effervescent compagnon, Elsa Triolet fut pour Aragon une exigence et une complicité. À propos des premières 370 pages de l’Histoire parallèle de l’URSS, Elsa émet un jugement tranchant : « Indigeste ». Quand Aragon, « entre en crise, parle de rompre son contrat et de se retirer à la campagne, Elsa, comme toujours lucide, impitoyable, va le remettre au travail ». Dure, elle incite Aragon à clarifier sa position au sujet de Pasternak : « Louis, aurait-elle lancé, tu ne vas pas te déshonorer une fois de plus ! » Aragon, pour qui lire ses textes à autrui constituait la quintessence du dialogue, sut vite qu’Elsa pouvait l’interrompre à tout instant. Femme aimante ? Sans doute. Satellite ? Jamais.
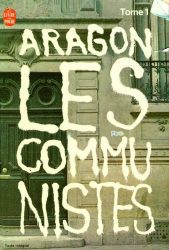 Le biographe attache encore plus d’attention à « l’entrée d’Aragon en communisme ». Il observe cette immersion avec minutie, prudence, franchise. Lui-même communiste allergique au mensonge, Juquin, sans minimiser les apports d’Aragon à la cause communiste, débusque avec tristesse et clarté les erreurs commises par trop de docilité. Quand Aragon endosse le pacte intervenu entre Staline et Hitler, l’auteur réserve son jugement, car il ne sait pas si le militant croit ou non aux vertus de cette dégradante volte-face. En revanche, quand « Aragon développe avec aplomb la fiction d’un Thorez qui serait resté sur le sol français jusqu’en 1943 », Juquin explose : « Tout de même ! » Le biographe sait, en effet, tout comme Aragon, qu’au moment où le chef du PCF a fait surface à Moscou en mai 1943, « cela faisait alors trois ans et demi qu’il résidait en URSS, et près de deux ans qu’il se morfondait à Dufa, au pied de l’Oural, où les Soviétiques l’avaient confiné ». Tout aussi attristé, Juquin reprochera à Aragon d’avoir cru aux procès de Moscou et à leurs simulacres de confessions, d’avoir décrié un Kravchenko qu’il savait fiable… Quand Aragon se porte à la défense de Lyssenko, pitoyable technicien d’agrobiologie auquel l’URSS confia imprudemment la réorientation de son agriculture, Juquin hésite entre la colère et le désarroi : « Sur ses terres, la littérature et l’art, Aragon, tout en se compromettant avec le jdanovisme, a su nuancer, ruser, ménager l’essentiel. Il a – peut-être davantage que nous le savons – soutenu quelques écrivains soviétiques critiques. Mais dans un domaine qu’il ne maîtrise pas, il ne voit pas (ne veut pas voir ?) les dessous et les dangers de la victoire (provisoire) du lyssenkisme. Il abandonne à leur sort des scientifiques qui se sont battus avec courage ». Pris en flagrant délit de mensonge, Aragon déconcerte Juquin par sa réplique à François Nourissier : « Tu vois, petit, je suis de ces gens qui croient ce que leur parti leur dit ». D’avance, Juquin s’était pourtant réservé une échappatoire : « Qu’est-ce qui importe le plus dans ce discours, des bévues d’Aragon pendant la guerre froide […] ou de sa conception de la ‘vocation historique’ des intellectuels ? » On voit poindre les circonstances atténuantes…
Le biographe attache encore plus d’attention à « l’entrée d’Aragon en communisme ». Il observe cette immersion avec minutie, prudence, franchise. Lui-même communiste allergique au mensonge, Juquin, sans minimiser les apports d’Aragon à la cause communiste, débusque avec tristesse et clarté les erreurs commises par trop de docilité. Quand Aragon endosse le pacte intervenu entre Staline et Hitler, l’auteur réserve son jugement, car il ne sait pas si le militant croit ou non aux vertus de cette dégradante volte-face. En revanche, quand « Aragon développe avec aplomb la fiction d’un Thorez qui serait resté sur le sol français jusqu’en 1943 », Juquin explose : « Tout de même ! » Le biographe sait, en effet, tout comme Aragon, qu’au moment où le chef du PCF a fait surface à Moscou en mai 1943, « cela faisait alors trois ans et demi qu’il résidait en URSS, et près de deux ans qu’il se morfondait à Dufa, au pied de l’Oural, où les Soviétiques l’avaient confiné ». Tout aussi attristé, Juquin reprochera à Aragon d’avoir cru aux procès de Moscou et à leurs simulacres de confessions, d’avoir décrié un Kravchenko qu’il savait fiable… Quand Aragon se porte à la défense de Lyssenko, pitoyable technicien d’agrobiologie auquel l’URSS confia imprudemment la réorientation de son agriculture, Juquin hésite entre la colère et le désarroi : « Sur ses terres, la littérature et l’art, Aragon, tout en se compromettant avec le jdanovisme, a su nuancer, ruser, ménager l’essentiel. Il a – peut-être davantage que nous le savons – soutenu quelques écrivains soviétiques critiques. Mais dans un domaine qu’il ne maîtrise pas, il ne voit pas (ne veut pas voir ?) les dessous et les dangers de la victoire (provisoire) du lyssenkisme. Il abandonne à leur sort des scientifiques qui se sont battus avec courage ». Pris en flagrant délit de mensonge, Aragon déconcerte Juquin par sa réplique à François Nourissier : « Tu vois, petit, je suis de ces gens qui croient ce que leur parti leur dit ». D’avance, Juquin s’était pourtant réservé une échappatoire : « Qu’est-ce qui importe le plus dans ce discours, des bévues d’Aragon pendant la guerre froide […] ou de sa conception de la ‘vocation historique’ des intellectuels ? » On voit poindre les circonstances atténuantes…
Unité et puissance

L’acquittement n’est d’ailleurs pas immérité. Aragon, démontre l’auteur, aura amené le PCF à tempérer son ouvriérisme pour reconnaître ce qu’il doit aux intellectuels. Il aura rendu la Résistance forte de tous les dévouements ; qu’on pense à La rose et le réséda. Malgré le retour de la France à ses querelles sectaires après 1945, Aragon réussit à construire un front commun des intellectuels en assoyant (parfois) côte à côte Claudel et Picasso, Gide et Mauriac. Par La semaine sainte, par Les beaux quartiers, par Blanche ou l’oubli, etc., Aragon aura, mine de rien et n’en déplaise à Breton, mis le roman à la portée d’un public élargi. Par Les poètes, par Les yeux et la mémoire, il fit de même pour la poésie. Le roman inachevé permit à Ferré comme à Ferrat d’offrir au public des airs irrigués de textes magnifiques. Les genres littéraires protesteraient en vain (p. ex. Le paysan de Paris) : en enfreindre les règles ne faisait que rendre Aragon plus abordable. « Qu’est-ce qui importe le plus ? » dirait Juquin.
Le travail de l’éditeur n’égale pas celui du biographe. Ni index, ni iconographie. La liste des œuvres d’Aragon ? L’éditeur se borne à renvoyer le lecteur à La Pléiade. Et personne n’a pensé aux éditeurs québécois qui, pendant la guerre, ont publié plusieurs titres d’Aragon et le Goncourt d’Elsa.
1. Pierre Juquin, Aragon, Un destin français, La Martinière, Paris : T. I, Le temps des rêves (1897-1939), 2013, 807 p., 49,95 $ ; T. II, L’Atlantide (1939-1982), 2013, 701 p., 49,95 $.
EXTRAITS
[…] cette énergie, cette jubilation créatrice, accumulée avec un formidable capital culturel au fond de soi, c’est grâce à elle qu’au long de sa vie Aragon sauvera sa peau dans les moments les plus tragiques : après la Grande Guerre, face au fascisme et à la défaite nationale, et dans la tragédie du stalinisme, la pire pour lui.
T. I, p. 95.
En 1967, Aragon publie « Lautréamont et nous », dans deux livraisons des Lettres françaises. Ces pages comptent au nombre des chefs-d’œuvre de l’histoire littéraire française du XXe siècle. Il y a alors belle lurette que le communisme français a changé de phase et Aragon d’approche : ses camarades reconnaissent enfin l’importance de l’acte créateur, du surréalisme, des propositions nouvelles.
T. I, p. 164.
À en croire L’œuvre poétique, Aragon s’est débattu entre plusieurs loyautés – avec le groupe surréaliste, avec la régie du parti, avec un copain à la langue trop bien pendue. Mais Breton ? Et si son imprimeur était allé trop vite ?… Aragon suppute cela à l’âge de soixante-dix-huit ans. Il n’en avait pas trente-cinq lors de la rupture.
T. I, p. 554.
Dans la société largement déchristianisée du XXe siècle, il devient difficile de comprendre pourquoi l’alliance avec les chrétiens fonde la stratégie de Résistance d’Aragon, et, je l’ai dit, pourquoi les références chrétiennes tiennent une grande place à partir de 1940. Mais l’histoire a-t-elle dit son dernier mot ?
T. II, p. 183.
Ç’aurait donc été lui le Grand Épurateur de la république des lettres, entre 1944 et 1946 ! Depuis cette époque-là, Aragon est constamment désigné du doigt par la plupart des historiens. Eh bien, on se trompe. Les faits sont différents.
T. II, p. 289.
Ce comportement d’Aragon à partir du début de la guerre froide ne pose énigme qu’à ceux qui ne voient pas qu’il joue un jeu double. Je ne dis pas un double jeu. À la fois contre les « ennemis » externes, porteurs de l’américanisme et du danger de guerre, et contre les blocages internes.
T. II, p. 313.