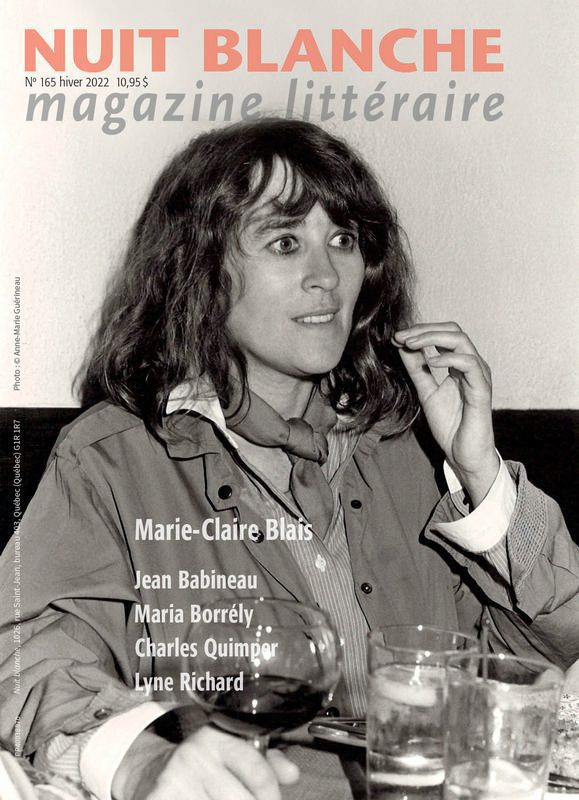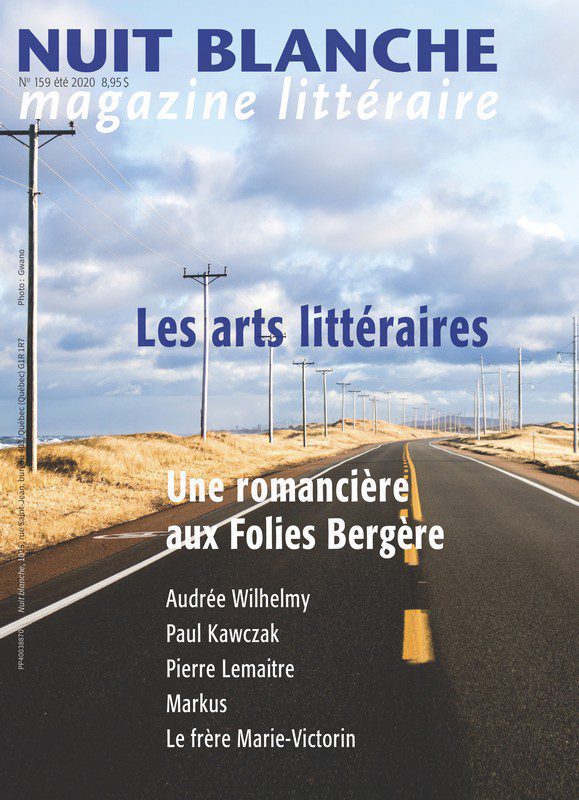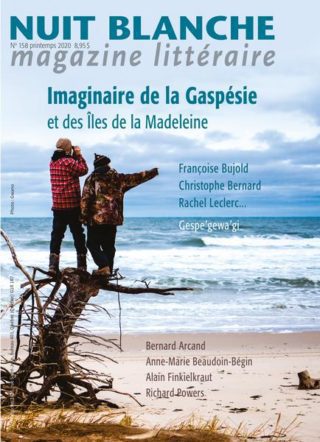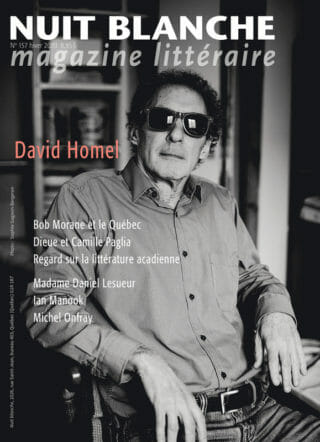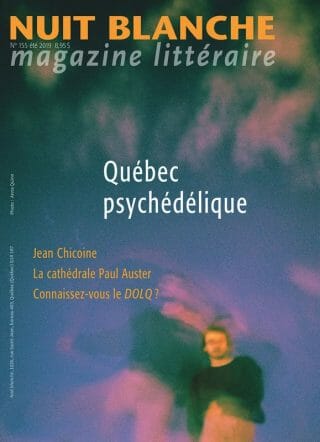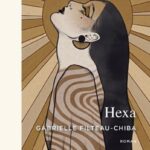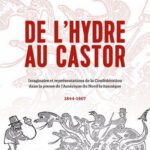À l’hôtel Iris, un soir, Mari est témoin d’une altercation entre le client de la chambre 202 et une prostituée. L’homme, ni beau ni jeune, capte toutefois l’intérêt de la jeune fille. «Je me suis dit que je n’avais encore jamais entendu un ordre résonner d’une manière aussi belle. Il en émanait sang-froid, majesté et conviction. Même le mot « putain » avait un accent aimable.» Cette voix ouvre une faille dans le monde clos de Mari. Depuis la mort de son père, ce monde se réduit au décor un peu minable de l’hôtel Iris, propriété familiale, trop éloigné des plages de la petite ville balnéaire pour être très fréquenté. Mari, qui a été retirée de l’école, y tient la réception entre les exigences de sa mère, les doléances des clients et les petits larcins de la femme de ménage.
Quelques jours après l’altercation, la jeune fille revoit l’homme de l’hôtel chez un marchand de la place. Poussée par la curiosité, elle le suit jusqu’à l’embarcadère où l’homme, un traducteur de russe, attend le traversier pour l’île d’en face. Dès lors, Mari basculera peu à peu dans un autre univers où les humiliations sexuelles que lui fait subir le traducteur se mêlent aux échos d’une tendresse oubliée. À la fin de l’été, plus rien ne sera pareil.
Yôko Ogawa, précise son éditeur français, est une virtuose du malaise. Hôtel Iris, septième ouvrage qu’elle publie aux éditions Actes Sud, en fait certainement la preuve. Familier ou non avec l’œuvre de l’écrivaine japonaise, le lecteur ne peut abandonner le roman en dépit de l’atmosphère sulfureuse qui s’en dégage. Car l’écriture d’Ogawa, sobre, presque clinique, est diablement efficace ! Mari n’explique pas, ne cherche pas à comprendre : elle raconte simplement les faits et le déroulement des événements sans honte ni complaisance. Et le lecteur la suit, docile, jusqu’au bout.