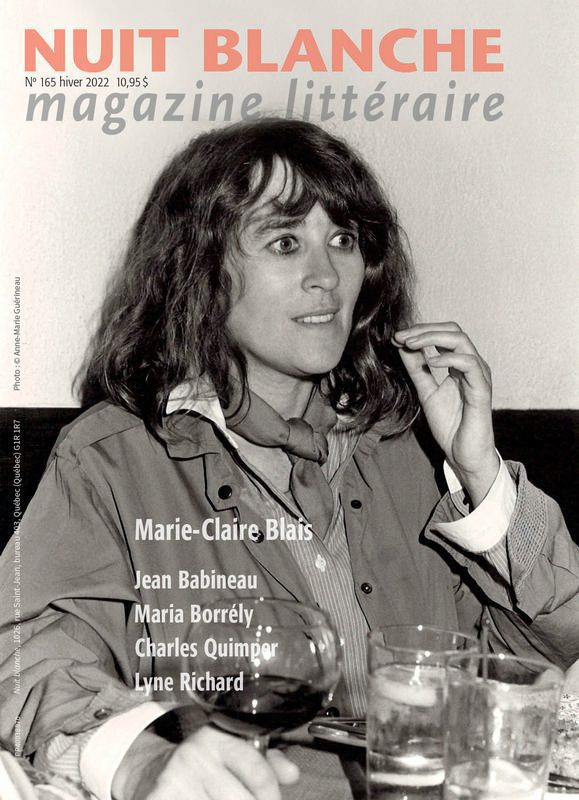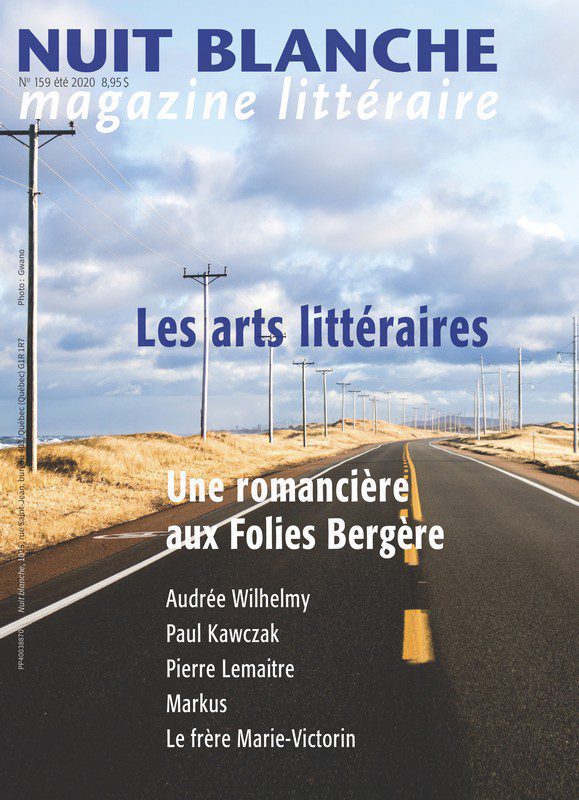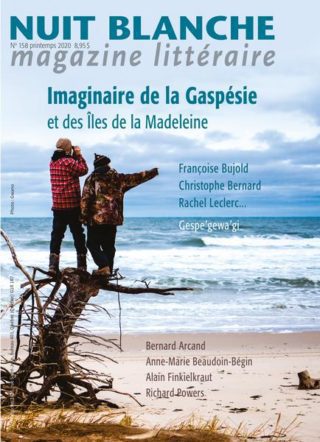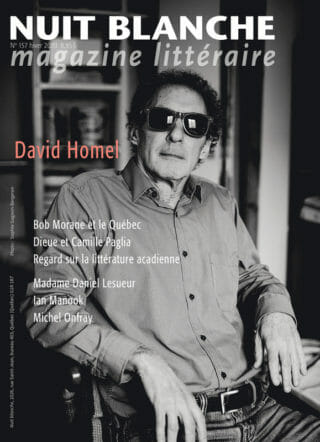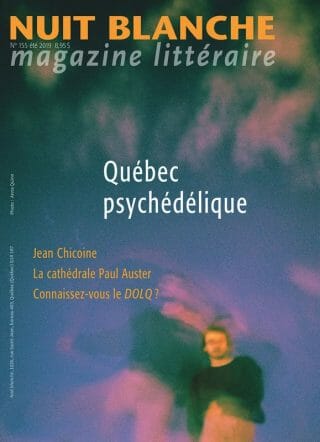Autant on a parlé de Berlin, de ses secteurs, de son Checkpoint Charlie et du mur édifié pour retenir chez eux les Allemands de l’Est, autant Vienne a le plus souvent échappé à de tels battages, tout en vivant elle aussi la compartimentation. Le troisième homme, roman de Graham Greene incarné à l’écran par Orson Welles, devançait Dan Vyleta en faisant de la capitale autrichienne une ville à espions. Une soixantaine d’années après Greene et dans des constructions d’une plus généreuse ampleur, Vyleta fait de Vienne le décor sombre et déroutant, brutal et enchevêtré, de ses reconstitutions historiques, peut-être le plus éloquent de ses personnages.
Le titre du deuxième ouvrage de Vyleta, Fenêtres sur la nuit1, est limpide : c’est en épiant les occupants des appartements voisins et en violant l’intimité révélée par leurs fenêtres éclairées que les personnages du roman amassent leurs renseignements et couvent leurs gestes. Le calendrier a aussi la plus grande importance : 1939. L’année agit en ligne de partage des eaux entre l’irrésistible poussée tellurique du nazisme dans le monde germanophone et son déferlement en colonnes blindées sur les pays voisins. L’intimidation, jusqu’à cette date, se faisait les muscles ; à la menace se substituera désormais l’emploi de la force. Reflétant ce moment charnière, Vyleta peuple son roman tantôt d’humains équipés pour la violence, la cruauté, l’extorsion, tantôt d’individus timorés, indécis, confrontés au mauvais bout de la fourche, tantôt d’êtres en quête d’un centre de gravité.
La pénombre règne, car plusieurs des personnages cultivent l’équivoque, cachent ou bricolent leur feuille de route, mesurent leurs chances de survie ou de domination. Nul n’a complètement la personnalité qu’il affiche : le mime est homme de violence, la femme muette et immobilisée depuis on ne sait quel traumatisme n’est pas victime de mauvais traitements, le médecin à l’écoute des misères est plus frileux et conciliant que l’imprévisible jeune fille à l’échine tordue, etc.
Ce qui, en revanche, est net, c’est que le régime qui se consolide veut en découdre avec les marginaux, les hypothéqués, les inutiles. Qu’un faible d’esprit soit innocent des meurtres récents n’empêche pas qu’il soit un coupable opportun.
Ce n’est pas un précédent littéraire que de proposer un immeuble comme microcosme d’une société. Ce qui distingue celui qu’utilise Vyleta, c’est l’intensité des regards que les occupants portent les uns sur les autres, intensité d’ailleurs vaine. Car si les fenêtres sont multiples, elles ouvrent toutes sur la nuit.
 Dans La servante aux corneilles2, Vienne conserve son empire, mais elle est plus vieille d’une guerre. La mémoire intervient, rarement apaisante, souvent vindicative ou calculatrice ; Vienne retient ou déforme. Même si, par exemple, la rencontre d’Anna Beer et de Robert Seidel dans le compartiment d’un train semble fortuite et promise à l’oubli, il se peut, Vienne aidant, qu’Anna cherche vainement son mari, que Robert se découvre une famille modifiée et qu’ils se revoient. Chose certaine, l’énigmatique Karel Neumann endosse l’avis de Sophie : « Vienne est en train de devenir un terrain de jeu pour l’espionnage », ce qui ne l’empêche pas de participer lui-même à ce sport.
Dans La servante aux corneilles2, Vienne conserve son empire, mais elle est plus vieille d’une guerre. La mémoire intervient, rarement apaisante, souvent vindicative ou calculatrice ; Vienne retient ou déforme. Même si, par exemple, la rencontre d’Anna Beer et de Robert Seidel dans le compartiment d’un train semble fortuite et promise à l’oubli, il se peut, Vienne aidant, qu’Anna cherche vainement son mari, que Robert se découvre une famille modifiée et qu’ils se revoient. Chose certaine, l’énigmatique Karel Neumann endosse l’avis de Sophie : « Vienne est en train de devenir un terrain de jeu pour l’espionnage », ce qui ne l’empêche pas de participer lui-même à ce sport.
Le roman se prend longtemps pour un polar. Certes, le climat lourd et toxique du roman est capiteux, mais le père de Robert est quand même décédé dans des circonstances brumeuses et Vyleta devra, tôt ou tard, révéler l’identité du meurtrier ou la nature de l’accident. Quand, enfin, la révélation émerge, elle est purement verbale, détachée de l’action et même des hypothèses si longuement entretenues.
En fait, les clarifications finales se nattent de façon si complexe que l’auteur doit les accélérer et les morceler en minuscules segments. Cela ne semble pas satisfaire Vyleta, car, même si le récit est clos, il y va d’une « Note de l’auteur » qui équivaut à une véritable postface : « L’année 1948, où se déroule l’action, fut une période de changements, écrit-il. Berlin-Ouest avait été isolée par les Soviets et devait être ravitaillée par avion ; la Tchécoslovaquie était devenue communiste ; on racontait que Vienne grouillait d’espions : la guerre froide avait commencé pour de bon ». Était-ce à ce point secret ou inédit ?
Osera-t-on conclure que Vyleta a si bien recréé la Vienne insaisissable qu’il a rendu ingérable la synthèse finale ? Le titre – La servante aux corneilles – s’en ressent : il ne résume pas le roman aussi justement que le faisait celui de Fenêtres sur la nuit. Roman de belle tenue, mais moins réussi que le précédent.
1. Dan Vyleta, Fenêtres sur la nuit, trad. de l’anglais par Dominique Fortier, Alto, Québec, 2015, 592 p. ; 29,95 $.
2. Dan Vyleta, La servante aux corneilles, trad. de l’anglais par Dominique Fortier, Alto, 2015, 704 p. ; 29,95 $.