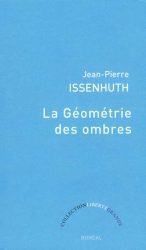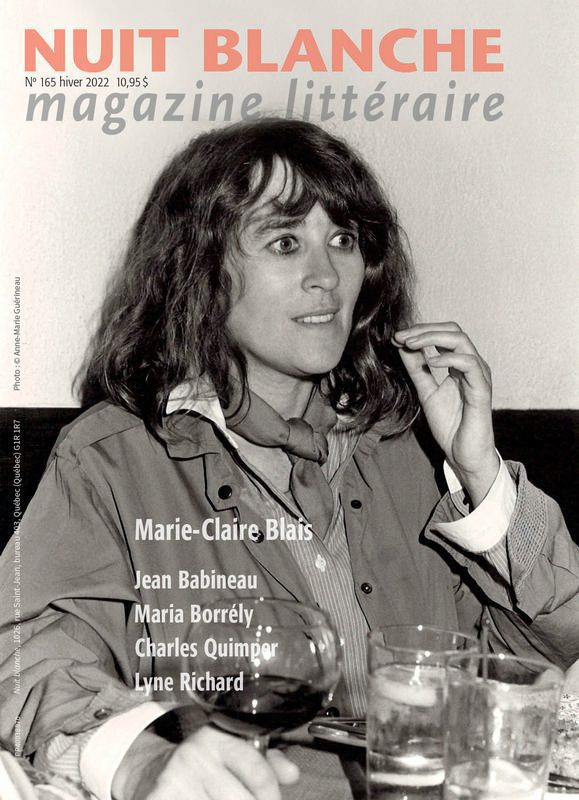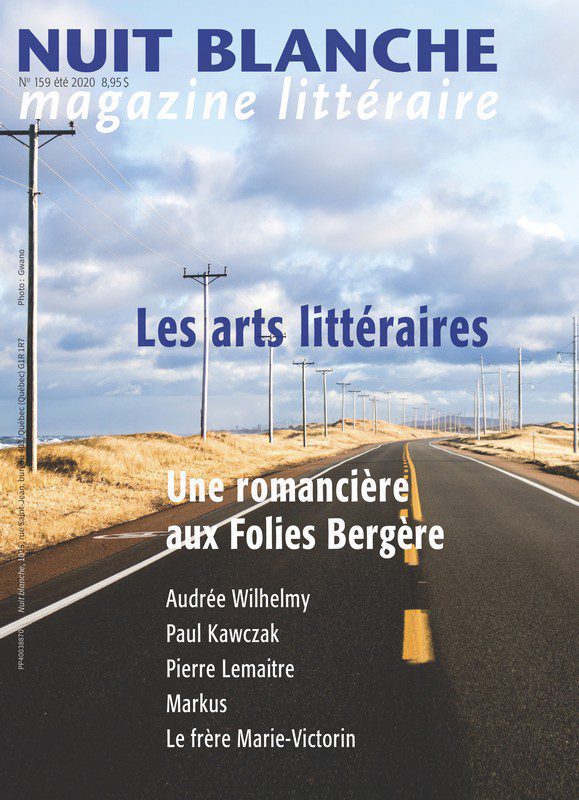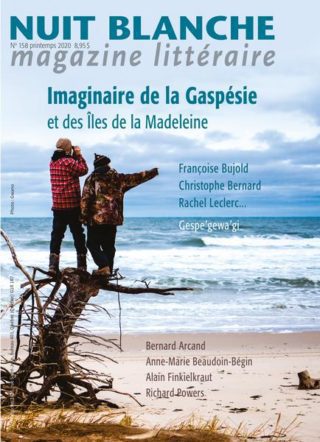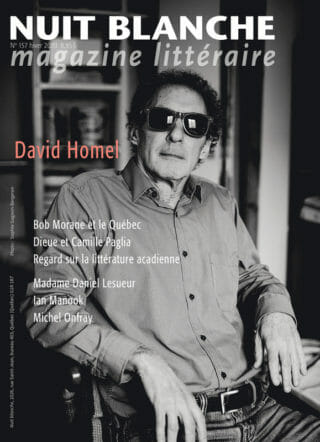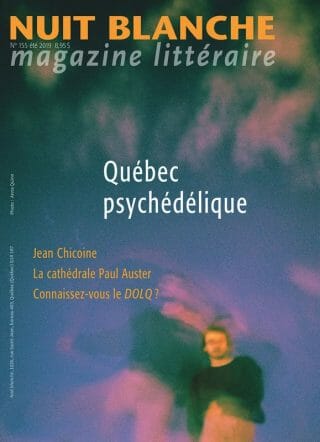Avant d’entrer dans La géométrie des ombres1, jamais je n’avais lu Jean-Pierre Issenhuth, ni sa poésie, ni ses essais, ni ses précédents carnets. Qu’est-ce que j’y ai trouvé ? Beaucoup. Beaucoup trop pour ne pas rougir de mon ignorance. Décédé en 2011, quelques jours seulement après avoir mis la dernière touche à sa Géométrie des ombres, Issenhuth laisse un petit trou dans le paysage des lettres québécoises.
Cet amant de la nature, aussi grand amateur de sciences – jusqu’à préférer parfois à la littérature les écrits purement scientifiques – savait que tout se transforme, se remplace, que ce qui s’en va s’en va autre part. Ainsi, ai-je tenu dans mes mains la matière recomposable d’une voix qui, pour disparue qu’elle puisse être, parle encore dans sa distance. Jusqu’à la fin qu’il pressentait pourtant, presque jamais Issenhuth ne s’épanchera sur sa propre personne, et encore moins sur cette angoisse commune devant la mort. Pessoa écrivait dans son fameux poème « Bureau de tabac » : « Je ne suis rien / Jamais je ne serai rien / Je ne puis vouloir être rien / Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde ». Issenhuth se percevait comme un homme parmi les autres, voire un élément parmi les composantes de la nature et en cela seulement il était indispensable, car pour lui il y aurait dans l’entreprise du monde, « entre tous les participants, une harmonie non concertée, fragmentaire, fantaisiste, mais qui concourt dans le désordre à un but commun ». Le monde, une idée bien large en fait. Issenhuth parle de la terre de son jardin, de l’humus, des arbres, des oiseaux, des insectes, des vers pour lesquels il se passionne au point de déplorer n’avoir lu que quelques livres à leur sujet.
Il s’étonnait constamment de la collaboration entre les éléments de la nature, par exemple de celle entre une espèce de champignons et des arbres ou de celle entre des oiseaux affamés et la terre à cultiver. Ailleurs il dira pourtant qu’il serait vain de chercher une parfaite relation de cause à effet entre les phénomènes, en donnant cette fois pour exemple une expérience agricole entreprise par Masanobu Fukoka, qui remettait en question des dogmes établis en matière d’épandage. Issenhuth n’aimait pas la solidité des opinions, mais il se permettait d’en émettre des tranchées. Car le plus grand livre, selon lui, évoluerait selon un principe de construction-déconstruction, il ne laisserait rien de tangible et permanent, à la manière de toute chose sur terre. Parlant d’un passage dans Ostinato de Louis-René des Forêts, il écrit : « Je me suis longtemps demandé pourquoi cette phrase m’avait atteint. Je crois comprendre, le 22 mars que, contredisant tout le livre, qui n’est guère qu’un écho de soi, cette phrase a été, de la part de Des Forêts, l’indication courtoise de l’endroit où placer les charges de dynamite pour faire sauter son ouvrage avec le moindre effort ». Des Forêts, qui était peut-être trop attentif à ses mouvements intérieurs, aurait donc réussi à se racheter aux yeux de l’écrivain en ridiculisant ces mêmes mouvements dans une seule phrase, qui était : « L’univers n’a de présence réelle que pour qui s’en fait humblement l’écho ».
Il fallait donc que l’écriture se fonde à ce désir de métamorphoses. « C’est dans un livre composé au compte-gouttes, en sautillant comme à la marelle, au gré des surprises du dehors, que j’ai l’impression que l’écrit coïncide le moins mal avec la vie, et donc la représente le mieux. » Il ajoutera plus loin : « Le monde de la liberté de l’esprit est celui de l’infinité des points de vue possibles, et la richesse des points de vue possibles est la conséquence de la richesse inépuisable du dehors ». Qu’est-ce donc au juste que ce dehors ? Est-ce seulement l’air, les lacs, la terre ? Ou bien tout ce qui n’est pas soi, comme les livres ? On pourrait remettre en question cette opposition dehors-dedans, arguant que de telles limites sont fragiles et relatives, du point de vue philosophique notamment, mais ce serait sans doute trop penser à la manière d’un pur littérateur…
Bien qu’il affirme que les écrits ont beaucoup moins d’importance que le réel, qu’ils ne le remplaceront jamais, et même que « [l]e romancier-nourri-de-romans ou le littérateur-exclusivement-nourri-de littérature [a] quelque chose d’anthropophagique », Issenhuth puise lui-même abondamment dans les livres. Oui, ses travaux sur la terre l’occupent beaucoup, mais la lecture aussi semble avoir son importance, vu la quantité d’ouvrages cités dans ses carnets entre février 2010 et mai 2011 – les passages recopiés constituent presque la moitié de La géométrie des ombres. On imagine l’écrivain dans sa cabane au milieu des bois de Laval-Ouest, retranscrivant d’une main froissée tout ce qui ne doit pas être oublié. Durant la dernière année de sa vie, il ne s’intéressera qu’aux écrits de scientifiques ou d’écrivains qui, comme lui, pratiquent un art de la frontière. Aux livres qui, comme le sien, sont fenêtres sur la réalité.
Les livres « littéraires », ceux qui ne laissent pas assez entrer le dehors, eh bien, qu’ils se taisent à jamais, semble dire Issenhuth dans des propos à peine voilés. On s’étonnera de la rigidité d’un homme qui s’est toujours méfié des idées dogmatiques. Mais elles ne sont peut-être que provocations, saines remises en question d’un monde littéraire sclérosé, qui fait du roman la forme ultime, au point qu’on ne peut se dire un écrivain accompli sans avoir tâté du genre. L’auteur, qui travailla au Devoir pendant plusieurs années en tant que critique littéraire, ne ménage d’ailleurs pas le milieu de la littérature québécoise, dont il dénonce le « mythe de la décolonisation culturelle » ou l’art institutionnalisé. « La critique hostile, dira-t-il, est le seul médicament connu contre l’enflure, les hâbleries, les éléments décoratifs, les jongleries sans conséquence. »
« J’ai pour axiome instinctif que ce qui me passe par la tête n’intéresse que moi. Dans ces conditions, pourquoi publier ? » se demande en toute cohérence Issenhuth. Il faut bien le dire, l’auteur semble avoir rédigé ces carnets dans le but d’en faire un jour un livre. Il les rendra en effet publics, dit-il, à cause de la possibilité « qu’une conjonction imprévue survienne, que quelques têtes se reconnaissent fugacement dans la [s]ienne, et pour fournir un aliment à cette possibilité de conjonction ». Chose dite, chose faite.
1. Jean-Pierre Issenhuth, La géométrie des ombres, Boréal, Montréal, 2012, 179 p. ; 22,95 $.
EXTRAITS
Dans les îlots récemment bâtis, elles sont partout, ces allées de cimetière, et de chaque côté, les monuments funéraires sont si hauts et si rapprochés qu’on circule entre des murs gris presque continus d’où dépassent, en hiver, aussi serrés que les maisons, des abris Tempo incolores qu’on dirait des tiroirs de morgue ouverts, avec pour ciel bleu des bacs de recyclage, un jour sur sept.
p. 20
Dans un carnet comme à chaque partie de croquet, la boule frappée par le maillet franchit le même ensemble d’arceaux, mais l’angle d’accès à chaque arceau est toujours légèrement différent. C’est ainsi que mon monde se présente, et j’ignore si ce monde labyrinthique est vraiment habitable par d’autres.
p. 159