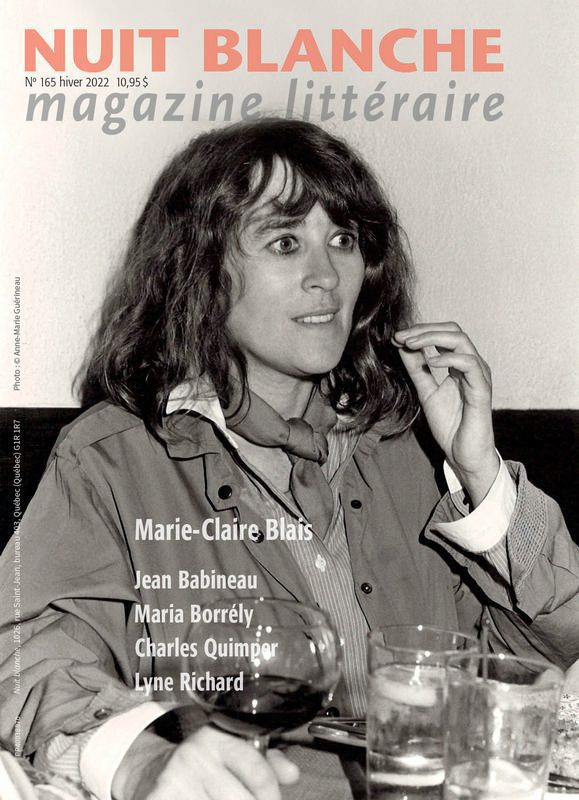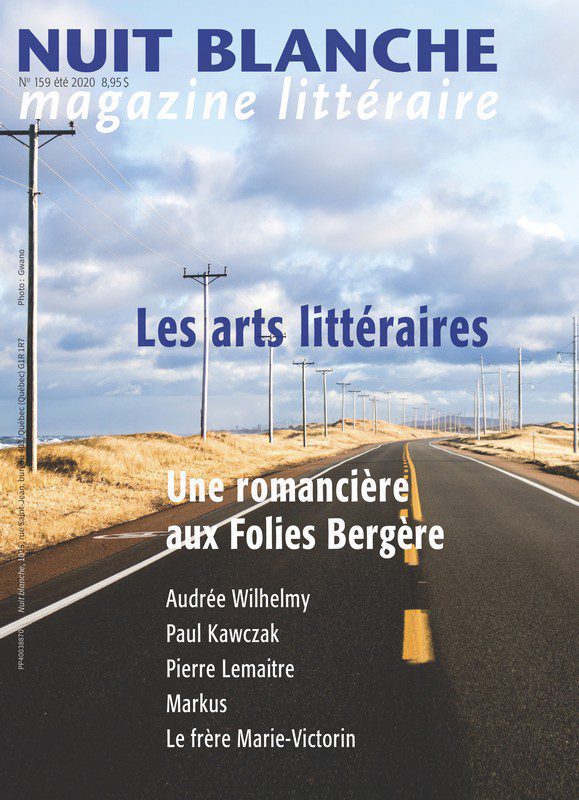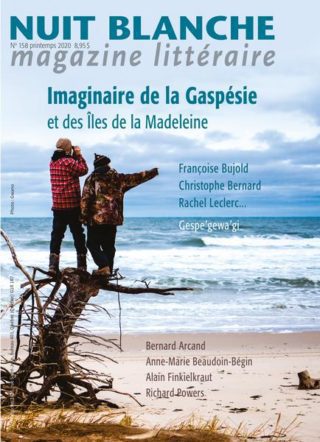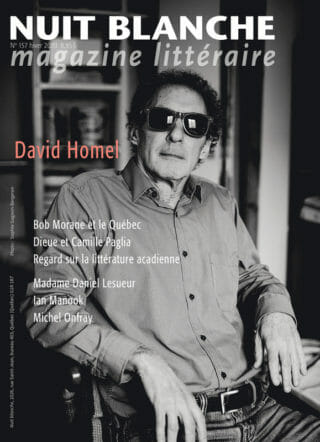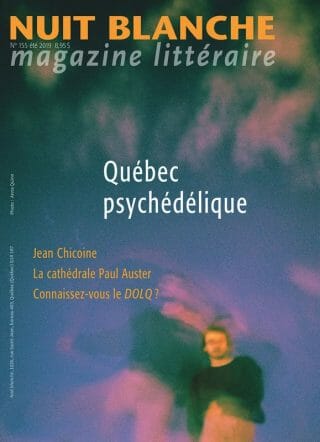Que sait-on aujourd’hui de Rodolphe Dubé – François Heren littérature ? Ce qu’en sait le (bon) bachelier moyen. Au pire : rien. Au mieux : peut-être le titre d’un ou deux ouvrages et que durant une quinzaine d’années cet ancien jésuite a influencé, par son enseignement et son œuvre, un certain nombre d’écrivains et d’intellectuels en herbe.
Mais se souvient-on que, poète, il a aussi touché au roman et au théâtre ? Qu’on doit à ce conteur quelques essais remarqués dans les années 1930 et 1940, et au philosophe des recueils de nouvelles et de contes échappant en grande partie aux catégorisations génériques d’usage ? Bref, on a assurément beaucoup oublié ce qu’ont répété manuels, anthologies et histoires de la littérature au cours des années 1950 et 1960, qui marquent le sommet dans la reconnaissance accordée à François Hertel. Car s’il n’est pas complètement oublié, il est vraisemblablement en voie de l’être ; sa place dans les histoires de la littérature se rétrécissant sans cesse depuis les trente dernières années. Aucun de ses romans, recueils de poésies ou essais ne se trouve à l’heure actuelle en librairie. Parfois radoteuse, parfois sympathique, la biographie un brin vieillotte de Jean Tétreau fournit pour sa part les grandes lignes d’une vie dont le principal intéressé a lui-même livré quelques éléments ça et là, dans des nouvelles, dans certains textes philosophiques, de même que dans des recueils de souvenirs et réflexions.
François Hertel est né en 1905, à Rivière-Ouelle. Après des études au Collège de La Pocatière puis au Séminaire de Trois-Rivières, il entre, en 1925, dans la Société de Jésus, dont il va se retirer progressivement à partir de 1943. Il enseigne tour à tour la philosophie, l’histoire et la littérature dans différents collèges du Québec et de l’Ontario. Après un premier court séjour en 1947, il s’exile en France en 1949, où il demeurera la plus grande partie de sa vie, soit à Paris, soit à Vézelay, effectuant de rares sauts au Canada avant de revenir à Montréal en 1985, où il meurt la même année. Il aura subsisté en partie grâce à de modestes spéculations sur le marché de l’art, en partie grâce à des conférences sur le Canada, dirigeant également des revues culturelles (dont Rythmes et couleurs) et sa propre maison d’édition, les Éditions de la Diaspora française.
Mais toute cette activité et une production abondante ne feront jamais de François Hertel le génie méconnu des lettres québécoises. Oublions donc le génie pour parler d’un écrivain plus que valable, mais inégal, dont l’œuvre comprend du meilleur comme du moins bon. Dans l’ensemble, pourtant, il nous offre ce que peu d’écrivains québécois peuvent proposer jusqu’à lui : une œuvre soutenue, cohérente malgré son caractère disparate. Par exemple, en dépit de la fortune de l’expression et d’un retentissement bien compréhensible à l’époque, son seul roman au sens strict, Le beau risque (1939), se range, il me semble, aux côtés de ces navets plus ou moins sympathiques et digestes dont se nourrissent alors la critique et, à l’occasion (baccalauréat oblige), une partie du lectorat québécois. Je pense à Marie Calumet, à L’influence d’un livre, aux Demi-civilisés, dont on peut dire et penser tout le bien qu’on voudra, qui n’en valent pas moins davantage par le bruit qu’ils suscitent que par la stricte qualité de leur contenu et de leur écriture. Ainsi du Beau risque, qui n’offre aucune surprise cachée, assez banale histoire des tourments existentiels d’un jeune collégien et de leur résolution grâce à l’aide d’un professeur, racontée par le biais du journal intime de l’un et l’autre protagonistes.
En revanche, Mondes chimériques de même que quelques nouvelles et essais méritent une relecture sérieuse. Laquelle, s’agissant de François Hertel, n’ira pas sans plaisirs et étonnements.
L’indéfinissable malaise
« Je suis né au Canada français, dans un pays où règne le dogmatisme philosophico-théologique. Malgré un certain sens critique inné et en dépit de mes efforts pour m’élever au-dessus d’une ambiance de confort intellectuel statique, je finis par me laisser envoûter temporairement par des impératifs catégoriques, dont la base lointaine est une certaine peur d’un Dieu vengeur, toujours en éveil. »
(Vers une sagesse)
À l’heure où ressurgissent la peur du déclin, l’idée de la mort de la culture et un sentiment d’asphyxie généralisée, un retour à François Hertel nous assure au moins la permanence de nos plus actuelles craintes. Ses champs d’intérêt et d’investigation sont nombreux, et on ne saurait réduire sa pensée à une ligne directrice unique, voire à une préoccupation maîtresse. Ses trois premiers essais diffèrent radicalement quant à la manière. Le plus réussi, Leur inquiétude (1936), identifie quelques causes et manifestations de cette inquiétude métaphysique, religieuse ou existentielle, à laquelle s’étaient attaqués avant lui bon nombre d’essayistes, ici ou en France : Paul Archambault (Plaidoyer pour l’inquiétude), Henri Bremond (L’inquiétude religieuse) ou Daniel-Rops (Notre inquiétude). Ce mal du siècle, François Hertel le ramène en dernière instance au besoin de Dieu, quelque nom, précise-t-il, qu’on veuille bien lui donner. Il le voit à l’état brut chez l’adolescent, dont il esquisse un portrait psychologique (repris dans Le Beau risque), avant d’en proposer un bref historique, du XVIIIe siècle aux années 1930. N’étant pas exactement un historien ou un sociologue, il s’attarde principalement à l’imprimé, plus exactement aux œuvres canoniques françaises et européennes, canadiennes aussi, qu’il évalue en fonction de la place qu’elles accordent à ce phénomène. Se gênera-t-il pour renverser quelques idoles au passage ? C’est mal le connaître. L’occasion est trop belle pour lui de régler ses comptes avec quelques joyaux du patrimoine national, et il ne se prive pas d’égratigner. Car des motifs supplémentaires d’inquiétude, il en trouve justement dans l’aliénation politique, économique et culturelle dont les Canadiens français sont les victimes parfois consentantes. Ce faisant, et sans perdre de vue son propos, François Hertel vulgarise efficacement, synthétise les positions et contrepositions sur diverses questions du jour, traitées de manière plus élaborée par les Hermas Bastien, Victor Barbeau, Édouard Montpetit et autres « définisseurs de situation » : l’indépendance du Québec, la langue, l’éducation supérieure, l’accès aux postes-clé au sein du gouvernement et des entreprises privées, les méfaits de la mécanisation et de la société industrielle. Il le fait dans une langue toujours claire, recourant cependant à des formules académiques et une rhétorique assez clinquante. Sa démarche n’est pas exempte de postulats naïfs. Par exemple, sa tentative de circonscrire la psychologie d’un peuple, de mesurer ainsi son degré d’inquiétude, l’amène à identifier une série de qualités et de défauts typiquement canadiens-français, tâche à laquelle il se consacrera également dans Nous ferons l’avenir (1945), recueil de conférences où il montre que nos façons de faire et de penser procèdent de notre double provenance, française par l’histoire et américaine par la géographie. D’un accès moins aisé que les deux autres, Pour un ordre personnaliste (1942) est le plus théorique et le plus systématique de tous ses essais. Il y propose une conception du personnalisme inspirée de Jacques Maritain et Emmanuel Mounier et encore redevable au thomisme.
Penser la pensée, feindre la fiction
« Ce livre [Mondes chimériques] est évidemment l’œuvre d’un fou. Rien des convenances littéraires et des lois du genre n’y est respecté. C’est un livre inclassable, par conséquent infect. » (Henri Francostel – pseudonyme de Hertel –
dans la revue Amérique française)
L’œuvre narrative, en particulier la trilogie des Mondes chimériques (Mondes chimériques, 1940; Anatole Laplante, curieux homme, 1944; et Journal d’Anatole Laplante, 1947), n’élude pas les questions nationales, mais elle accorde plus d’importance aux problèmes du moi et de ses avatars, des va-et-vient entre fiction et réalité, de même qu’elle soulève des questions proprement génériques. Un critique résumait assez bien, en 1954, l’impression générale produite sur le lecteur : « Je pense que nous sommes, ici, à la frontière du roman et de l’essai car, si minime soit-elle, il y a dans cette série une part de roman ou tout au moins de récit romancé. Anatole Laplante et Charles Lepic pénètrent bien dans le monde sous la forme de personnages de roman, même si l’on doit admettre que Le Journal d’Anatole Laplante est surtout, sinon uniquement un essai.1 » Gérard Bessette synthétisera plus tard la position des historiens de la littérature lorsqu’il situera la trilogie « à mi-chemin entre le roman, le recueil de nouvelles et l’essai ». Difficile de résumer Mondes chimériques2, recueil hybride dont les textes, toujours brefs, nouvelles ou dialogues, contes ou extraits de journal, présentent entre eux des liens tantôt ténus, voire inexistants, tantôt plus apparents, un peu à l’image de la fragmentation du sujet psychologique à laquelle se livre l’écrivain. Cette histoire de la rencontre de deux esprits, Charles Lepic et Anatole Laplante, et du parcours (intellectuel, surtout) que chacun suivra, est livrée à travers leurs propos sur des questions et des expériences tantôt quotidiennes, tantôt inusitées. On verrait sans peine, dans la tension entre ces deux ombres, la réfraction du déchirement de François Hertel lui-même, qui notait, mi-badin, mi-sérieux : « De même que Mondes chimériques ne fut jamais un recueil de contes – crois-m’en, ô lecteur canadien ! – mais l’histoire des pensées de Charles Lepic s’accompagnant de menues réactions chez Anatole Laplante, ainsi le présent ouvrage [Anatole Laplante, curieux homme] est-il l’histoire intérieure d’Anatole Laplante qui continue d’évoluer et de naître au monde, grâce à l’entrée continuelle en lui du monde par la connaissance et le contact des êtres. » Le troisième tome, quant à lui, basculera nettement dans l’essai (dont certains passages seront approfondis plus tard), jusqu’à effacer toute trace de fabulation.
Il entre ainsi un peu d’Edmond Teste dans les personnages de Lepic et Laplante, suffisamment désincarnés et abstraits pour que le lecteur n’adhère jamais pleinement à cette sorte de « roman d’un cerveau », dont l’idée préoccupait Valéry. On était loin, il est vrai, du roman psychologique alors pratiqué par les Robert Charbonneau, André Giroux et Robert Élie. L’absence marquée d’un personnage central doté d’une psychologie romanesque claire (malgré le fait qu’il soit beaucoup question de psychologie), de même que le défaut d’un cadre et d’une intrigue bien nets, caractéristiques du roman réaliste, ont d’ailleurs laissé un peu embarrassés les critiques, dont plusieurs se sont contentés de décrier le résultat plutôt que de chercher à voir les mécanismes rattachant, chez l’auteur, l’essai aux formes narratives de la nouvelle et du conte3. François Hertel n’a pas été le seul à explorer cette voie, des reproches similaires allèrent à Jean Simard et à Pierre Baillargeon, dont les historiens ont vu les liens qui les rattachaient à leur aîné de quelques années. On songe également au Nézon de Réal Benoît, distinct par son contenu, mais proche par sa mise en relief des ficelles du récit, la fantaisie du propos et une critique en acte du conformisme romanesque4. Je ne saurais préciser l’origine de ce travail sur les formes et les genres littéraires, ce goût manifeste de François Hertel pour la subversion formelle5. Maladresses heureuses ou ingéniosité ? Quand il écrit : « Mon grand procédé, c’est de n’en pas avoir », je n’ai pas de peine à le croire. Qu’il s’essaie à l’histoire hypothétique ou revisitée, ou qu’il pratique à sa manière le dialogue philosophique, on démêle difficilement chez lui la part de réussite et la part d’inachevé, d’approximation, d’expérimentation aussi. Sans oublier qu’il nous livre à l’occasion des nouvelles de facture plutôt conventionnelle. Amateur de paradoxes, provocateur, il joue le plus souvent délibérément des conventions génériques alors en cours, comme en témoignent ses récits, mais également ses préfaces. Ainsi lit-on dans « La danse des personnages » : « Il faudra terminer la trilogie – qui n’est nullement un essai, ni des contes, mais un roman fleuve ou simplement rivière, si l’on préfère […]. »
Par ailleurs, d’édition en réédition les recueils et récits vont se voir autrement organisés et désignés. Telles nouvelles deviendront, lors d’une réédition, autant de chapitres d’un « roman » inédit. Les divers intitulés génériques utilisés par Hertel (Nouvelles, Romans, Contes, Récits, Mémoires imaginaires) apparaissent interchangeables dans la mesure où sont réutilisés et redistribués au fil des ans les courts textes narratifs qu’ils chapeautent, ces repiquages et variations, voulus, admis, constituant ce qu’on pourrait appeler une poétique de la reprise. La fragilité de tout l’édifice est d’autant grande que la fiction elle-même se remet constamment en question, soit par des chutes sorties de nulle part ou des incipit inattendus (« Soudain, Charles Lepic fut à mes côtés. » Ainsi s’ouvre une nouvelle des Mondes chimériques), soit par des interventions d’auteur ostentatoires : « À ce moment de notre récit, puisque tout va mourir et qu’il faudra bientôt mettre le point final, moi au plaisir d’écrire, et vous, lecteur, je n’en doute pas, à la joie de me lire […] ». Qui peut tracer très exactement les limites, chez Hertel nouvelliste, entre l’art et l’artifice ? Quoi qu’il en soit de ces traits, ils confèrent à l’œuvre sa fraîcheur ; le décousu, la facilité alors fustigés, prennent aujourd’hui des airs d’audace et de ludisme. Le recyclage hertellien est au goût du jour… Nous avons en quelque sorte rattrapé Hertel, dont l’avant-gardisme ne fait aucun doute pour Robert Vigneault (voir le compte rendu du numéro consacré à Hertel les Cahiers Éthier-Blais).
Voir clair en soi-même
« Comme tous ceux qui se sont avisés de chercher, j’ai d’abord trouvé des solutions toutes faites, qui se sont offertes à moi comme des impératifs catégoriques. Je me suis cru obligé de penser comme tout le monde, parce que j’étais modeste et que je sentais que mon regard sur le monde n’était pas valable. D’autres m’ont offert des découvertes, des explications fort prétentieuses. J’ai eu l’extrême naïveté de me livrer aux bêtes. J’ai mis quarante années de ma vie à leur échapper. »
(Journal philosophique et littéraire)
Ce repiquage, il le pratique également du côté de l’essai philosophique seconde manière, celui de ces recueils où les fragments argumentatifs côtoient l’autobiographie et la critique littéraire. Les trois principaux, Vers une sagesse (1966), Méditations philosophiques (1962) et le Journal philosophique et littéraire (1961), conjugueront ainsi inédits et textes antérieurs. C’est la forme vers laquelle tendait déjà la deuxième partie du Journal d’Anatole Laplante, qui contient certains des essais utilisés ultérieurement. On y trouve du meilleur Hertel. À travers une mise en fiction du cas Ludivine Lachance, enfant sourde, muette et aveugle, le « Petit traité du dedans » se penche sur la notion de signe et les rapports entre pensée et langage. Par la forme, la prose et l’exercice même auquel il se livre, il rappelle avantageusement Valéry. Ne dirait-on pas empruntée à l’auteur de Tel Quel cette pensée : « Les grandes trouvailles sont filles de la distraction, expressions profondes de la personne libérée des entraves de la raison raisonnante » ? L’excellente « Lettre ouverte aux hommes d’ordre » aussi bien que l’« Examen de conscience philosophique » sont d’un écrivain et penseur mûr, encore déchiré, pas tout à fait dépris des thèses énoncées dans Pour un ordre personnaliste, luttant contre l’esprit de système, rappelant, à cet égard, Kierkegaard, par son refus des conventions, son désir flagrant de remuer les esprits et, surtout, cette philosophie au « je », toujours au plus près de l’expérience quotidienne, s’appuyant sur la raison pour pourfendre la raison raisonnante, instrument grossier dès lors qu’elle s’applique à comprendre le moi et sa place dans le cosmos. Pour le reste, le penseur reste fortement cartésien.
Avec Kierkegaard, il partage également sa situation d’exilé, d’abord chez lui, puis au dehors à partir de 1949. Mondes chimériques anticipait d’ailleurs les départs, évasions et exils; comme Charles Lepic, François Hertel a voyagé, en Russie, en Chine, en Europe. L’ennemi de cet essayiste et philosophe, n’est-ce pas la certitude, le confort, l’immobilisme aussi bien intellectuel que politique qu’il dénonce chez ses concitoyens ? L’attitude qu’il juge féconde, l’inquiétude, il l’ajoute au doute, envers soi, envers ses propres convictions, puis envers tout échafaudage qui se prétendra seul détenteur de la vérité. Ses détours par le personnalisme, l’existentialisme, le surréalisme et la psychanalyse, s’ils sont parfois un peu rapides, peut-être réducteurs, n’en témoignent pas moins d’une curiosité et d’une audace rares dans « une culture qui a détruit le goût et le sens de l’expérimentation et du cheminement », écrira Pierre Vadeboncœur6.
Des essais de la maturité jusqu’à Mystère cosmique et condition humaine (1975), dans lequel il voyait sa somme philosophique et qui reprend lui aussi, en les adaptant, des fragments anciens, il se livre donc surtout à un « exercice d’écriture à la première personne, libre dans son cheminement, sa forme et sa dynamique7 ». Écrivain, au sens que donnait à ce terme Michel Leiris (« quiconque aime penser une plume à la main »), il s’intéresse principalement à sa propre évolution spirituelle et intellectuelle, c’est-à-dire au parcours de cet esprit extrêmement souple qui fut le sien, accueillant, en constante transformation. Par à-coups, toujours, explorant successivement des questions sans lien apparent, s’essayant aux sujets les plus éloignés (Claudel, mais aussi Einstein; la métaphysique aussi bien que les sciences occultes ; le couple, le bonheur, la foi), l’essayiste prospecte, sûr chaque fois de se retrouver. Assurément, il s’est voulu un penseur complet et un maître à penser ; témoins, ses incursions en territoires multiples, son intérêt pour les questions d’actualité. De même, il s’est un peu complu dans le rôle de chef de file qu’il fut un temps, et qu’il devait se désoler de n’être plus, si l’on en juge par les repentirs et réserves manifestes dans ses derniers écrits. Ses lecteurs, tout ce temps, d’un ouvrage à l’autre, ont eu accès à des éléments autobiographiques de même qu’à des tranches d’un itinéraire intellectuel l’ayant conduit d’une adhésion critique au thomisme à une forme personnelle d’existentialisme, puis à ce qu’il qualifiera de « nihilisme souriant ». Car jamais François Hertel, du moins le prétendra-t-il plusieurs années plus tard, n’aura eu la certitude de croire : « La veille de mon ordination, je me précipitai chez mon supérieur, et lui avouai que je ne croyais plus croire. Il s’écria : – Mon cher, c’est très beau de se sentir indigne. Vous êtes un privilégié. – Je franchis le pas8. »
1. Dostaler O’Leary, Le roman canadien-français , Le Cercle du livre de France, Montréal, 1954, p. 167.
2. Significativement intitulé « Deux hommes en nous », dans certaines éditions.
3. Il reste à venir une étude développée sur cette question à laquelle Laurent Mailhot (voir dans le compte rendu du numéro des Cahiers Éthier-Blais consacrés à François Hertel) livre trop peu d’éléments de réponse.
4. À ma connaissance, on a peu étudié cette littérature fantaisiste, occultée historiquement par les romans « urbains » (Gabrielle Roy, Roger Lemelin), le roman psychologique déjà mentionné et les derniers soupirs du roman de la terre (Ringuet, Germaine Guèvremont). Les dialogues philosophiques du Siraf (1934) de Georges Bugnet en sont un exemple.
5. Notons qu’il en va de même de sa production poétique, que ses formes rapprochent parfois de la prose essayistique, et dont le contenu souvent explicitement philosophique n’interdit pas le lyrisme. Jean Éthier-Blais et Pierre de Grandpré écrivaient à ce propos : « Ce sont des artifices de définition qui permettent de ranger François Hertel parmi les poètes » (Pierre de Grandpré, Histoire de la littérature française du Québec, t. 2 (1900-1945), Beauchemin, Montréal, 1968, p. 230.
6. Pierre Vadeboncur, La ligne du risque, HMH, Montréal, 1963, p. 167.
7. Guylaine Massoutre, « Les canons de l’exilé », dans La pensée composée, sous la dir. de François Dumont, Nota bene, Québec, 1999, p. 140.
8. François Hertel, Souvenirs et impressions du premier âge, du deuxième âge, du troisième âge, Stanké, Montréal, 1977. La perplexité de Robert Vigneault (voir compte rendu des Cahiers Ethier-Blais) quant aux rapports de François Hertel à la foi, à Dieu et au spirituel de manière plus générale, est tout à fait justifiée.