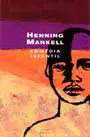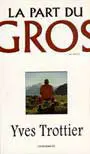« La culture créative est un liant social qui donne espoir aux épreuves de l’existence, alors que la culture passive est une distraction qui fait passer le temps, mais ne résout rien. Pour que la culture offre des tuteurs de résilience, il faut engendrer des acteurs bien plus que des spectateurs. »
Boris Cyrulnik, Les vilains petits canards, Odile Jacob, 2001.
Quand on est du métier, qu’on se consacre à la tâche de communiquer le goût de lire, ses propres lectures sont dirigées : des livres s’imposent par leur actualité, leur singularité, les réactions qu’ils suscitent, les débats qui les entourent. D’un livre choc à un autre, du coup de cSur de l’un au scandale de l’autre, la provocation est constante et l’on se voit conscrit de toutes parts par ce qu’on se doit de connaître pour informer le mieux possible.
Lorsque se desserre l’étau des contraintes d’efficacité maximale, nous nous accordons le plaisir, jusque-là reporté, d’explorer le rayon des laissés-pour-compte de notre bibliothèque, là où se retrouvent, entre autres, les choix des personnes qui nous sont suffisamment proches pour savoir à coup sûr combler nos attentes.
C’est ainsi que j’ai eu la grande surprise de découvrir un Simone de Beauvoir qui a éveillé chez moi un retour d’admiration pour l’écrivaine, pour l’étendue de sa culture, pour sa hauteur de vue. Tous les hommes sont mortels est un grand Simone de Beauvoir. Si le roman fait appel à l’histoire pour nourrir son propos, celui-ci est surtout une réflexion philosophique sur le destin « mortel » de l’homme. Au terme de la lecture, on reconnaît, avec les protagonistes que la mort n’épargnera pas, que le fait d’être mortel donne un sens à la vie, car l’immortalité est un don terrible, il isole celui qui le reçoit et lui laisse tout loisir de découvrir l’inanité des actions humaines… qui sont pourtant la matière même de la vie et la rendent précieuse. À la limite, nos illusions donneraient sens à notre vie ? Question ouverte.
Autre livre, un roman construit celui-là sur une réalité récente parmi les plus terribles de ce siècle, L’analyste de David Homel la recrée dans ses aspects les plus dérangeants, la faisant surgir presque à chaque détour du quotidien ; en ressort cependant des moments élargis de sens pour certaines de ses victimes. L’action se passe dans la Serbie de Milosevic et l’horreur vécue par les protagonistes est insoutenable.
Pourtant, malgré les atrocités commises sans retenue, le tableau d’une finesse qui ne lui enlève rien de sa virulence, ouvre sur un espoir porté à bout de bras par le narrateur, qui navigue au jugé dans la tempête mais conserve des exigences morales. Chacun peut, s’il le veut, s’égarer par moments.
Il faut beaucoup de courage et de détermination pour se tenir debout, s’opposer, se compromettre, ne pas abdiquer.
La leçon de ce siècle « civilisé » qui promettait tout autre chose est peut-être là : personne ne doit démissionner. L’individualisme est trop souvent prédateur, mais l’action de chacun est nécessaire pour maintenir les digues en place. NB