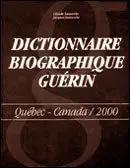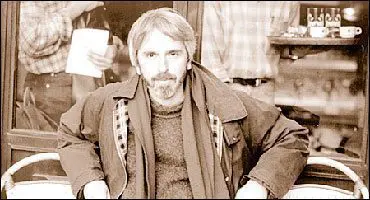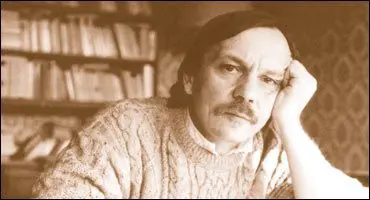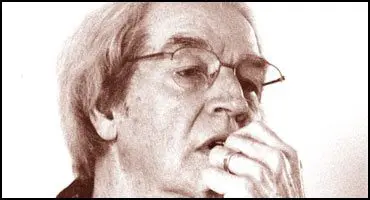Dictionnaire biographique Guérin, un nouveau dictionnaire : Apports et limites
Au printemps 1998, les romanciers et essayistes Claude et Jacques Lamarche ont accepté la proposition de l’éditeur Guérin de « rédiger une biographie concise de toutes les personnes (décédées) qui, depuis la découverte du Canada, ont… Dictionnaire biographique Guérin, un nouveau dictionnaire : Apports et limites