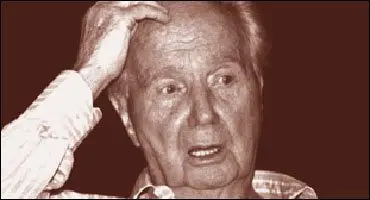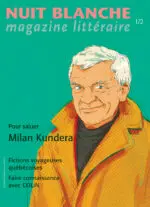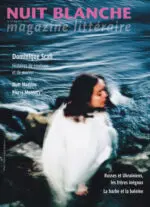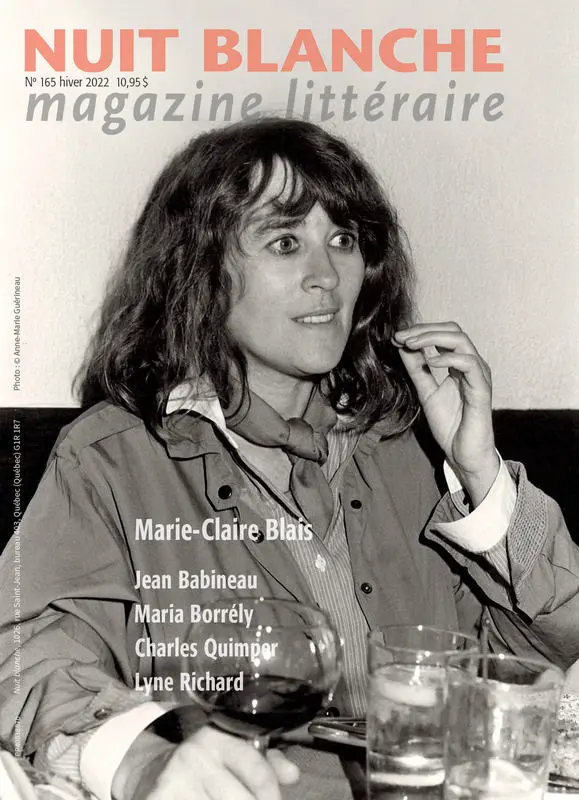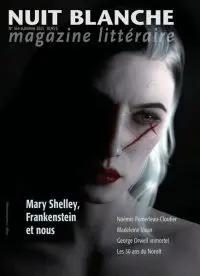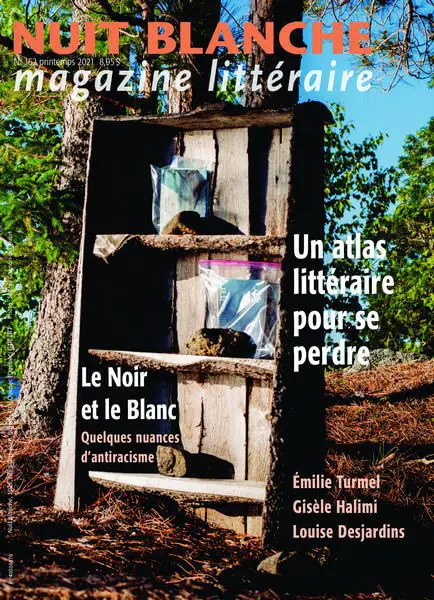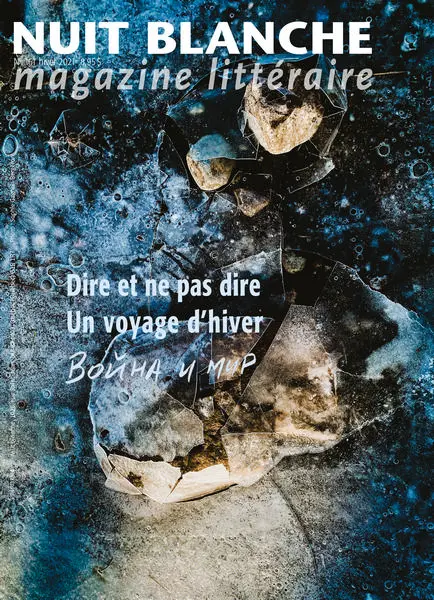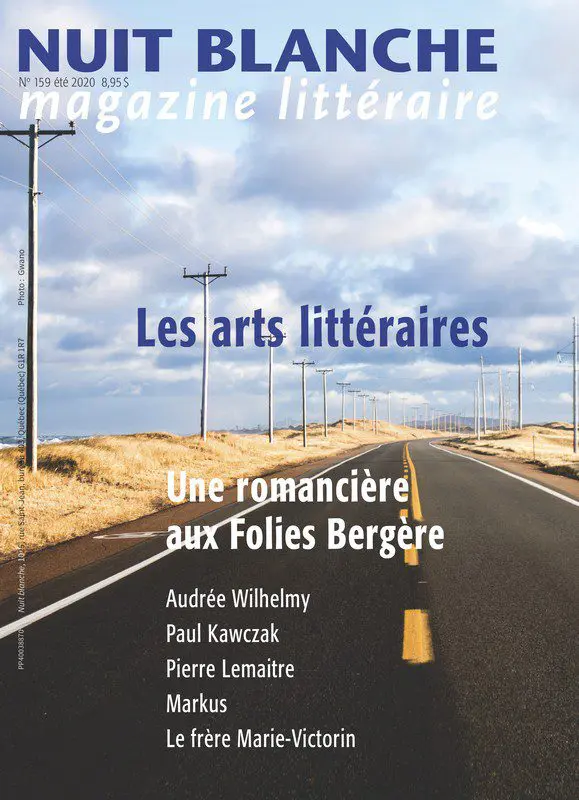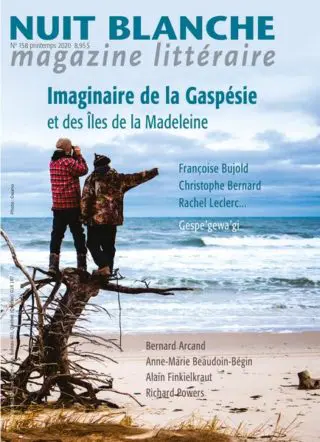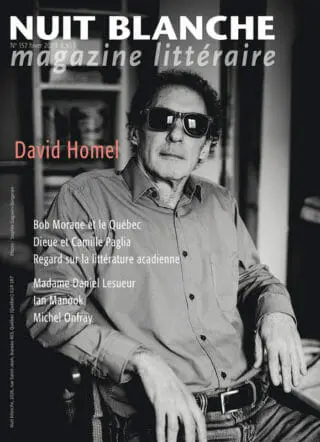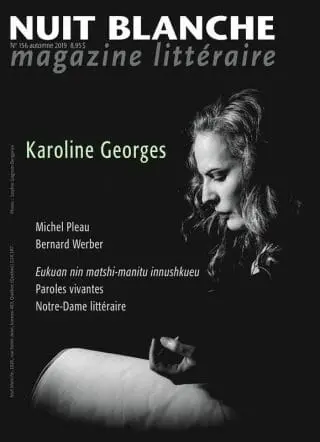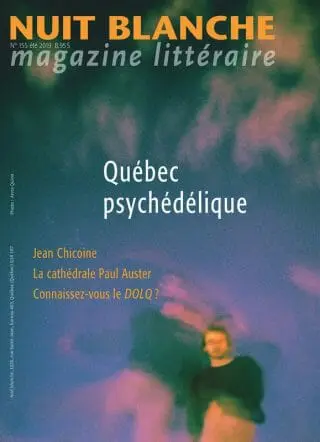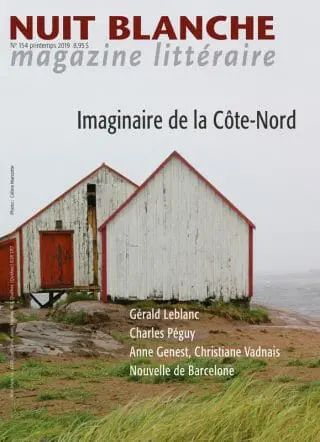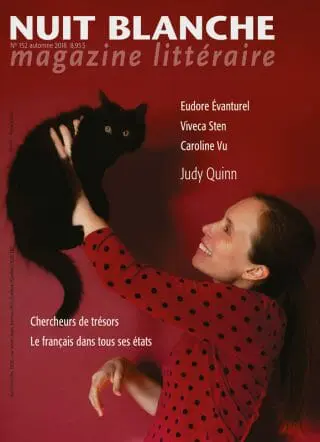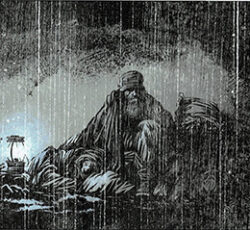Robert Merle est né en 1908 à Tebessa en Algérie. D’abord attiré par la philosophie qu’il juge bien vite un peu stérile, « jeu verbal où l’on ne dit pas nécessairement des choses exactes, mais où on peut être brillant à peu de frais », il entreprend une agrégation d’anglais ; sa thèse de doctorat porte sur Oscar Wilde.
Sa participation à la retraite de Dunkerque de 1944, en tant qu’agent de liaison auprès de l’armée britannique, lui fournit la matière de son premier roman, Week-end à Zuydcoote, mis en chantier au retour de trois années de captivité. Paru en 1949, le livre reçoit le Prix Goncourt, son adaptation cinématographique, avec Jean-Paul Belmondo, remporte un grand succès populaire.
Ayant fait le choix de la voie universitaire, Robert Merle a enseigné dans les facultés de Rennes, d’Alger au lendemain même de l’indépendance, de Toulouse et de Paris-Nanterre où il était en poste en mai 1968. Derrière la vitre restitue le climat de cette université nouvelle qui ressemblait alors à un vaste chantier entouré de terrains vagues. En 1969, il demande un congé pour se consacrer entièrement à la littérature.
Par sa formation linguistique, il s’intéresse à la communication animale qu’il aborde dans deux romans très rigoureusement documentés : Un animal doué de raison (les dauphins qui parlent) et Le propre de l’homme (la communication avec les chimpanzés).
L’obsession de l’intolérance, du totalitarisme, du charlatanisme, de l’univers concentrationnaire transparaît fréquemment dans son Suvre ; il n’a jamais cessé de s’intéresser aux hommes qui ont lutté contre le colonialisme et pour plus de justice sociale. Il avoue avoir pour personnage historique favori Hô Chi Minh. Il a consacré un livre à Ben Bella, à partir d’une documentation directement fournie par le premier président de l’Algérie indépendante, un autre à Fidel Castro et a préfacé la traduction française des Souvenirs de Che Guevara.
L’écrivain et l’enseignant
Nuit blanche : Vous n’avez pratiquement jamais cessé de mener de front votre carrière littéraire et votre métier d’enseignant. Dans quelle mesure ces deux activités sont-elles complémentaires ?
Robert Merle : Du temps où j’étais professeur de faculté, nous devions assurer trois heures de cours par semaine. Je préparais bien mes cours et lorsqu’il y avait des copies à corriger, je le faisais même avec une certaine conscience. Le reste du temps nous devions faire de la recherche. Une fois la thèse terminée et soutenue, cela nous laissait un temps considérable. Certains publiaient des traductions. Moi, j’écrivais des romans. J’étais chargé de conférence, je suis devenu professeur titulaire tout de suite après ma thèse en 1948. J’ai pu consacrer beaucoup de temps à mes romans tout en bénéficiant d’une sécurité matérielle. À Nanterre, j’étais même arrivé à regrouper mes trois heures sur une seule journée. Je pouvais vraiment me consacrer à l’écriture.
Vous n’êtes guère tendre avec l’université française. Dans Derrière la vitre, vous dénoncez le système du mandarinat et la thèse de doctorat. Vous écrivez de l’enseignement supérieur : « C’est un milieu où les vanités sont démesurées, les blessures d’amour-propre inguérissables, et les haines démentes ». Vous vous attaquez aussi à l’arbitraire des promotions.
R. M. : À ce moment-là, je voyais de près ce qui se passait. L’atmosphère n’était vraiment pas bonne. Il y avait des tensions. Les assistants se plaignaient d’être les esclaves de professeurs un peu trop « mandarins » qui exerçaient un pouvoir quasi dictatorial. Ce qui était vrai. Ce que je trouvais merveilleux dans mon travail, c’était le rapport avec les étudiants. Je les invitais chez moi chaque année. En Angleterre, ce n’est pas rare, mais en France cela semblait inconcevable. J’étais presque le seul à entretenir ce type de relations.
Le Prix Goncourt
Vous avez eu le Prix Goncourt pour votre premier roman. Qu’est-ce que cela représente pour un jeune romancier ? N’est-ce pas l’encouragement décisif ?
R. M. : Mon prix Goncourt a été acquis par neuf voix sur dix, la dixième allant au Jeu de patience de Louis Guilloux*, qui a obtenu par ailleurs le Renaudot. Auparavant, il avait écrit Le sang noir, qui, à mon avis est un chef-d’Suvre. Louis Guilloux est un écrivain dont on pourrait parler un peu plus qu’on ne le fait. Je me suis donc réveillé célèbre, avec mon nom dans tous les journaux. On parlait de moi à la radio. Il n’y avait pas encore vraiment la télévision. Et puis il y a eu le scandale. Certains trouvaient mon livre d’une pornographie insoutenable. Le curé de Zuydcoote a brûlé mon livre en public. Il a même mené une enquête pour savoir quelles étaient les dévergondées qui avaient servi de modèles. Il avait interdit à la mercière qui diffusait quelques livres de vendre le mien. Mais il y avait aussi un parti anticlérical farouche, aussi farouche que les catholiques, mené par le boulanger. Il achetait mes livres pour les vendre à ses concitoyens. Et voilà comment, localement, Week-end à Zuydcoote s’est vendu « comme des petits pains ». Du point de vue financier, ça m’a permis de résoudre des problèmes familiaux terribles. Avec l’argent du Goncourt, j’ai pu acheter un appartement pour ma mère, et prendre deux ans de congé pour écrire La mort est mon métier.
Avez-vous par la suite été sollicité pour faire partie d’une Académie, Goncourt ou autre ?
R. M. : Au moment où je cherchais à quitter Gallimard, dont j’avais du mal à supporter l’incroyable radinerie, un autre éditeur qui m’avait contacté m’avait conseillé de devenir académicien. Il aurait gagné deux choses : un écrivain déjà célèbre et un membre de l’Académie Goncourt. J’ai été sollicité. Dans la mesure où il n’y avait pas de campagne à faire, j’aurais accepté. Mais finalement, Hervé Bazin n’y tenait pas. Quant à l’Académie française, on n’y fait pas grand chose. Les académiciens ne font même plus le dictionnaire. Ce n’est pas très sérieux. Ils se réunissent de temps en temps pour savoir si l’on va ou non accepter des mots comme « midinette » ou « pinard » dans la langue française. Ils ont accepté « pinard » mais rejeté « midinette » qui ne s’en porte pas plus mal. Comme ils ont enfin compris que ce n’est pas parce qu’on est bon écrivain qu’on fait un bon dictionnaire, ils ont fini par embaucher des linguistes. Ça ne vaudra jamais le Robert qui dispose de collaborateurs permanents.
L’humaniste, ami de Montaigne
Votre œuvre romanesque ne cesse de dénoncer toutes les formes de totalitarisme et d’intolérance et la plupart de vos héros luttent pour une société plus juste et plus humaine. Avez-vous, comme Camus, dont vous ne supportez pas L’étranger, le sentiment qu’écrire oblige à assumer une certaine responsabilité ?
R. M. : Certainement. Savez-vous quelle est la raison pour laquelle je ne supporte pas L’étranger ? L’histoire n’est pas crédible. Jamais, pendant l’époque coloniale, même la plus proche de nous, un Français n’aurait été condamné à mort pour avoir tué d’une balle de revolver un Arabe armé d’un couteau et qui, de plus, était un souteneur notoire. Il aurait pris tout au plus quelques mois de prison avec sursis. Le faire condamner à mort est d’une absurdité totale. C’est dommage parce que le roman, dans l’évocation de la vie quotidienne à Alger, est très bon. C’est un roman plein d’odeurs, de senteurs, seulement, il y a cette fin stupide. Ça m’a d’autant plus choqué que Camus était parfaitement conscient de ces problèmes.
Chez vous certains passages ont un aspect didactique qui nous aide à comprendre ce qui se passe à notre époque. Je pense à Alizon, ce personnage de Paris, ma bonne ville à travers lequel on croirait voir comment pénètrent les idées du Front National.
R. M. : Ces passages peuvent effectivement servir à alimenter une réflexion sur le monde contemporain. Une journaliste, qui s’est infiltrée dans le Front National, a écrit un livre très intéressant. Elle ne ménage pas les élites mais reconnaît qu’il y a parmi les militants de la base de braves gens qui sont fascistes sans le savoir. C’est le cas d’Alizon.
Dans Le propre de l’homme, vous évoquez Montaigne. Pierre de Siorac, dans Fortune de France, fait halte à son château. Représente-t-il un idéal pour l’humaniste que vous êtes ?
R. M. : Je ne pouvais pas éviter Montaigne. D’abord, il est à la limite du Périgord et du Bordelais. C’est un écrivain immense. J’ai visité plusieurs fois son château. Fils de marranes** convertis de force, il était en matière de religion très sceptique. Pour satisfaire à l’obligation d’« ouïr la messe », il y avait une cheminée qui partait de la chapelle et montait jusqu’à son bureau. Le chapelain venait dire la messe. Montaigne disait : « Je ne peux pas descendre à cause de mes jambes, mais j’ai ouï la messe ». C’était vrai, il oyait la messe sans se donner la peine d’y assister. Dans En nos vertes années, il y a un pharmacien de Montpellier qui est marrane. Je donne, je crois, une description tout à fait juste de la vie des marranes en France. Ils allaient à la messe par obligation mais ils ne mangeaient pas de viande de porc. Pour ne pas éveiller la suspicion des voisins, ils en achetaient pour le donner aux chiens. Le samedi, pour faire croire qu’ils faisaient la cuisine, ils allumaient du feu dans les cheminées. Montaigne avait un frère protestant mais lui-même était bien trop prudent et bien trop sage pour prendre ce genre de risque. Il disait : « Je suis de la religion de mon roi ». Son style aussi est intéressant, teinté de périgordismes et de langue d’oc. Ça le rend très fruité, très savoureux, mais bien sûr tout le monde ne peut pas lire Montaigne.
Le romancier
Vos romans sont à la fois longuement mûris et très précisément documentés. Pourquoi ce souci de rigueur et d’exactitude ?
R. M. : Il y a toujours un travail de documentation. On n’invente pas la vie, on l’observe. Cela n’empêche pas que j’utilise mon imagination mais à partir de faits. Je ne suis pas naturaliste mais je pense qu’un bon roman doit donner l’impression que l’auteur connaît à fond ce dont il parle. Après, il y a le métier, le talent, mais d’abord la documentation. La mort est mon métier est devenu un classique à cause de la façon très rigoureuse de procéder et de traiter le thème. J’ai fait ce livre à partir des archives de Nuremberg. Elles sont en allemand, langue que je connaissais et que j’avais pu pratiquer pendant ma captivité. J’ai passé quatre mois à les dépouiller. Ce livre a été très ingrat à écrire parce que la personnalité de Rudolf Hoess, le commandant d’Auschwitz – qu’il ne faut pas confondre avec Rudolf Hess – était une personnalité complètement déshumanisée, robotisée, avec une sensibilité complètement atrophiée et une extrême rigidité dans l’application du devoir. S’identifier à un tel personnage était impossible. Lors de son procès, le président du tribunal polonais lui a demandé : « Et ce travail que vous faisiez (il a gazé deux millions et demi de personnes), qu’en pensiez-vous ? » Il a répondu : « C’était un travail ennuyeux. » Il avait reçu un ordre et l’exécutait avec un grand talent d’organisation, beaucoup de conscience, un sens du perfectionnisme. Il n’avait même pas de haine. Pour l’histoire du Bounty qui est le point de départ de mon roman L’ Île, je me suis fait aider par une Anglaise que je cite, mais finalement tout ce qu’on en sait tient en une quinzaine de pages. Je me suis longuement documenté sur Tahiti, la langue, les coutumes et la mentalité tahitiennes. J’ai assez bien réussi, je crois : au cours d’une séance de signature, une Tahitienne m’a dit « Monsieur, comme on voit que vous connaissez bien mon pays ! » Je ne lui ai pas avoué que je n’y avais jamais mis les pieds. J’y suis allé mais vingt ans plus tard et j’ai eu une bonne surprise : les Tahitiens ressemblaient beaucoup à ceux que j’avais décrits dans mon livre. Avant d’écrire Derrière la vitre, j’ai reçu de nombreux étudiants dans mon bureau à l’université de Nanterre et je leur demandais de répondre à mes questions. Pour les romans historiques, tout le cycle Fortune de France, la quête de documentation est continue. Je n’ai guère le temps de lire autre chose. De plus, il me faut visiter les lieux pour m’imprégner du site. Je suis allé à Blois avant de pouvoir décrire l’assassinat du Duc de Guise. En plus de toute la documentation rassemblée sur le siège de La Rochelle, je me rendrai sur place.
Vous avez souvent recours à un narrateur ou à un personnage principal qui vous ressemble parfois beaucoup. Le plus transparent est sans doute Frémincourt, dans Derrière la vitre, professeur d’anglais à l’université de Nanterre, libéral, « intellectuel de gauche », « communiste ou communisant », c’est sans doute une technique consciente et délibérée.
R. M. : Le fait qu’un personnage dise je donne une impression d’immédiateté. Le lecteur a l’impression d’avoir en face de lui un ami qui raconte son histoire. Il est vrai que le narrateur me ressemble, sauf dans La mort est mon métier. C’est cette coloration personnelle où je suis à l’aise qui donne de la crédibilité au personnage et qui, par conséquent, donne de la vraisemblance à ce qu’il raconte. Quand vous choisissez le je, vous restez sur vos gardes, vous ne pouvez pas projeter une image trop flatteuse de vous-même. Vous savez jusqu’où vous pouvez aller sans faire preuve de trop de vanité, de charlatanisme. C’est ce qui arrive parfois avec les romanciers qui se croient à couvert derrière le il. Dans le il aussi, le je transparaît sans qu’on y prenne autant garde.
Pouvez-vous préciser davantage votre façon de travailler ?
R. M. : Je n’utilise ni ordinateur ni machine à écrire. J’ai un stylo que je ne remplis même pas. Je trempe ma plume dans l’encrier. J’aime ce geste et le travail de la plume sur le papier, c’est un des plaisirs de l’écriture. Quand une page entière est trop gribouillée, je la recopie. C’est de l’artisanat. Avec un ordinateur, j’irais certainement plus vite mais je ne peux pas me figurer avec un clavier en face de moi.
Vous semblez avoir une prédilection pour les lieux clos. Ces lieux sont-ils plus que d’autres révélateurs de l’authenticité des êtres ?
R. M. : On l’a souvent dit. Peut-être cela tient-il au fait que j’ai été prisonnier pendant trois ans. Il y a une raison consciente : le lieu clos est un microcosme où, à partir de quelques personnes, on peut donner l’impression de recréer la société tout entière.
Presque tous vos personnages ont une vie sexuelle pour le moins tonique. C’est vraiment pour vous une dimension essentielle de l’être. On a même présenté l’un de vos personnages, Pierre de Siorac, le héros de Fortune de France, comme un « humaniste libidineux ». N’est-ce pas parfois un peu trop ?
R. M. : Je ne dirai pas « libidineux » parce que ce terme est péjoratif ; disons un humaniste sensuel. C’est une sexualité tout à fait saine et franche. Dans les pays teintés de latinité comme l’Italie, la France ou l’Espagne, je ne pense pas que ce soit considéré comme un défaut. Prenez l’exemple d’Henri IV : on l’aime parce qu’il a été un bon roi mais aussi parce qu’il était le « vert galant ». Je ne suis pas puritain. Je ne le fais pas exprès. J’exprime ma personnalité. C’est aussi, je crois, un des attraits du roman.
Deux de vos personnages masculins, Martinelli dans Les hommes protégés et Purcell dans L’île, se retrouvent, après bien des péripéties, dans un univers où, pour des raisons de guerre ou d’épidémie, les femmes sont majoritaires ; ils devront se partager généreusement entre plusieurs. Est-ce chez vous un vieux fantasme ? Les femmes représentent-elles un retour à une certaine innocence originelle ?
R. M. : C’est une très bonne remarque. Ce n’est pas un fantasme mais c’est une situation qui, pour un homme, a quelque chose de plaisant. La jalousie n’existe plus. Il n’y a plus ni rivales ni rivaux. Ces deux personnages sont aimés, chouchoutés, y compris par les femmes avec lesquelles ils ne couchent pas. Si être ainsi aimé par les femmes est un fantasme, je le partage sans doute avec beaucoup d’hommes.
On connaît mieux le romancier que l’auteur dramatique. Quelle place le théâtre occupe-t-il encore pour vous ?
R. M. : En captivité, j’avais fondé une troupe de théâtre qui a bien marché. Je jouais, je faisais aussi la mise en scène. De retour de captivité, j’ai fondé un théâtre d’étudiants à Rennes, une troupe qui s’appelait « Les Jeunes comédiens ». Tous sont devenus professionnels depuis. Nous avons joué des pièces d’Oscar Wilde et de G.B. Shaw. J’ai écrit des pièces et je continue à en écrire. Chaque fois que j’ai fini un roman, j’entreprends une pièce. J’ai écrit récemment une pièce sur l’assassinat du Duc de Guise et je viens de publier chez Fallois trois pièces sous le titre Pièces pies et impies. Je tiens beaucoup à mon théâtre même s’il n’est pas beaucoup joué.
Le pied noir
Vous êtes né en Algérie, vous êtes retourné y enseigner au lendemain de l’Indépendance et vous avez consacré un essai à Ben Bella. Pourtant il n’est pas question de l’Algérie dans votre œuvre romanesque.
R. M. : Toute ma famille est pied noir. Famille au sens large. C’est mon arrière-grand-père, paysan pauvre du Cantal, qui est parti en Algérie avec ses cinq filles. Le gouvernement de Napoléon III, qui voulait faire une colonie de peuplement, envoyait en Algérie des paysans du Cantal auxquels il payait le voyage, donnait une terre prise aux Arabes, et des instruments aratoires. Au bout de deux ans, ces colons devaient se marier, évidemment avec une Française, sinon ils perdaient tout. Pour mon arrière-grand-père, qui n’avait quasiment pas de terre et cinq filles, c’était une aubaine. Il est tout de suite parti. Il a rapidement marié ses cinq filles. Voilà pourquoi je suis né en Algérie. Mon père était un grand interprète d’arabe. Il connaissait l’arabe littéraire et l’arabe dialectal. D’abord officier interprète, il a quitté l’armée pour devenir interprète judiciaire. Il pouvait citer le Coran, ce qui lui donnait beaucoup de poids. J’ai quitté l’Algérie à l’âge de dix ans. Il me semble qu’il aurait fallu que je sache l’arabe pour pouvoir écrire quelque chose de crédible sur l’Algérie.
Les adaptations cinématographiques
Certains de vos romans ont été adaptés au cinéma. Avez-vous eu votre mot à dire sur les adaptations ? Qu’en avez-vous pensé ? Que vous a apporté le cinéma ?
R. M. : Week End à Zuydcoote a été un grand succès. Dans Malevil, il restait si peu de choses de mon roman que je me suis demandé pourquoi on en avait acheté les droits. Un animal doué de raison a été acheté très cher par les Américains mais je ne me console pas de ce qu’ils en ont fait. C’est devenu une banale histoire pour enfants. Les Allemands ont tiré un excellent film de La mort est mon métier. L’Île a été adapté sous forme de feuilleton télévisé. Ce qui se passait sur le bateau était très mauvais mais les scènes tournées sur l’île étaient excellentes. Le réalisateur avait embauché comme comédiens des Tahitiens et des Tahitiennes qui n’avaient encore jamais joué et qui ont été merveilleux de naturel. Le propre de l’homme vient d’être adapté pour la télévision française, avec pour actrice Emmanuelle Laborit qui, étant sourde et muette, maîtrise parfaitement le langage des signes qu’un professeur et sa femme enseignent à une jeune chimpanzée. Les droits d’adaptation des six premiers volumes de Fortune de France ont été achetés.
Fortune de France
À l’origine de Fortune de France, y a-t-il un personnage historique réel qui vous aurait inspiré Siorac père ou fils, personnages avec lesquels vous avez vécu près de dix ans ?
R. M. : J’ai possédé dans le Périgord un petit manoir avec une tour du XVe siècle. C’est à partir de ce petit manoir que j’ai fait un grand château, que je suis tout à coup devenu M. de Siorac. Évidemment les lieux me sont familiers et les noms que je cite : Mespech, Taniès, Marcuays, Sireil, Sarlat, sont réels. Je connais bien les paysans, leur mentalité. Ce sont des gens merveilleux. Les Périgourdins sont des gens qui savent vivre. Je les ai décrits avec amour parce qu’ils le méritent et j’ai employé leur langue. Voilà l’origine.
Pierre de Siorac reçoit la seigneurie du Chêne Rogneux près de Montfort l’Amaury. Il est donc d’une certaine façon votre proche voisin.
R. M. : Miroul a aussi une petite seigneurie à la Surie. J’ai donné des noms qui me sont familiers. Ça m’amuse et il m’est plus facile de me situer dans une campagne que je connais.
Vous devez sans doute à votre formation linguistique un certain goût du langage, vos digressions sur le sens d’un mot, d’une expression, avec rappel du sens dans la langue d’origine. Il y a surtout cette magistrale restitution du langage du XVIe siècle dans Fortune de France. C’est un travail considérable.
R. M. : Connaissez-vous un écrivain anglais contemporain de Dickens et aussi connu que lui en Angleterre qui s’appelait Thackeray ? Il a écrit Vanity Fair (La foire aux vanités). Il a écrit un très bon roman historique Henry Esmond. Ce livre, écrit au XIXe siècle, raconte une histoire qui se passe un siècle plus tôt. Thackeray a eu la coquetterie de l’écrire dans la langue de l’époque et c’est parfait. C’est son exemple qui m’a décidé d’écrire Fortune de France dans la langue du XVIe siècle. C’était très difficile. Dans le premier volume il y a un peu trop de mélange d’archaïsmes et de langage classique, même si ce n’est pas vraiment moderne. En nos vertes années est plus réussi. Le pari était audacieux. L’éditeur se demandait qui lirait un roman écrit dans la langue du XVIe siècle mais il a accepté le risque. Le succès est justement dû en partie à ce style archaïque et occitan. Des lecteurs m’écrivent dans cette langue avec beaucoup de talent. Leur opinion est qu’on peine les vingt premières pages et que, très vite, on est pris par les mots, on acquiert le vocabulaire et l’on essaie de réutiliser les mots anciens qu’on aime. Les Français aiment les vieilles maisons, il était presque naturel qu’ils aiment aussi le vieux langage.
Vous vous montrez très critique à l’égard de la société américaine et, pourtant, vous vous êtes intéressé aux Rockefeller. Quels sont vos rapports avec l’Amérique du Nord et, éventuellement, avec le Québec ?
R. M. : J’ai traduit avec ma femme, qui était agrégée d’anglais, un livre sur les Rockefeller. C’est ahurissant de découvrir quelles sont les mœurs des grands crocodiles de la finance et de l’industrie. Ce sont les plus grands escrocs que la terre ait portés. Le fondateur de la dynastie est d’une malhonnêteté incroyable. Pas antipathique par ailleurs mais une véritable canaille. Nous n’étions pas toujours d’accord sur certaines interprétations. J’ai donc passé quatre mois à relire, quatre mois sans pouvoir écrire une ligne de mon roman. C’était l’enfer ! J’ai fait plusieurs traductions, c’est un exercice de style absolument fantastique, qui exige une extrême rigueur. Il ne suffit pas de comprendre, ce qui n’est déjà pas toujours facile ; il faut ensuite essayer de rendre l’esprit anglais qui est si différent de l’esprit français. Cette dernière expérience m’a semblé si pénible que je n’ai pas fait d’autres traductions depuis. J’ai passé un an aux États-Unis où je ne me suis jamais senti à l’aise malgré ma connaissance de la langue. Le puritanisme américain, hypocrite et si excessif, m’est insupportable. Quel que soit le problème, il y a toujours un groupe intolérant pour agresser les autres : les néo-darwiniens sont persécutés par les créationnistes non darwiniens, les femmes qui avortent, et les médecins, sont persécutés par les abolitionnistes… Maintenant, ils ont inventé le harcèlement sexuel. C’est fatiguant de vivre dans un pays où il y a tant de gens intolérants, qui par d’autres côtés peuvent être admirables. C’est effectivement cette ambiance que l’on retrouve au début des Hommes protégés. Je ne suis jamais allé au Canada. La première fois que j’ai côtoyé des Canadiens, c’était à Cuba. Ils avaient pour les Cubains beaucoup de sympathie, partageant avec eux l’horreur des Yankees. C’est la première fois que j’ai entendu l’accent québécois, que j’ai eu le sentiment de retrouver la langue du XVIIe siècle. On a peine à croire de nos jours que les tragédies de Racine étaient jouées par des acteurs qui roulaient les « r ». Pour nous, il n’y a plus guère que les Bourguignons qui parlent ainsi. Il paraît que René Lévesque aimait beaucoup mes livres.
Y a-t-il parmi tous vos livres certains pour lesquels vous avez une tendresse particulière ?
R. M. : Je les aime tous. Je suis un bon père ou une bonne mère. J’ai quand même une petite préférence pour L’Île et pour Malevil. Ce sont des romans vraiment « romanesques ». Le roman historique repose sur des données incontournables, il n’est jamais complètement romanesque. Ces deux-là le sont. C’est très agréable à écrire car on a vraiment l’impression de créer un monde.
Robert Merle L’Île
Ce roman est très librement inspiré de l’histoire des révoltés du Bounty. À la fin du XVIIIe siècle, pour éviter d’être repris par l’Amirauté britannique et irrémédiablement condamnés à la pendaison, les mutins trouvèrent refuge en plein Pacifique sur une île déserte difficilement accessible : Pitcairn. À la suite de querelles entre les Britanniques et les Tahitiens qui les accompagnaient, l’aventure se termina par un massacre dont on découvrit vingt ans plus tard l’unique survivant avec plusieurs femmes et enfants.
La mutinerie des marins du Blossom, simple point de départ du roman, n’en occupe que le premier chapitre. L’essentiel est consacré à l’installation sur l’île d’une colonie de neuf marins britanniques, six Tahitiens et douze femmes.
Le choix même du lieu laisse présager le drame. L’île, bien que fertile et contenant tout ce qui est nécessaire à l’homme, est paradoxalement inhabitée. Petit à petit, la vie s’organise. On trace des sentiers qu’on nomme « rues » et « avenues » et une place centrale qu’on baptise Blossom Square. Tandis que les Tahitiens se bâtissent une grande maison commune, chaque Britannique tient à sa maison individuelle, son « cottage ».
Très vite, la ségrégation et l’apartheid s’affirment. L’attribution des femmes se fait par tirage au sort dont sont exclus les Tahitiens.
Quelques Britanniques tentent de s’opposer aux injustices, proposant même de partager les parts de terre qui leur ont été attribuées avec les Tahitiens, ceux-ci répondent : « Il ne suffit pas d’être bon. Tu dis ‘Je partage avec vous l’injustice’ mais cela ne supprime pas l’injustice ».
Après le meurtre de deux Tahitiens, la révolte contre les Peritani (Britanniques) et la guerre sont devenues inévitables.
Optimiste malgré tout, le roman laisse entrevoir l’éventualité d’un nouveau monde où les deux communautés, représentées par Purcell et Itahiti, vivraient en paix dans une confiance réciproque.
Ce livre, qui a reçu le Prix de la Fraternité (du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), montre la grandeur et l’inconfort du pacifisme intégral qui confère au héros Purcell une sorte de sainteté mais conduit dans les faits à une impasse. Traître pour ses compatriotes, le pacifiste du roman n’en est pas moins suspect aux yeux des Tahitiens. Le carnage n’aurait-il pas été évité s’il avait à temps choisi son camp ? Ne s’est-il pas trompé depuis le début ? Robert Merle ouvre un grave et vaste débat.
Publié en 1962, après six ans de maturation, le livre n’a rien perdu de sa force plus de trente ans après. Olivier Cyran qui venait de le découvrir en recommandait la lecture dans Charlie Hebdo du 3 avril 1996 comme d’un livre en prise sur l’actualité.
Roman d’aventure, roman philosophique, fable, L’Île est tout cela. Le destin de l’île, « prison à vie » dans laquelle les hommes sont condamnés à vivre ensemble ou à mourir, est aussi celui de notre monde. Tant par la richesse et la générosité de son propos que par la qualité du style, L’Île est certainement un des quelques livres fondamentaux de la littérature contemporaine.
Robert Merle est un romancier « classique » qui s’efforce de « faire un bon roman » et non un « roman nouveau ». Vivant en marge des coteries, salons et académies, c’est un homme en quête d’authenticité. « J’essaie d’être vrai, dit-il, sur le plan personnel. Et bien sûr quand j’écris. Ça a l’air simple, et c’est, en fait, très difficile, car on est sans cesse guetté par les tentations : l’effet, la pose, le charlatanisme, d’autant plus tentant qu’il réussit si bien, le parisianisme littéraire est là pour le prouver. »
*Louis Guilloux (1890-1980) évoque dans une œuvre d’inspiration autobiographique son enfance pauvre et difficile en Bretagne et le courage quotidien du peuple qui lutte pour survivre. Il est également l’auteur de La maison du peuple qu’a préfacé Albert Camus.
**Les marranes sont des juifs d’origine espagnole ou portugaise qui, obligés de se convertir de force, sauvent ostensiblement les apparences tout en restant scrupuleusement fidèles à la religion hébraïque. En nos vertes années, met en scène le personnage de Maître Sanche que Robert Merle compare plaisamment à une tortue : sous la pesante carapace catholique, qui opresse et qui protège à la fois, bat son cœur fidèle à l’ancienne religion.
Robert Merle a publié :
Romans : Week-end à Zuydcoote, NRF, Gallimard, Prix Goncourt 1949 ; La mort est mon métier, NRF, 1952 ; L’Île, NRF, 1962, Prix de la Fraternité ; Un animal doué de raison, NRF, 1967 ; Derrière la vitre, NRF, 1970 ; Malevil, NRF, 1972 ; Les hommes protégés, NRF, 1974 ; Madrapour, Seuil, 1976 ; Le jour ne se lève pas pour nous, Plon, 1986 ; L’Idole, Plon, 1987 ; Le propre de l’homme, de Fallois, 1989 ; Cycle Fortune de France : Fortune de France, Plon, 1978 ; En nos vertes années, Plon, 1979 ; Paris, ma bonne ville, Plon 1980 ; Le Prince que voilà, Plon, 1982 ; La violente amour, Plon, 1983 ; La pique du jour, Plon, 1985 ; La volte des vertugadins, de Fallois 1991 ; L’enfant roi, de Fallois 1993 ; Les roses de la vie, de Fallois 1995.
Histoire contemporaine : Moncada, premier combat de Fidel Castro, Laffont, 1965 ; Ahmed Ben Bella, NRF, 1965.
Théâtre : Tome I. Sisyphe et la mort, Flamineo, Les Sonderling, NRF, 1950 ; Tome II. Nouveau Sisyphe, Justice à Miramar, L’assemblée des femmes, NRF, 1957 ; Tome III. Le mort et le vif, Nanterre la folie, de Fallois 1992 ; Tome IV ; Pièces pies et impies, de Fallois, 1996.
Biographie : Vittoria, princesse Orsini, Mondiales, 1979.
Essais : Oscar Wilde ou la « destinée » de l’homosexuel, NRF, 1955 ; Oscar Wilde, Perrin, 1984.
Traductions : John Webster, Le démon blanc, Aubier, 1948 ; Erskine Caldwell, Les voies du Seigneur, NRF, 1950 ; Jonathan Swift, Voyages de Gulliver, EFR, 1956-60.
En collaboration avec Magali Merle : Ernesto « Che » Guevara, Souvenirs de la guerre révolutionnaire, Maspero, 1967 ; Ralph Ellison, Homme invisible, Grasset, 1969 ; P. Collier et D. Horowitz, Une dynastie américaine : Les Rockefeller, Le Seuil, 1976.