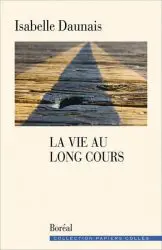S’il évoque la vie, nos existences, s’il les mime ou semble les calquer, s’efforçant de les tourner en dérision ou de nous les montrer sous des angles parfois inattendus, le roman est également plus et autre chose que la relation d’une vie.
Isabelle Daunais privilégie quelques-uns de ces angles. Elle évoque pour le bénéfice de son lecteur des phénomènes ou des réalités tellement simples et intangibles, tellement coutumiers qu’on n’y songe pratiquement jamais : le temps de la lecture elle-même, l’oubli relatif qu’impose forcément toute lecture, une beauté spécifiquement romanesque, l’imperfection de la vie corrigée par l’art. Ces dimensions de l’art romanesque et de nos vies, elle les évoque intelligemment plus qu’elle ne les analyse, elle nous en parle comme on deviserait entre camarades, forte d’une vaste expérience de lectrice attentive et d’essayiste lucide. Il y a une manière Daunais, autant sinon plus importante que son argumentaire ou que le propos lui-même. Aucune lourdeur. Un ton proche de la confidence chuchotée. Pas de démonstration soutenue, pas d’arguments appuyés sur des enquêtes ou des compilations : nous sommes au plus près de ce que j’appellerais la causerie littéraire, même si les propositions, les hypothèses et les enjeux examinés dans La vie au long cours sont des plus sérieux. Je crois qu’il fallait une universitaire pour s’y intéresser de cette façon.
Voici un exemple de ce que Daunais fait bien, quand elle nous propose une piste de réflexion : s’il « faut se méfier de l’empreinte souvent plus frappante que laisse un personnage dans notre mémoire – alors qu’une vie a tendance à se confondre avec les autres vies –, encore faudrait-il définir ce qui, pour chaque époque, a constitué une vie. Ce que nous reconnaissons aujourd’hui comme tel, avec son caractère de modestie et d’anonymat, mais aussi d’exemplarité et d’énigme, ne s’est peut-être pas toujours, au cours des siècles, présenté à la conscience de la même façon ni avec la même importance ». Voilà, simplement exprimée, une piste lourde de sens dont la portée va de la sociologie à l’anthropologie.
Ses réflexions lui viennent de ses lectures, qui le plus souvent, on le devine et elle le dit, sont des relectures, seule forme d’une lecture digne de ce nom : elle visite et revisite Balzac, Proust, Flaubert et Cervantès, sans surprise, mais aussi Dominique Fortier, Yánnis Kiourtsákis et Karl Ove Knausgård.
Quand elle compare le roman aux autres formes artistiques, Daunais oublie ou néglige volontairement toutes ces œuvres qui, elles aussi, demandent du temps de fréquentation démultiplié : les téléséries, les téléfilms, tous les trucs en douze épisodes et cinq saisons que les spectateurs consomment nécessairement sur un temps long. L’idée que tout va vite, que tout s’avale dorénavant à la vitesse grand V, même la culture, cette hypothèse porteuse néglige quand même tout le temps dont disposent les gens (jamais n’a-t-on autant perdu de temps sur les réseaux sociaux, par exemple, ou en ligne, diront certains) et qu’ils emploient justement à regarder une télésérie de 40 heures.
Je lui reprocherais aussi d’abuser, à l’occasion, des oppositions binaires dans sa manière de concevoir les romans et leur histoire. Sans doute ces découpages sont-ils là pour bien marquer la question, pour lancer la discussion et pour faire sentir exagérément l’enjeu. Il y aurait ainsi, selon elle, des œuvres de type « Sancho » et des œuvres de type « Don Quichotte » ; il y aurait le monde d’aujourd’hui, « éperdu de jeunesse », et celui d’avant, le « vieux monde » ; le monde intérieur et le monde extérieur.
Heureusement, il y a la manière Daunais, cette sensibilité, cette voix douce et patiente qui enrobent si bien le propos, et son amour éclairé du genre romanesque, présent dans la vingtaine de textes ici réunis.