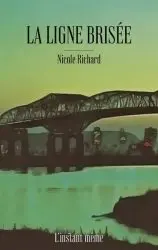On dirait d’abord un récit de voyage. Eugénie, la narratrice, est à Florence en compagnie de sa grande amie Lena. Elles vont de musées en églises, cryptes et chapelles, admirant et commentant tableaux et sculptures des grands maîtres.
Mais voilà que peu à peu, puis de plus en plus, le détail d’un tableau, la représentation d’une scène ou la manière d’un peintre ramènent Eugénie à son passé.
Ce roman à la première personne s’avère le récit d’une émancipation, avec tout ce que cela comporte de choix difficiles, de ruptures et de plongées dans l’inconnu. L’histoire d’un exil, comme le sociologue Fernand Dumont appelait son passage de la culture populaire à la culture savante. Par de fréquents retours en arrière, la narratrice décrit par bribes le sentiment, qu’elle éprouvait à l’adolescence, de n’être pas à sa place. À treize ans, elle abhorre la « Banlieue-la-mortifère » où sa famille vient d’emménager, n’arrive pas en première secondaire à se faire à la polyvalente, déteste l’univers féminin avec ses colifichets. Par-dessus tout, elle s’en prend à sa mère Jeanne qu’elle considère comme le principal obstacle à son épanouissement. Tout au long du secondaire, dans une autre école, Eugénie est attirée par les mots, la poésie, la vie intellectuelle et veut s’inscrire au cégep et poursuivre ses études. Jeanne, l’épouse d’un homme malade incapable de travailler et mère au foyer de deux enfants, s’y oppose. Problème d’argent, mais d’abord de vision de l’avenir dévolu aux filles : travailler comme secrétaire en attendant le mariage est la voie toute tracée.
« J’ai tout fait pour échapper à mon sort. J’ai dévié de ma trajectoire », dira-t-elle. Elle arrive en effet à ses fins, avec l’aide notamment de deux professeurs devenus des amis, dont Lena, sa compagne de voyage. On en apprend plus au sujet de cette dernière dans la deuxième partie du roman intitulée « Suisse », pays d’origine qu’elle a quitté il y a des décennies, en conflit avec sa mère. Elle y revient pour la première fois. Simon, l’autre professeur ami, vient les y rejoindre. D’origine iranienne, il a eu lui aussi maille à partir avec son entourage. Quant à la narratrice, le ressentiment envolé, elle s’est rapprochée de sa mère et peut dire comme Annie Ernaux que la romancière cite en exergue : « Je me suis sans doute construite à la fois pour elle et contre elle ».
La qualité littéraire, les références culturelles variées, la sensibilité de la romancière, aussi poète, et la trame de La ligne brisée font de ce roman une œuvre remarquable.