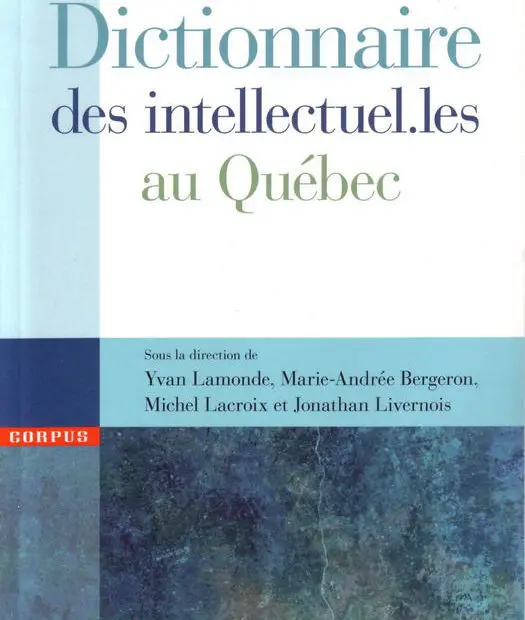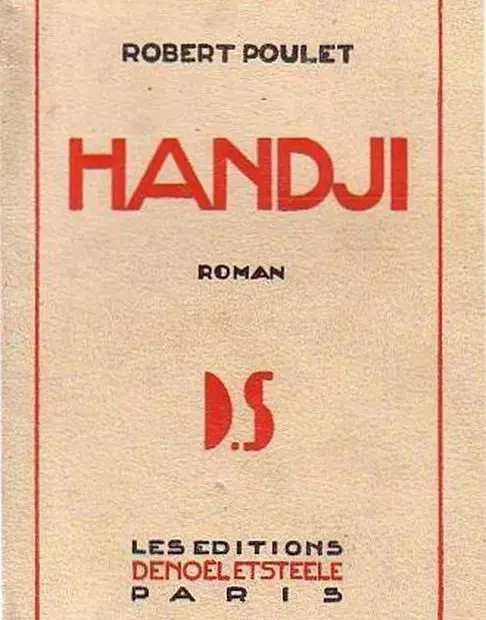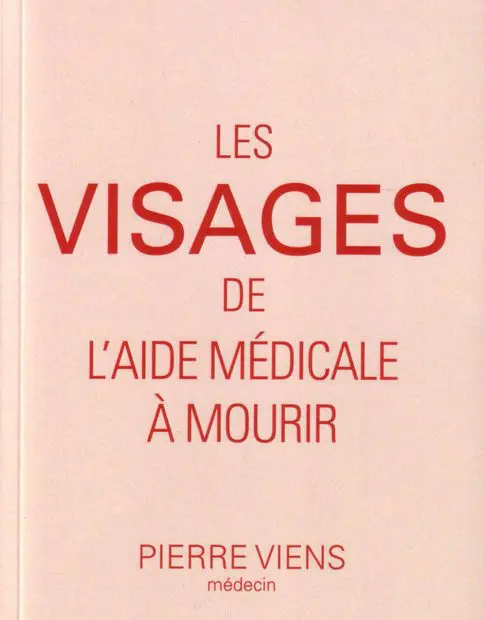Peter Behrens et Les insouciants
Né à Westmount en 1954 au sein de la famille O’Brien, vaste tribu sous l’autorité d’un richissime patriarche, Peter Behrens a été élevé par une mère irlandaise et un père allemand, tout comme Hermann « Billy »… Peter Behrens et Les insouciants