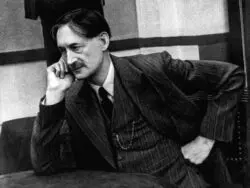Il est difficile, chez Henri Barbusse, de distinguer l’homme de plume de l’homme d’action, puisque à ses yeux l’écriture n’est que le prélude à l’engagement. Or s’il demeure dans les mémoires le chroniqueur dantesque des tranchées, et si l’on retient son nom pour les intenses luttes politiques qu’il a menées en faveur du bolchevisme, son œuvre littéraire semble aujourd’hui vouée à l’oubli, malgré l’influence décisive qu’elle exerça sur bon nombre de ses contemporains.
La confession d’un enfant fin-de-siècle
Henri Barbusse naît à Asnières le 17 mai 1873. Il appartient à cette génération fin-de-siècle qui rejette avec vigueur le matérialisme d’hier, précisément parce qu’il contredit les préoccupations spirituelles qui sont désormais les siennes. Élève au collège Rollin, le jeune Barbusse découvre la philosophie de Bergson et exprime dans ses premiers vers la nécessité pour lui d’incarner sa quête d’absolu dans le Moi.
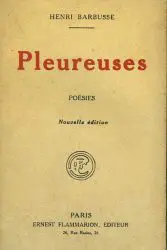
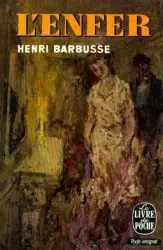 Dès le début des années 1890, Barbusse propose quelques-uns de ses poèmes pour les concours de poésie de L’Écho de Paris, revue fondée par Catulle Mendès et Marcel Schwob. La délicatesse de ses vers le distingue assez rapidement et lui ouvre les portes du Paris littéraire. Par l’intermédiaire de Schwob, il rencontre des écrivains dont le nom est alors bien connu : Jules Renard, Paul Claudel, Léon Daudet. Au printemps 1895, il publie le recueil Pleureuses, nettement influencé par le lyrisme romantique. Catulle Mendès se charge d’assurer son succès dans un éloge fracassant ; à sa suite, de nombreux écrivains saluent le poète des Pleureuses comme l’un des plus doués de sa génération.
Dès le début des années 1890, Barbusse propose quelques-uns de ses poèmes pour les concours de poésie de L’Écho de Paris, revue fondée par Catulle Mendès et Marcel Schwob. La délicatesse de ses vers le distingue assez rapidement et lui ouvre les portes du Paris littéraire. Par l’intermédiaire de Schwob, il rencontre des écrivains dont le nom est alors bien connu : Jules Renard, Paul Claudel, Léon Daudet. Au printemps 1895, il publie le recueil Pleureuses, nettement influencé par le lyrisme romantique. Catulle Mendès se charge d’assurer son succès dans un éloge fracassant ; à sa suite, de nombreux écrivains saluent le poète des Pleureuses comme l’un des plus doués de sa génération.
À l’aurore du XXe siècle, Barbusse délaisse définitivement le vers pour la prose, et travaille à l’écriture de son premier roman, Les suppliants, publié en 1903. L’accueil que lui réserve la presse demeure toutefois assez mesuré, et ce manque de reconnaissance l’affecte d’autant plus qu’il pressent déjà qu’il aura à tenir sur la scène publique le rôle de « crieur ». Au début de l’année 1908, Barbusse publie L’enfer. La veine décadente dans laquelle s’inscrit ce roman partage la critique : il déclenche l’indignation à peu près autant qu’il enthousiasme.
Parallèlement, Barbusse mène une vie de journaliste assez active. Directeur de rédaction des éditions Lafitte, il collabore à de nombreuses revues et, par ailleurs, écrit des nouvelles qui paraissent régulièrement dans les colonnes du Matin. Il les recueillera quelques années plus tard au sein d’un recueil intitulé Nous autres…, publié à la veille de la Grande Guerre.
Le baptême du Feu

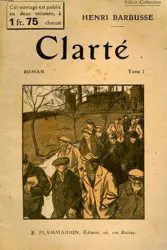 Le 1er août 1914, la guerre éclate. Barbusse a alors 41 ans. Son âge pourrait lui permettre d’échapper aux tranchées, mais il décide de s’engager volontairement pour le front. Ses idéaux pacifistes, encore vagues, l’incitent à quitter Paris pour combattre le militarisme allemand. Il prend position dans les tranchées en décembre 1914. D’après les sources militaires, Barbusse est un soldat exemplaire, toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses, ce qui lui vaut d’être cité à l’Ordre de la Brigade. Mais la vie des tranchées l’affaiblit et, victime de plusieurs attaques de dysenterie, il finit par accepter d’être nommé brancardier. En novembre 1915, les symptômes s’aggravent et le contraignent à quitter les tranchées, malgré ses réticences. Il est versé dans un régiment territorial, et devient secrétaire d’état-major. C’est à cette période que Barbusse commence à réunir les notes prises dans son carnet de guerre pour ébaucher les premières lignes de son prochain roman, Le feu. À plusieurs reprises, il est envoyé dans des hôpitaux, d’abord à Chartres puis à Plombières. Pendant ces périodes de convalescence, il continue de travailler sur Le feu, et en achève la rédaction en 1916. Barbusse est finalement réformé au mois de juin 1917.
Le 1er août 1914, la guerre éclate. Barbusse a alors 41 ans. Son âge pourrait lui permettre d’échapper aux tranchées, mais il décide de s’engager volontairement pour le front. Ses idéaux pacifistes, encore vagues, l’incitent à quitter Paris pour combattre le militarisme allemand. Il prend position dans les tranchées en décembre 1914. D’après les sources militaires, Barbusse est un soldat exemplaire, toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses, ce qui lui vaut d’être cité à l’Ordre de la Brigade. Mais la vie des tranchées l’affaiblit et, victime de plusieurs attaques de dysenterie, il finit par accepter d’être nommé brancardier. En novembre 1915, les symptômes s’aggravent et le contraignent à quitter les tranchées, malgré ses réticences. Il est versé dans un régiment territorial, et devient secrétaire d’état-major. C’est à cette période que Barbusse commence à réunir les notes prises dans son carnet de guerre pour ébaucher les premières lignes de son prochain roman, Le feu. À plusieurs reprises, il est envoyé dans des hôpitaux, d’abord à Chartres puis à Plombières. Pendant ces périodes de convalescence, il continue de travailler sur Le feu, et en achève la rédaction en 1916. Barbusse est finalement réformé au mois de juin 1917.
Dès sa parution en feuilleton dans le journal L’Œuvre, ce « journal d’une escouade » connaît un succès retentissant. Au front comme à l’arrière, les lecteurs ont conscience, pour la première fois, de lire la Grande Guerre dans sa vérité la plus crue et la plus terrifiante. Notamment parce que Barbusse prend soin de faire parler ses personnages dans l’argot des tranchées et de leur faire tenir des discours qui ne correspondent pas au ton cocardier qui caractérise la presse de l’époque. Au fil de son roman, en effet, Barbusse revendique de plus en plus franchement des idées pacifistes et internationalistes qui vont le conduire, peu à peu, vers le socialisme. À cet égard, la rédaction du Feu amorce chez l’écrivain une profonde prise de conscience politique. L’immense notoriété qu’il a acquise grâce à la publication de son « journal d’une escouade » lui permet alors de faire entendre sa voix sur la scène publique. Cette prise de conscience politique fait d’ailleurs l’objet de son second roman consacré à la guerre, Clarté (1919), dans lequel il raconte le parcours d’un homme que le traumatisme des tranchées amène à défendre des positions farouchement antimilitaristes, et, finalement, à prêcher en faveur du socialisme.
Dans la clarté des lendemains
Alors que l’Europe en ruine fait le compte de ses morts, Barbusse bénéficie d’une attention suffisante pour réaliser sa vocation de « crieur ». À partir de 1916, déjà, il écrit de nombreux articles antimilitaristes pour des journaux socialistes, tels que Le Populaire de Paris ou L’Humanité. Pendant l’année 1917, il fonde l’ARAC (Association républicaine des anciens combattants) avec deux jeunes soldats, Paul Vaillant-Couturier et Raymond Lefebvre. Son engagement commence à prendre une forme de plus en plus concrète. L’été 1919 marque la naissance du mouvement Clarté, qui a pour but de rassembler les intellectuels au sein d’une démarche pacifiste d’envergure internationale. Les instigateurs du mouvement sont Barbusse et Romain Rolland.
 Peu de temps après, Barbusse publie coup sur coup trois essais politiques. Dans le premier, La lueur dans l’abîme, il trace les lignes directrices de Clarté. Ensuite, Paroles d’un combattant se présente comme un recueil d’articles, appelé à illustrer l’évolution de sa pensée entre 1917 et 1920. Enfin, le plus radical de ces livres est Le couteau entre les dents, dans lequel il défend le bolchevisme et remet violemment en cause le capitalisme. Ces années sont également marquées par la lutte intense de Barbusse contre les mouvements de la droite chrétienne. Pour combattre les chantres de l’Action française et faire valoir les valeurs internationalistes qui sont les siennes, il fonde la revue Clarté, qu’il conçoit comme l’organe des intellectuels de la gauche pacifiste – de ceux qu’il désigne comme des « ouvriers de l’esprit ».
Peu de temps après, Barbusse publie coup sur coup trois essais politiques. Dans le premier, La lueur dans l’abîme, il trace les lignes directrices de Clarté. Ensuite, Paroles d’un combattant se présente comme un recueil d’articles, appelé à illustrer l’évolution de sa pensée entre 1917 et 1920. Enfin, le plus radical de ces livres est Le couteau entre les dents, dans lequel il défend le bolchevisme et remet violemment en cause le capitalisme. Ces années sont également marquées par la lutte intense de Barbusse contre les mouvements de la droite chrétienne. Pour combattre les chantres de l’Action française et faire valoir les valeurs internationalistes qui sont les siennes, il fonde la revue Clarté, qu’il conçoit comme l’organe des intellectuels de la gauche pacifiste – de ceux qu’il désigne comme des « ouvriers de l’esprit ».
En février 1923, Barbusse radicalise nettement sa position en faisant paraître, dans L’Humanité, un article dans lequel il fait connaître publiquement son adhésion au Parti communiste français. Dès lors, l’écrivain ne se contente plus seulement d’exprimer des idées pacifistes, mais il entend bien davantage promouvoir la réalisation de l’idéal communiste en URSS. La sympathie qu’éprouvent à son égard les instances soviétiques l’incite à faire figure de rassembleur, à déployer une énergie considérable pour fonder de nouvelles revues et mettre sur pied de nombreux comités de lutte. Ainsi, au début des années 1930, tandis que les mouvements nationalistes gagnent peu à peu l’Europe, il organise et coordonne en compagnie de Romain Rolland la lutte contre le fascisme. Ensemble, ils lancent un appel aux intellectuels du monde entier afin de mobiliser les esprits contre la menace d’une guerre imminente, initiative qui aboutit en 1932 à la création du large mouvement antifasciste Amsterdam-Pleyel.
« L’art prolétarien »
Par ailleurs, la pensée politique qu’il développe depuis le début des années 1920 conduit Barbusse à préciser sa conception de la littérature. Dans un article paru en 1926 dans L’Humanité, l’écrivain affirme sa volonté de voir naître un art strictement prolétarien. S’il ne souscrit pas à la glorification soviétique des rabcors (correspondants-ouvriers), il ne partage pas non plus les idées émises à l’époque par Henry Poulaille. Car, bien qu’il s’agisse de donner une orientation nouvelle à la littérature, Barbusse demeure convaincu de la nécessité de puiser dans les modèles issus de la tradition populaire. Il enjoint donc les jeunes artistes à investir les formes du mystère médiéval, du lied, et, dans le domaine architectural, à s’en remettre à l’exemple des cathédrales.
Les œuvres qu’il publie entre 1925 et 1935 montrent toutefois qu’en pratique la littérature peut évoluer dans un cadre formel plus large, pour autant qu’elle contribue à témoigner de la réalisation de l’idéal soviétique. C’est le cas notamment de Voici ce qu’on a fait de la Géorgie (1929), ou encore de Russie (1930), que l’auteur conçoit comme des études historiques et sociales. À travers des œuvres moins spécifiquement documentaires, Barbusse explore également les potentialités marxistes de son écriture. Dans Les enchaînements (1925) ainsi que dans Élévation (1930), par exemple, il s’inspire des techniques cinématographiques pour mettre au point un style littéraire qui lui permette de retranscrire dans l’art une vision matérialiste du monde et des hommes. La narration devient ainsi prétexte à de grandes fresques collectives aux contours géométriques, qui répondent à la nécessité d’embrasser l’histoire de l’humanité d’un seul regard.
C’est aussi dans cette perspective que Barbusse choisit de consacrer, dans les années 1927-1929, une trilogie à la figure du Galiléen – figure qui le fascine depuis sa jeunesse. Désireux d’abolir la distance temporelle qui sépare les premiers chrétiens des militants communistes, l’écrivain dresse le portrait d’un Jésus marxiste, révolutionnaire et athée. À travers ce triptyque, qui se compose d’un évangile, d’un essai historique et d’une pièce de théâtre désignée comme un « mystère », Barbusse investit donc différents genres littéraires qu’il entend actualiser en les intégrant au sein d’une réflexion sur le potentiel mystique du marxisme. Ce rapport à la religion est d’autant plus important qu’en définitive, les formes d’art populaire sur lesquelles doit s’appuyer la littérature prolétarienne, selon lui, sont principalement issues de la tradition chrétienne. La dernière œuvre qu’il publie avant sa mort en offre, elle aussi, un exemple éloquent. Cette biographie, intitulée Staline. Un monde nouveau vu à travers un homme (1935), dans laquelle l’écrivain peint le Père des peuples sous les traits d’un Messie des temps modernes, se présente en réalité comme une véritable hagiographie. Barbusse n’est plus alors seulement le chroniqueur de l’édification du marxisme, mais bien plutôt un croyant, qui semble avoir trouvé dans le communisme une solution de remplacement à Dieu dont il avait poursuivi la quête depuis ses premiers vers.
Le 7 septembre 1935, un immense cortège se presse aux abords du mur des Fédérés pour saluer la mémoire de celui qui fut, pendant près de vingt ans, le porte-parole des exploités, l’infatigable remueur de foules en quête d’une clarté aux reflets rouges.
Henri Barbusse a publié, entre autres :
Pleureuses, Fasquelle, 1895 ; Les suppliants, Fasquelle, 1903 ; L’enfer, Albin Michel, 1908 et Albin Michel, 1992 ; Le feu, Flammarion, 1916, coll. « Folio », 2013 et coll. « GF », 2014 ; Nous autres…, Fasquelle, 1914 ; Clarté, Flammarion, 1920 ; La lueur dans l’abîme, Flammarion, 1920 ; Paroles d’un combattant. Articles et discours (1917-1920), Flammarion, 1920 et Delga, 2013 ; Le couteau entre les dents, Flammarion, 1921 ; Les enchaînements, 2 tomes, Flammarion, 1925 ; Jésus, Flammarion, 1927 ; Les Judas de Jésus, Flammarion, 1927 ; Voici ce qu’on a fait de la Géorgie, Flammarion, 1929 ; Élévation, Flammarion, 1930 ; Russie, Flammarion, 1930 ; Staline. Un monde nouveau vu à travers un homme, Flammarion, 1935 et L’Harmattan, 2006.
EXTRAITS
Je t’ai trouvé jadis par une nuit très noire,
Pauvre ange de faiblesse avec ton front lassé,
Et comme je rêvais, je t’ai donné ma gloire,
Et toi, tu m’as donné doucement ton passé.
Mon destin s’appuya sur ta mélancolie
Et depuis que j’ai vu ton regard attristé
Je sens pleurer en moi les choses qu’on oublie,
Les choses de légende et de simplicité.
« Hélas, viens avec moi… »
Pleureuses, p.172.
117. ― Rendez l’homme à l’homme, unissez l’homme à l’homme, faites la montagne de l’homme.
118. ― Les chaînes tomberont de force lorsqu’il n’y aura plus qu’un grand enchaîné.
119. ― Faites d’abord la révolution dans vos têtes.
120. ― La révolution est de l’esprit.
121. ― Parce que c’est changer ce qui est, en ce qui doit être selon l’esprit.
122. ― Et sachez bien qu’il n’y a qu’une vérité et que ce qui doit se faire selon l’esprit se fera aussi un jour par la force des choses.
Jésus, p. 208.
Tout ce qui était dans les paroles, et non dans la réalité : patrie, nationalisme vertical, propriété, Dieu, s’élimine de la nature, et il n’y a plus que le corps de la vie. J’ai une hantise géométrique et cosmique qui m’a déjà obsédé tandis que l’avion construisait la pyramide du réel : mettre le destin collectif dans l’angle fulgurant de l’individualité. Agir ainsi dans la vérité de la terre, non dans le songe. « D’un bout à l’autre », tel est le mot d’ordre neuf. C’est par l’étendue que se formera l’unité organique.
J’ai fait un pas en avant dans la mathématique humaine.
Élévation, p. 247-248.