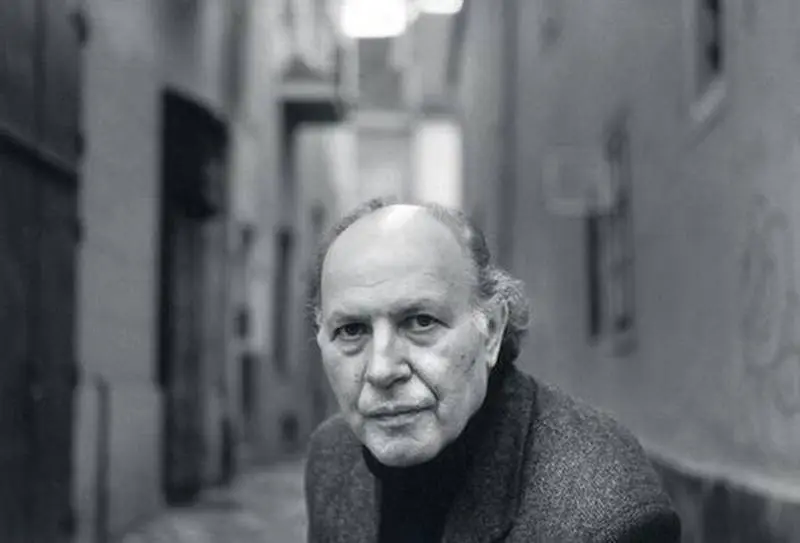Défense d’un humanisme actuel : La gloire de Cassiodore de Monique LaRue
Avouons-le d’emblée, j’ai commencé la lecture du dernier roman de Monique LaRue avec autant de hâte que d’appréhension. Même si j’ai beaucoup apprécié ses précédents romans, il me coûtait en effet de lire une fiction… Défense d’un humanisme actuel : La gloire de Cassiodore de Monique LaRue