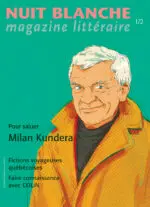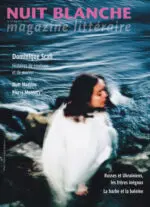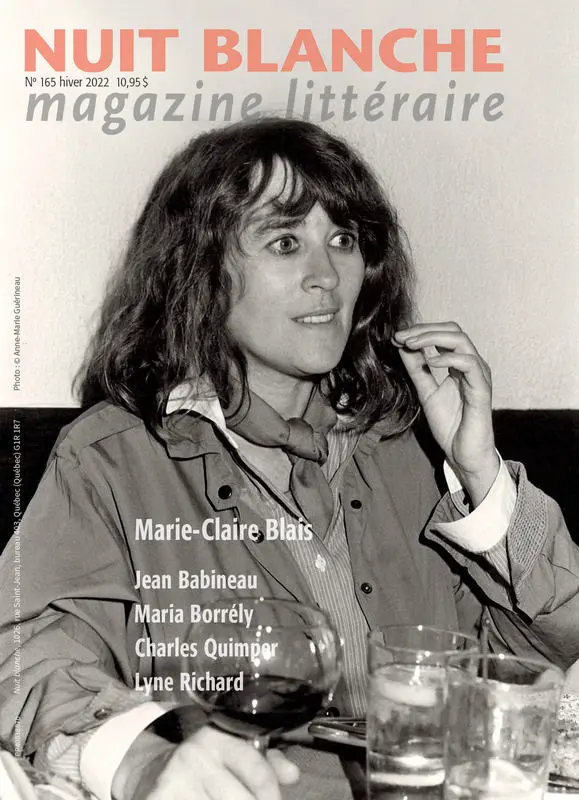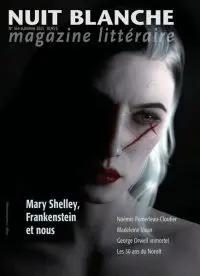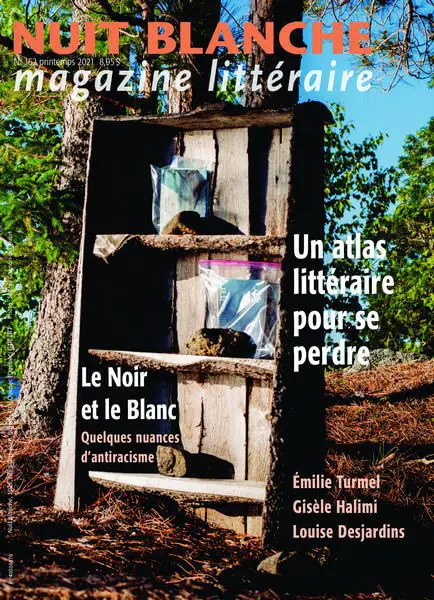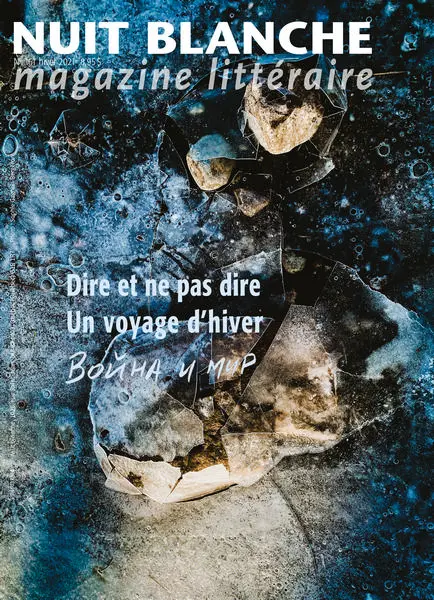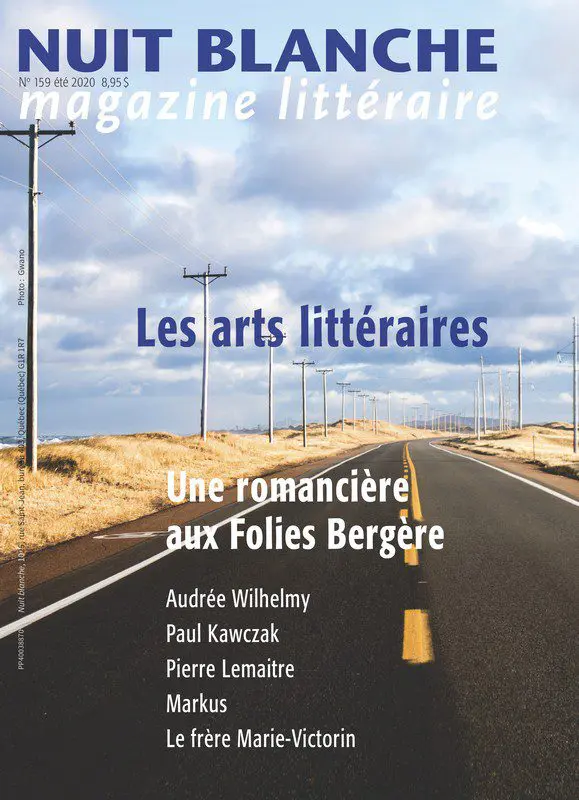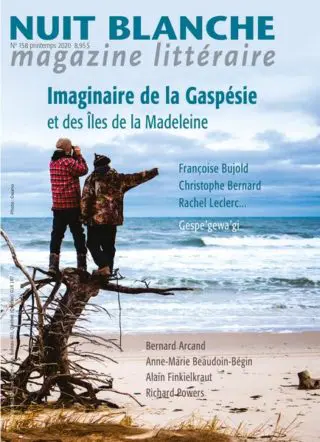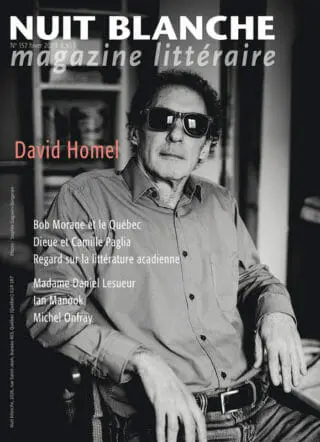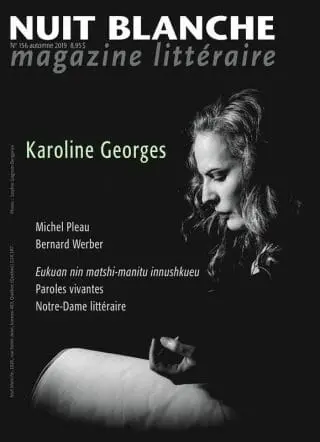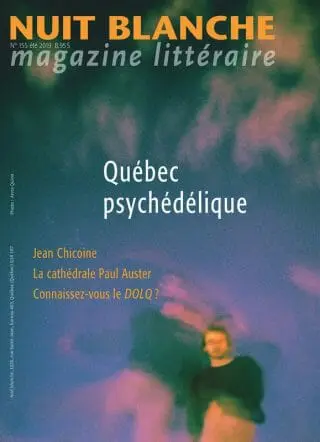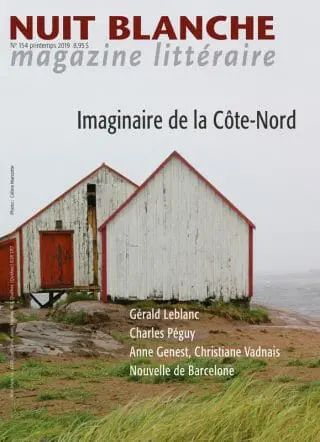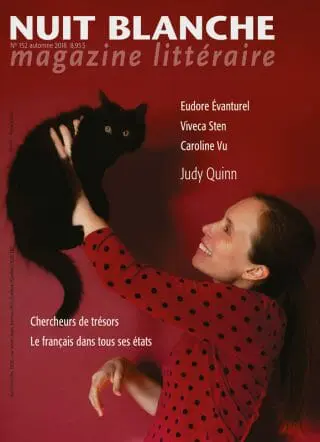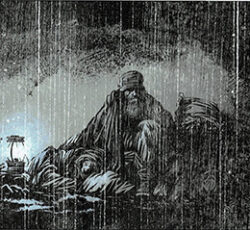Que voit le Québec quand il regarde le Québec ? Du beau, du stimulant, de l’étrange, du déprimant, du familier ? Certes, mais aussi, étonnamment, du nouveau. Comme si, à observer le même visage dans les mêmes miroirs, on finissait par entrevoir l’origine d’une fossette, la ressemblance inattendue avec un parent ou le signe avant-coureur du vieillissement.
En s’observant dans des miroirs incorruptibles, et plusieurs de ceux qui lui sont présentés ici le sont, le Québec peut donc revoir et réinterpréter son passé, dresser divers bilans de son présent et entrevoir son avenir. L’exercice, qui s’amorce dans une apparente dispersion, se termine à un carrefour clairement dégagé.
Une relecture et un rappel
Même si beaucoup estiment depuis toujours en savoir plus qu’ils ne tiennent à en savoir sur le duplessisme, Gilles Bourque et Jules Duchastel n’en poursuivent pas moins, en s’adjoignant Jacques Beauchemin comme nouveau complice, leur fascinante réinterprétation de cette époque et de ce style politique1. Ce que les deux premiers avaient cerné dans un ouvrage précédent2 prend cette fois un relief inattendu. Non seulement, en effet, les auteurs parviennent à situer la période duplessiste sous le signe de la peur plutôt que sous celui de la « grande noirceur », mais ils utilisent cette relecture du passé pour approfondir des notions aussi actuelles et aussi névralgiques que celle de l’État providence ou celle du libéralisme.
Les trois auteurs ne réhabilitent pas le « chef ». Ils tiennent, cependant, à ce qu’on le décrive correctement. Or, Duplessis se bat pour le progrès plus que pour la tradition, plus pour limiter l’intervention de l’État que pour l’étendre. Du coup, un paradoxe surgit : au moment où il devient politiquement orthodoxe de décrier l’État et d’en donner une définition rabougrie, comment maintenir l’anathème contre un régime politique qui a tout fait pendant quinze ans pour laisser hors de l’emprise étatique ce qu’on essaie aujourd’hui de lui arracher… ? Se pourrait-il, laissent entendre les auteurs, que le duplessisme si constamment honni ait proposé, par des moyens sans doute contestables, des valeurs « libérales » ?
Cette relecture ébranle des perspectives que l’on croyait assurées. Ainsi, l’autonomie provinciale ne défend plus seulement le butin québécois, mais une conception de la vie en société qu’entendait bousculer le gouvernement central. D’une sociologie de la nation, les auteurs nous font passer à une analyse de la société. Le duplessisme, moderne, disciplinaire, répressif, résiste, non au progrès, mais à l’implantation de l’État providence.
L’analyse, nettement plus courte, mais tout aussi pénétrante, des déclarations épiscopales de l’époque tranche également avec les idées reçues. D’accord avec Duplessis pour garder intacte la sphère privée, ce qui permet à l’Église de contrôler l’éducation et la santé, les évêques apportent ainsi leur contribution à la production du discours politique dominant, ce qui leur retire le droit au dernier mot !
Si le miroir était moqueur, il hésiterait à dire s’il réfléchit Duplessis ou Bourassa…
La réimpression du manifeste du FLQ (Front de libération du Québec)3 soulève dans son sillage d’autres questions. Elles mettent en doute non pas notre lucidité ou notre aptitude à bien lire le passé, mais notre capacité à garder vivaces les souvenirs qui méritent de l’être. Lu à la télévision de Radio-Canada le 8 octobre 1970, le manifeste du FLQ n’a pas scandalisé. Certaines oreilles ont frétillé devant des mots inhabituels dans la bouche du Bernard Derome de l’époque, mais d’innombrables milieux ont exprimé leur connivence avec le fond du texte. Pourtant, « octobre » est demeuré une crise et n’a aucunement provoqué la mutation dont beaucoup avaient reconnu la nécessité.
Le texte même du manifeste n’a certes pas grand mérite littéraire. Les jeunes qui le liront le trouveront même terriblement daté tant il est englué dans une actualité révolue et mal stylisée. Il a cependant, ainsi que l’espère Christophe Horguelin, une valeur autre que documentaire, celle de « nommer les pouvoirs et [de] combattre l’oubli grâce auquel ils assurent leur emprise sociale ». « Je me souviens », dit la devise, mais de quoi ?
Bilans : syndicats et minorités
Le Québec a également besoin de ceux des miroirs qui lui réfléchissent le présent. À preuve les surprises que lui réservent les bilans récents qui portent sur le syndicalisme et les minorités.
Mona-Josée Gagnon parle du syndicalisme en connaissance de cause4. Non seulement a-t-elle milité vingt ans au sein de la FTQ (Fédération des travailleurs du Québec), mais en outre elle a consacré une large partie de cette période à des travaux de recherche et de réflexion sur l’activité syndicale.
Est-elle biaisée ? Oui, totalement, si l’on parle de sympathie. Oui, mais à peine, si l’on se réfère à l’image qu’elle donne du syndicalisme québécois. Le syndicalisme québécois, Mona-Josée Gagnon le voit diversifié, plus adulte qu’au temps du syndicalisme confessionnel, plus enraciné dans son terroir culturel qu’au temps des « unions neutres », moins doctrinaire qu’aux heures de gloire du marxisme tout azimut, plus apte à lire la conjoncture socio-économique qu’au moment où tout se résumait à la hausse du salaire horaire, plus ouvert aux solidarités modernes, y compris celles qui passent par le rescapage de l’emploi, plus répandu dans l’emploi public québécois que dans le secteur privé. Signe éloquent que Mona-Josée Gagnon demeure étroitement chevillée au vrai syndicalisme québécois, elle contient mal son scepticisme, et il s’agit là d’un euphémisme, à l’égard des nouvelles philosophies de gestion qui aiment bien déboucher sur des « cultures d’entreprise unanimistes ». Selon elle, le syndicalisme a tout à perdre, à commencer par son âme, dans les collaborations « fusionnelles ».
Un bilan net. Frémissant, mais honnête. Ouvert, mais sans naïveté.
Avec Julien Bauer s’ouvre, dans cette succession de miroirs, l’examen méticuleux des attitudes canadiennes et québécoises face aux minorités5. Sa plaquette multiplie les références aux textes législatifs et réglementaires, si bien qu’on n’en peut nier les conclusions. Elles n’ont rien de glorieux. Visiblement, ni le Québec ni le Canada n’osent dire exactement ce qu’ils pensent ou veulent en ces matières. Une minorité, qu’est-ce ? Des gens récemment débarqués ou, par exemple, des anglophones intégrés depuis deux siècles au tissu québécois ? On ne sait. Quelles minorités sont visibles ? Les critères flottent. Les communautés culturelles qu’évoque la législation québécoise sont-elles, indifféremment, francophones ou anglophones ? Pas certain. Ce flou est-il voulu ? En tout cas, il dure.
On peut regretter que se glissent, dans ce bilan documenté et méticuleux, quelques affirmations mal soutenues ou du moins ambiguës. Ainsi, à propos de l’élection de Juifs à Québec ou à Ottawa, Julien Bauer, présente Bercovitcz comme le premier élu juif à Québec « depuis la Confédération ». Cela est vrai, mais trompeur, Ezekiel Hart ayant été élu à Trois-Rivières dès 1804. Oublions cela : dans l’ensemble, des remarques sensées. Presque partout, des critiques utiles.
Avec Gary Caldwell6, le miroir se permet des audaces : il révèle du neuf et peut-être même une réalité qu’on préférait ignorer. Il faut toute la maîtrise et tout le courage de Gary Caldwell pour la faire voir.
Il y en a, heureusement, pour tout le monde. Le Québec francophone apprend, quant à lui, car il ne le sait pas, que le Québec anglais n’est pas monolithique et qu’il n’est aujourd’hui qu’à 50 % de tradition culturelle britannique, que le protestantisme a eu au Québec, toutes proportions gardées, une influence comparable à celle de l’Église catholique, que le Québec anglais a perdu en vingt ans un demi-million de personnes, dont un fort pourcentage de sa jeunesse instruite, que la consommation de télévision, indice irréfutable de moindre scolarité et de moindre autonomie culturelle, est désormais plus forte chez les jeunes anglophones que chez leurs homologues francophones, que les trois universités anglophones, McGill, Concordia et Bishop, desservent désormais surtout, respectivement, une clientèle juive, les minorités ethniques et de jeunes Ontariens en mal de francisation, que l’assimilation des jeunes anglophones, à en juger par le pourcentage de mariages mixtes, progresse rapidement, etc. De quoi expliquer, déclare Gary Caldwell, la morosité du Québec anglais, de quoi aussi le stimuler.
Reflet déconcertant d’un Québec très largement ignoré. Bilan qui, en conséquence, révèle un certain nombrilisme chez l’autre Québec.
« Miroir, dessine-moi mon avenir ! »
S’examiner dans le miroir, c’est aussi évaluer ses forces, mesurer l’adéquation entre soi et ce qu’exigera la traversée du temps.
Chez Bertrand Blanchet7, évêque de Rimouski, l’interrogation, bien que lucide, débouche sur l’optimisme. Les fondements de cet espoir ? Les solidarités nouvelles auxquelles s’ouvre l’époque et qui, enfin, font du Tiers-Monde, de l’environnement, de l’appauvrissement de nos proches autant d’inquiétudes quotidiennes. Défis abrupts, mais surmontables. Si on lit Mgr Blanchet tout de suite après l’analyse du discours épiscopal au temps du duplessisme, on mesurera le chemin parcouru. Certes, l’attrait d’un certain ordre de choses est toujours aussi vif, mais il est désormais proposé avec tant d’élégance que l’offre revêt presque toutes les nuances qu’exigerait un véritable pluralisme.
Du futur exigeant et serein de Mgr Blanchet, passons, le terme n’est pas trop fort, à celui dont nous menace Jean Chrétien8. Même si, en effet, la nouvelle édition reprend textuellement une bonne partie de l’ouvrage paru en 1985, la façon qu’a l’auteur de raconter sa dernière décennie ne laisse aucun doute quant à sa détermination de maintenir sa future activité politique dans les mêmes ornières. Il n’y a ici ni ouverture d’esprit, ni gentillesse, ni éclipse de la partisanerie, ni répit dans le calcul, mais la même constance dévastatrice et rentable dans l’amnésie sélective, l’allusion perfide, la distorsion des faits.
Il y a sûrement des moments dans la vie de M. Chrétien où la détente l’incite à voir gens et choses avec équité ; visiblement, la mise à jour de ce pamphlet maquillé en confidence a été un dur labeur.
De la hargne efficace, passons, sans quitter le monde politique, à la générosité la plus sympathiquement éthérée qui soit, celle de Joe Clark9. Même en tenant compte du fait que M. Clark, pour l’instant du moins, ne pratique plus la politique active, le ton demeure celui qu’il a presque constamment maintenu : celui de la main tendue, du respect, de la conciliation. Doit-on conclure que les meilleures qualités de cœur et d’esprit font les pires carrières politiques ? Peut-être pas.
M. Clark voit loin quand il conçoit le Canada comme une « communauté de communautés ». Son diagnostic est encore impeccable quand il affirme que les Canadiens ne savent rien des régions qui échappent à leur regard. Un de ses prédécesseurs, plus cynique et moins verbeux que lui, avait succinctement posé le même diagnostic en disant : « Ce pays a trop de géographie et pas assez d’histoire ! » Reste que Joe Clark sous-estime les difficultés que pose l’unité du Canada : le néo-libéralisme qu’a insufflé la Charte des droits dans la dynamique canadienne rend difficilement conciliables les vues de la société québécoise et celles du Canada hors-Québec. On s’en veut presque de faire de la peine à un politicien aussi bien intentionné que M. Clark…
Jean Larose10 ne dessine pas le même avenir que Joe Clark et il ne puise pas ses munitions chez le même dépositaire. Nous baignons ici avec volupté dans le pamphlet, non dans l’atmosphère feutrée des réconciliations. Grâces soient rendues à ceux, Pierre Foglia, Jacques Pelletier et consorts, qui, en agressant Jean Larose, ont suscité chez lui cette merveilleuse poussée d’adrénaline. On ne sait trop, en effet, tant les flèches passent drues et élégantes et tant elles transmettent de poisons meurtriers, ce qu’il faut goûter davantage, du fond ou de la forme. Ne gâtons pas notre plaisir : enfin, un pamphlet. Qui plus est, un pamphlet réussi.
Jean Larose ne le confesse pas, il s’en vante, à juste titre d’ailleurs : il est bel et bien un intellectuel. Il est aussi, autre étendard brandi hardiment, un homme de mémoire, de patience et de culture. Il veut donc que ceux qui font métier de transmettre et la culture et son apprentissage soient eux-mêmes un tant soit peu cultivés et capables de voir la différence entre le « vécu » en forme de zéro absolu de l’enfant qui balbutie et ce que ses prédécesseurs lui ont préparé comme viatique. Jean Larose est aussi, suprême cause de fierté, épris de souveraineté. Il ne la veut cependant pas rampante. Il n’a que faire des calculs comptables. Il la veut et se déclare prêt à en payer le prix.
C’est si fervent, rythmé, décapant que cela doit aussi être vrai…
Terminons en force avec le substantiel et très éclairant « collectif » qu’Alain-G. Gagnon et son équipe présentent enfin en français11, après avoir offert en anglais l’édition originale de 1983 et la version remaniée de 1993.
La première impression du lecteur en est une d’étonnement. Que vingt-quatre chercheurs, recrutés dans des disciplines différentes et depuis des horizons culturels diversifiés, dégagent, chacun à sa manière et selon son cheminement propre, à peu près les mêmes lignes de force au sujet de l’évolution québécoise, voilà, en effet, qui déconcerte. Tous ou presque constatent l’influence rapide et profonde de la nouvelle Charte des droits et notent l’ampleur du clivage que ce nouvel élément constitutionnel canadien crée entre le Québec et ce que Charles Taylor dénomme le Canada hors Québec (CHQ). Tous ou presque jugent illégitime une constitution, la même, qui entre en vigueur sans l’assentiment d’une des provinces majeures, la plupart semblent convaincus que les vues du Québec et celles, surtout, des Canadiens enracinés dans d’autres cultures que celles des « deux peuples fondateurs » sont irréconciliables, tous ou presque voient des parallèles entre l’aspiration québécoise et le plaidoyer autochtone… Et l’on pourrait allonger cette démonstration d’une convergence probante. Certains textes ressortent, malgré le haut niveau de l’ensemble, peut-être surtout ceux qui apportent à un public francophone des informations inédites ou une analyse renouvelée. Charles Taylor, toujours d’une souveraine clarté, insiste pour qu’on ne fasse pas dire au libéralisme ce qu’il ne dit pas : qu’on n’oppose donc pas, comme si le fait était avéré, l’engouement du Québec pour les droits collectifs et le biais du CHQ en faveur des droits individuels. Cela lui fournit la base logique d’où il peut isoler et pourfendre le « libéralisme de procédure ». Jacques Henripin, qu’on identifie à juste titre à tout ce que la démographie peut dire d’intelligent et de nuancé, déplore cette fois, rejoignant ainsi Gary Caldwell, l’extrême fragilité du Québec anglais. Robert C. H. Sweeny, qui enseigne dans l’extrême est du Canada, raconte l’histoire des communautés de langue anglaise du Québec en modifiant au passage des pans entiers de notre lecture du Québec…
Certes, des textes ergotent, jonglent, ronronnent, mais ceux-là sont peu nombreux. L’ensemble est d’une remarquable cohérence sans pour autant constituer une homogénéisation des perspectives.
Que retenir des images du Québec qui frémissent dans ces miroirs ? Peut-être ceci : le Québec, qui se veut nation et pays, peut tendre en même temps et sans renoncer à la moindre de ses aspirations à devenir en même temps une authentique « société de droit ». Québec n’a donc pas, semblent nous dire des analyses diversifiées et pourtant convergentes, à choisir entre son projet national et les mérites d’une véritable démocratie. Stimulant !
1. La société libérale duplessiste, 1944-1960, par Gilles Bourque, Jules Duchastel et Jacques Beauchemin, « Politique et économie, série études canadiennes », Presses de l’Université de Montréal, 1994, 435 p. ; 37 $.
2. Restons traditionnels et progressifs, Pour une nouvelle analyse du discours politique. Le cas du régime Duplessis au Québec (1940-1960), par Gilles Bourque et Jules Duchastel, Boréal Express, 1988.
3. FLQ, Manifeste, octobre 1970, postface de Christophe Horguelin, « Divergences », Les Publications du Quartier Libre, 1994, 42 p. ; 4,95 $.
4. Le syndicalisme : état des lieux et enjeux, par Mona-Josée Gagnon, « Diagnostic », Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 140 p. ; 14,95 $.
5. Les minorités au Québec, par Julien Bauer, « Boréal Express », Boréal, 1994, 126 p. ; 9,95 $.
6. La question du Québec anglais, par Gary Caldwell, « Diagnostic », Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 122 p. ; 14,95 $.
7. Quelques perspectives pour le Québec de l’an 2000, par Bertrand Blanchet, « Les grandes conférences », Musée de la civilisation/Fides, 1994, 59 p. ; 5,95 $.
8. Dans la fosse aux lions, par Jean Chrétien, L’Homme, 1994, 243 p. ; 21,95 $.
9. Plaidoyer pour un pays mal aimé, par Joe Clark, Libre Expression, 1994, 297 p. ; 19,95 $.
10. La souveraineté rampante, par Jean Larose, Boréal, 1994, 113 p. ; 15,95 $.
11. Québec : État et société, sous la dir. d’Alain-G. Gagnon, « Dossiers Documents », Québec/Amérique, 1994, 509 p. ; 39,95 $.