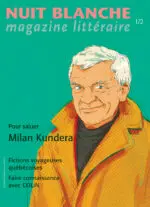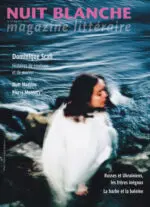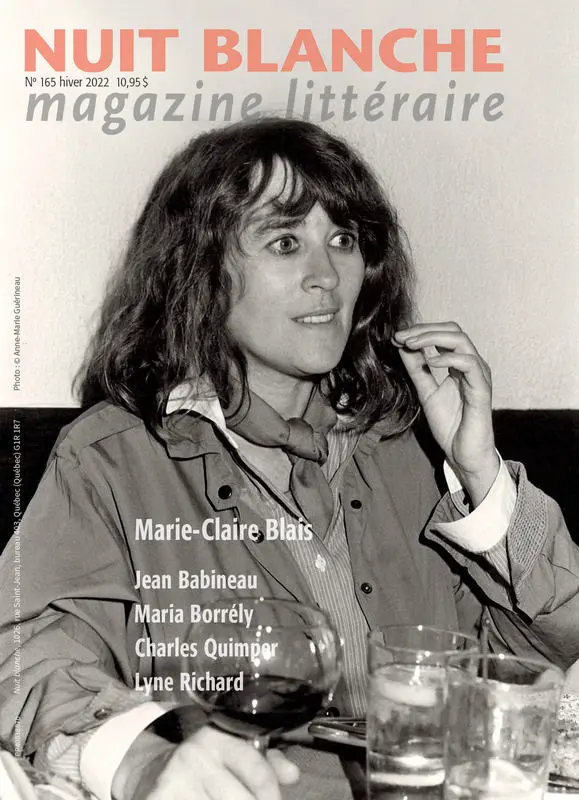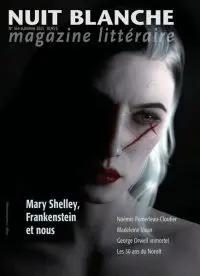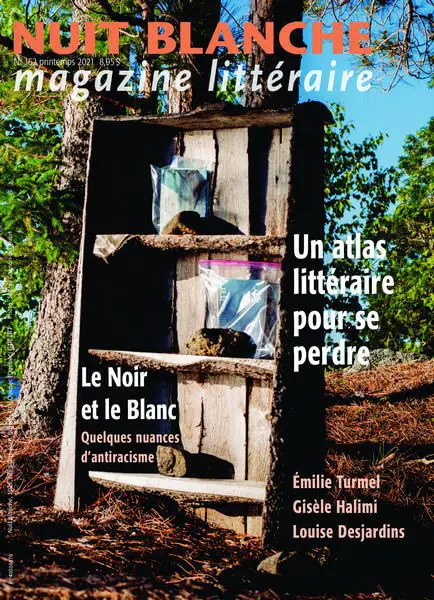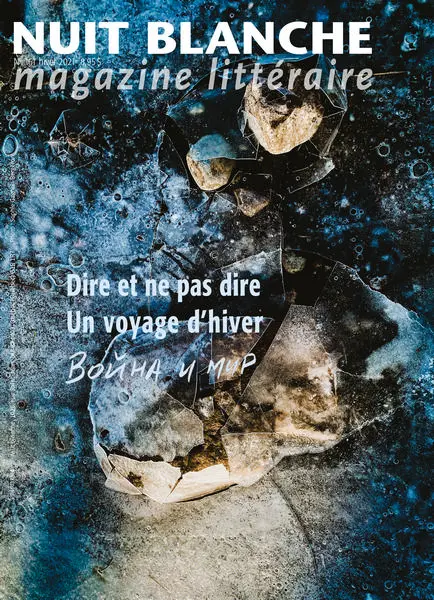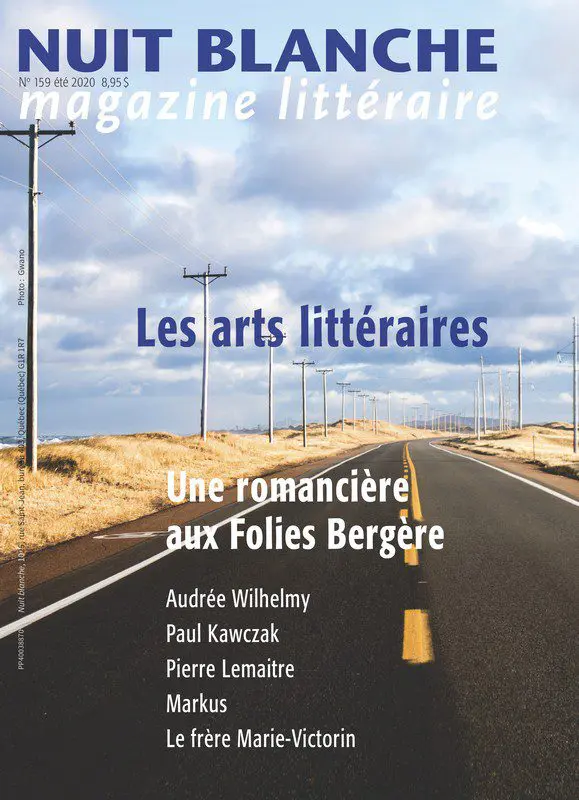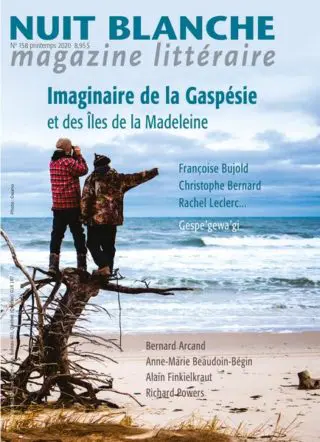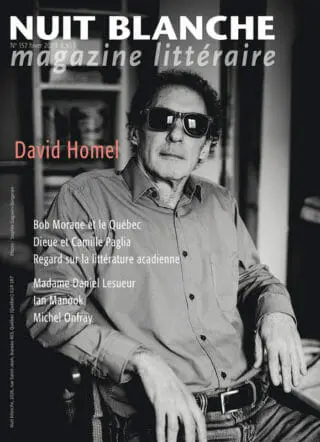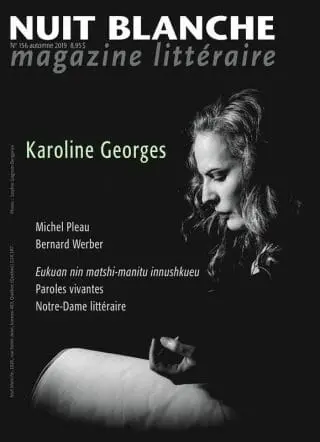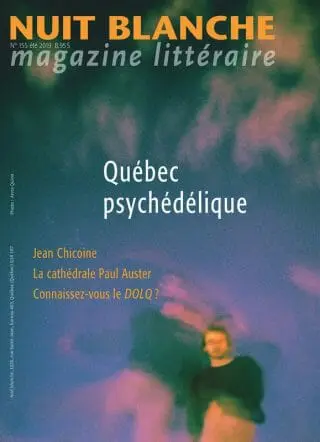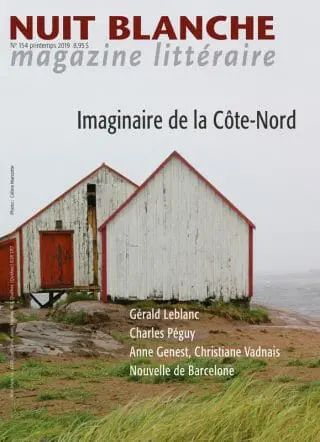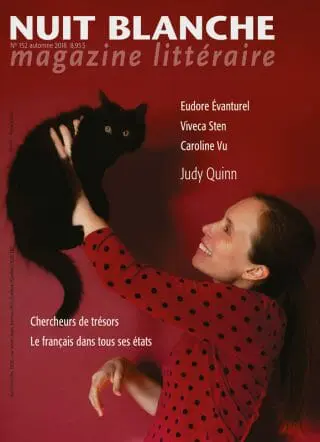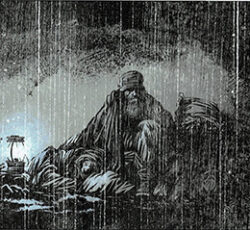Se décrivant avant tout comme un pédagogue, Jean-François Létourneau a publié un essai sur la poésie autochtone en 2017 (Le territoire dans les veines) et un roman à caractère autofictionnel en 2021 (Le territoire sauvage de l’âme). L’an dernier, il a signé, en compagnie de Sébastien Langlois, un second essai, cette fois s’intéressant à la chanson de tradition orale et à ses multiples ramifications (En montant la rivière). Depuis 2016, Létourneau agit en tant que conteur au sein du projet Marchands de mémoire, un collectif qui propose des spectacles alliant poésie, chanson et musique trad.
Poétique d’un Nouveau Monde pas si nouveau…
Dès l’introduction de ce dernier livre, qui vise notamment à faire connaître la poésie des Premiers peuples à un plus vaste lectorat, un constat est dressé : « Aujourd’hui, la scène littéraire québécoise se voit transformée par l’apport des écrivains des Premières Nations qui nous invitent à revoir notre conception de l’américanité, de l’histoire et de la géographie du continent ». Depuis quelques années, il est vrai, la vie littéraire au Québec profite d’une contribution grandissante de la part des auteurs autochtones. Songeons, par exemple, au succès que remportent Joséphine Bacon, Natasha Kanapé Fontaine ou Marie-Andrée Gill.
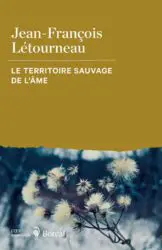 Parallèlement, le corpus étudié par Létourneau traduit un discours incitant à repenser ce qu’il conviendrait de nommer le « grand malentendu sur lequel est fondée l’Amérique », voire cette évidence suivant laquelle « aucun monde n’est apparu une première fois et aucun autre n’a remplacé ce qui existait déjà ». Ce dernier préfère d’ailleurs l’appellation américacité pour renvoyer à l’espace continental sur lequel nous évoluons, un néologisme, selon lui, plus représentatif de la réalité que l’expression consacrée Nouveau Monde. Il rappelle en outre que « l’expérience américaine, qu’elle soit intérieure ou tournée vers les grands espaces, n’a rien de nouveau ».
Parallèlement, le corpus étudié par Létourneau traduit un discours incitant à repenser ce qu’il conviendrait de nommer le « grand malentendu sur lequel est fondée l’Amérique », voire cette évidence suivant laquelle « aucun monde n’est apparu une première fois et aucun autre n’a remplacé ce qui existait déjà ». Ce dernier préfère d’ailleurs l’appellation américacité pour renvoyer à l’espace continental sur lequel nous évoluons, un néologisme, selon lui, plus représentatif de la réalité que l’expression consacrée Nouveau Monde. Il rappelle en outre que « l’expérience américaine, qu’elle soit intérieure ou tournée vers les grands espaces, n’a rien de nouveau ».
J’aurais publié dans des revues scientifiques, participé à quelques colloques. Mais j’aurais eu l’impression de passer à côté de ce qui, pour moi, m’apparaît essentiel : enseigner ces textes, les lire en compagnie de mes étudiants, en discuter avec eux, surtout, puisque j’ai la conviction qu’il est important de les lire, aujourd’hui, au Québec.
On le sent, le discours de l’essayiste est animé par un souffle sincère qui va au-delà de la critique littéraire. Nourrissant ses réflexions aux sources de la tradition orale, de l’anthropologie et de la littérature, il se penche sur les relations entre la poésie autochtone et le territoire. Il sonde avec discernement la vision du monde que véhiculent ces œuvres. Que ce soit à partir de l’énumération toponymique extraite d’une chanson de Chloé Sainte-Marie écrite par Joséphine Bacon, de vers tirés des recueils de Rita Mestokosho ou de Louis-Karl Picard-Sioui, pour ne nommer que ceux-là, il interroge les subtils rapports qu’entretient le texte avec la territorialité. Il analyse le poème dans les manières dont l’espace y est structuré, dans la façon par laquelle le créateur se positionne dans son lien avec l’environnement géographique.
[E]n parlant de leur communauté, de leur culture, de leur histoire, les écrivains autochtones ont ravivé chez les Québécois ce que l’on pourrait appeler le sentiment « sauvage » de la terre, la conscience du territoire.
Avec rigueur et doigté, et parce qu’il s’agit d’un sujet complexe et sensible, Létourneau évite le piège des généralités et la tentation des conclusions hâtives. Il rappelle au lecteur que les Premières Nations ne forment pas un ensemble monolithique. Aussi souligne-t-il qu’il serait hasardeux de classer leurs productions littéraires sous une seule et unique étiquette. De même, il remarque qu’une transformation s’est opérée au regard du discours identitaire entre les diverses générations de poètes : les plus âgés auraient tendance à articuler un message axé sur la collectivité, tandis que les plus jeunes pratiqueraient davantage une poésie de l’intimité et de l’intériorité.
Le territoire sauvage de l’âme
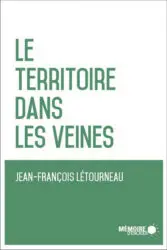 Dans le préambule du Territoire dans les veines, Létourneau traite de son expérience de pédagogue auprès des Inuits : « Je venais pourtant de compléter un baccalauréat en enseignement du français et de l’histoire au secondaire. J’aurais pu donner un cours de 60 heures sur l’Antiquité gréco-romaine sans même consulter mes notes, mais personne ne m’avait jamais parlé de l’histoire du continent sur lequel je suis né ». Dans ce livre, l’anecdote liminaire a pour but d’identifier l’élément déclencheur de l’étude entreprise par la suite. Il est cependant aisé de relever des similitudes entre ce bref passage autobiographique et Le territoire sauvage de l’âme, roman publié quelques années plus tard.
Dans le préambule du Territoire dans les veines, Létourneau traite de son expérience de pédagogue auprès des Inuits : « Je venais pourtant de compléter un baccalauréat en enseignement du français et de l’histoire au secondaire. J’aurais pu donner un cours de 60 heures sur l’Antiquité gréco-romaine sans même consulter mes notes, mais personne ne m’avait jamais parlé de l’histoire du continent sur lequel je suis né ». Dans ce livre, l’anecdote liminaire a pour but d’identifier l’élément déclencheur de l’étude entreprise par la suite. Il est cependant aisé de relever des similitudes entre ce bref passage autobiographique et Le territoire sauvage de l’âme, roman publié quelques années plus tard.
Coincé entre le Nord et le Sud
Peu de temps après avoir terminé des études en enseignement, Guillaume s’envole en direction du Nunavik pour aller y exercer son métier à l’école secondaire de Kuujjuaq. Ses connaissances des Premiers Peuples et de la vie dans le Nord sont alors très minces, pour ne pas dire qu’il ignore tout de ce qui l’attend. Une fois arrivé, il constate rapidement que le quotidien dans ce nouvel environnement comporte de nombreux défis. Toutefois, en l’espace d’une année scolaire, il réussit, grâce à sa curiosité et à sa personnalité bienveillante, à tisser des liens avec ses élèves et à gagner la confiance des membres de la communauté. Comme sportif, il devient un maillon important de l’équipe locale de hockey et, à l’école, de toutes les matières qu’il doit couvrir, c’est l’histoire de l’Amérique précolombienne qui soulève en lui le plus d’enthousiasme. Surtout, il prend part à diverses activités organisées autour de traditions culturelles qu’il découvre en même temps qu’il prend conscience de tout un pan du continent qui lui était méconnu. Au nord du 55e parallèle, le protagoniste rencontre Caroline, elle aussi venue de l’extérieur pour travailler dans le même établissement. Une relation amoureuse naît et se développe entre eux. Plus tard, ils retourneront s’établir dans le Sud, où ils fonderont une famille dans la région de Sherbrooke.
Dans ce roman, on suit le parcours de Guillaume au cœur d’une quête de sens à la fois individuelle et collective. Létourneau s’intéresse à la filiation, à l’exil et aux difficultés de communication entre des individus d’origines distinctes. Il est question de ce fossé entre les Blancs et les Autochtones que le personnage principal arrive à franchir par son désir de mieux comprendre. Sans mièvrerie, le narrateur pose un regard lucide et ému sur la situation. Guillaume parvient à ériger des ponts, mais ceux-ci demeurent fragiles. Lorsqu’il annonce à ses camarades de l’aréna qu’il envisage de quitter Kuujjuaq et d’abandonner l’équipe maintenant championne pour retourner vivre dans sa région natale, sa décision est mal reçue. Son choix est perçu comme un abus de confiance. Ajoutons que, d’un point de vue uniquement formel, la structure narrative, qui fait alterner deux trames distinctes, soit Guillaume jeune enseignant célibataire et Guillaume devenu père de famille en Estrie, renforce l’idée de clivage entre les cultures traitée dans le récit.
La musique trad en arrière-plan
Au début du roman, le protagoniste se trouve à bord d’un vol depuis Montréal vers Kuujjuaq. Mesurant du haut du ciel les immenses étendues sauvages qui séparent son point de départ de sa destination, il s’abandonne à quelques songes : « Ton père te l’a dit et répété : il y a un air traditionnel pour chaque moment du quotidien. Mais tu n’as pas envie de chanter. […] Tu as une pensée pour les voyageurs, les coureurs des bois, les gars de chantier, tous ces François Paradis perdus dans la tempête ». Plus loin, dans une lettre écrite par son paternel avant de mourir, il lit ceci : « J’avais mis de la musique traditionnelle, comme toujours, tu sais, celle avec la vielle à roue. Le son de cet instrument me fait rêver ; ça arrive du fond du Moyen Âge, des vieux pays, pis ça résonne si bien dans la maison en bois ».
Que ce soit dans les passages où Guillaume est initié à la culture inuite ou dans ceux qui viennent d’être cités, le patrimoine vivant forme souvent une sorte d’arrière-plan à ce qui est raconté. D’ailleurs, on verra que ces thèmes présents en germe, comme celui du voyageur canotier, se retrouvent dans son dernier livre en date.
La chanson de tradition orale sous toutes ses facettes
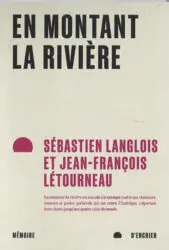 Coïncidence ou pas, c’est avec un ami de hockey, Sébastien Langlois, que Létourneau a coécrit En montant la rivière, ouvrage portant sur la chanson de tradition orale, et c’est Nicolas Boulerice, probablement le joueur de vielle à roue le plus célèbre de la province, qui en cosigne la préface.
Coïncidence ou pas, c’est avec un ami de hockey, Sébastien Langlois, que Létourneau a coécrit En montant la rivière, ouvrage portant sur la chanson de tradition orale, et c’est Nicolas Boulerice, probablement le joueur de vielle à roue le plus célèbre de la province, qui en cosigne la préface.
Prenant en compte les interprètes qui l’ont pratiquée et les spécialistes qui l’ont analysée, cet essai offre un panorama relativement complet de la chanson de tradition orale en Amérique française. Le livre ne touche pas à la musique en tant que telle ; cependant, les auteurs abordent moult aspects entourant l’histoire de cet héritage culturel incontournable au Québec. Des refrains de coureurs des bois et de bûcherons jusqu’aux plus récents métissages chansonniers, les auteurs se penchent avec rigueur et passion sur les paroles des chansons, décrivent leurs modalités de propagation et de transformation. Aussi, ils s’interrogent sur leur postérité, sur la signification de leur contenu.
Le lecteur aura tôt fait de remarquer que le propos de Langlois et de Létourneau dépasse les poncifs généralement associés au folklore québécois du fait qu’une perspective autochtone prépondérante en oriente et en éclaire la compréhension. Dès l’introduction, le duo annonce ses couleurs : « La vision québécocentriste néglige des parts importantes de la culture franco-américaine et de son rôle dans l’histoire des Amériques, de sa présence toujours vivante. Elle laisse en plan les fondements mêmes de la société québécoise, comme si la volonté de puissance de cette dernière l’aveuglait par rapport à son propre développement, incapable qu’elle est de se penser à l’échelle continentale et mondiale dans une dynamique de solidarité avec les Premiers Peuples, les communautés franco-américaines et les diverses cultures […] qui la traversent ». On le saisit, une approche globale du sujet est favorisée.
Une place non négligeable est aussi accordée aux musiciennes et musiciens de la scène actuelle tout comme à des poètes tels qu’Alfred Desrochers ou Gaston Miron qui, à leur époque, ont su intégrer des éléments de tradition orale à leur pratique littéraire. On nous fait remarquer que la poésie et la musique trad s’entremêlent parfois. En témoigne un enregistrement de « La batèche » de Miron par le groupe Bon Débarras, où une version dans laquelle les deux vers ultimes du poème : « ma poitrine résonne / j’ai retrouvé l’avenir » rappellent « le sentiment que nous ressentons lorsque nous écoutons de la musique traditionnelle ; elle résonne dans nos poitrines comme un goût d’avenir, elle nous arrive du fin fond de notre mémoire collective, transformée par la sensibilité des gens qui la font vivre en nous la partageant. Elle porte en elle nos échecs, mais aussi nos plus grandes espérances ».
En somme, cette histoire de la Franco-Amérique que les auteurs remontent à bord d’une sorte de rabaska imaginaire ouvre sur de nombreuses pistes qui mériteront assurément d’être réempruntées dans le futur. On le devine, la rivière comporte de multiples affluents. Surtout, on comprend que ce réseau complexe d’éléments finit par rejoindre une incontournable part d’universel.
Jean-François Létourneau a publié :
Le territoire dans les veines, Mémoire d’encrier, Montréal, 2017.
Le territoire sauvage de l’âme, « L’œil américain », Boréal, Montréal, 2021.
En montant la rivière (avec Sébastien Langlois), Mémoire d’encrier, Montréal, 2023.
EXTRAITS
Après tout, l’évolution de la chanson québécoise, traditionnelle comme populaire, illustre à merveille que la musique permet de nouer des relations profondes entre artistes de différentes origines et langues.
En montant la rivière, p. 89.
La parole poétique actuelle des Premières Nations est donc une invitation à repenser le rapport au territoire américain en le dissociant de l’idée du « Nouveau Monde » et en le rapprochant de la notion d’américité.
Le terrritoire dans les veines, p. 80.
Sur la glace, il t’a reconnu comme un des siens parce que tu as su réceptionner ses passes, surtout, lui redonner la puck au bon endroit. Tout est toujours une question de synchronisme. Et tu n’es pas dupe : tu as réussi le test sur patins, tu as passé sur la fesse celui du gin dans la toundra ; à la chasse avec le père Thomassie, tu seras soumis à un autre genre d’épreuve.
Le territoire sauvage de l’âme, p. 55.
Les influences culturelles qui se font entendre dans la chanson traditionnelle renvoient en un sens à la difficulté de trouver un équilibre entre le local et l’universel, entre un attachement à un peuple et son territoire et une ouverture sur le monde.
En montant la rivière, p. 165.