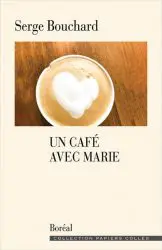Il avait la parole facile, une voix à nulle autre pareille et, surtout, une intelligence communicative. Juste avant de nous quitter, l’anthropologue des camionneurs nous offrait un nouveau recueil de quelque 70 courts essais, tranchants comme des sagaies, doux comme des galets de rivière.
Un café avec Marie est divisé en sept parties regroupant chacune une dizaine de textes et qui gravitent librement autour d’un thème. Les courts essais ont été écrits pour la radio, sauf le prologue et l’épilogue, tous deux consacrés à la compagne disparue. Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque formaient un couple médiatisé. Unis dans l’amour et la collaboration professionnelle, ils avaient signé conjointement plusieurs publications. Le deuil de l’être cher et tous les deuils associés au vieillissement sont au cœur d’un bon nombre des textes du recueil, sans jamais que cela devienne lourd. Au contraire, le propos de Bouchard a plutôt l’heur de faire paraître plus légers les soucis sur lesquels nous avons trop souvent le nez collé.
Le temps qui passe, l’amour, la mort, le doute, la soif de liberté, quel que soit le thème abordé, l’essayiste et homme de radio capte ici l’intérêt, comme il savait le faire, en abordant notre environnement social sous l’angle de la vérité toute nue. Le lecteur est souvent saisi par l’acuité des observations de l’anthropologue, non par l’effet d’un discours alambiqué, mais par un effet de contraction qui va droit au but. Pour conclure un hommage à la réflexion de Montaigne sur la nature routinière de la vie, expérience commune aux humains, il écrit : « On se douche, on mange, on fait une promenade, on lit, on écoute de la musique, on regarde par la fenêtre, on prend ses maux en patience. Et le lendemain, cela recommence. Jusqu’à ce que mort s’ensuive ».
Les écrits de Bouchard expriment souvent de la compassion pour la condition humaine, mais l’essayiste savait aussi réprouver vertement les travers institutionnalisés dont nous aurions avantage à nous délester. On comprend à certaines assertions que pour lui, la religion, quelle qu’elle soit, ne saurait être d’un grand secours pour arriver à « une société où personne ne serait oublié ». Dans un morceau savoureux, il reproche à Dieu son silence « en face de la souffrance universelle ». Par bonheur, il dit avoir vaincu ses peurs d’enfant, mais le « vieil insomniaque » qu’il était devenu craignait l’échec toujours possible de l’humanité, voyant notamment l’arrogance d’un certain président états-unien et des brutes ignares dont il s’est assuré le soutien. Par contraste, fidèle à son habitude, Bouchard célèbre dans plusieurs textes les individus effacés de l’histoire, qui ont travaillé à améliorer le sort de leurs semblables, armés de leur seule bienveillance. « Cherchons le vrai courage dans la routine, dans l’engagement, dans les travaux et les jours. » Éloge du dévouement, donc, mais aussi plaidoyer en faveur d’un plus grand respect pour la nature et pour le sauvage, dans notre environnement et en nous-mêmes. « Ne dites jamais ‘capitalisme sauvage’, car cela est une insulte pour le sauvage. Sachons que le capitalisme est démesurément civilisé. »
Écrivain à part, Serge Bouchard était un maître incontesté du texte court, de la formule lapidaire, de la sentence sans appel. Rien n’échappait à son regard aiguisé, mais son esprit critique était toujours temporisé par un sourire en coin, empreint d’une généreuse dose de tendresse pour la vie et pour ses semblables. Il ne prenait pas la pose hautaine du donneur de leçon, car, pour lui, une grande part des choses de la vie demeurait mystérieuse. Et si l’essentiel de ce que nous vivons ne peut être expliqué, il reste à le raconter, ce à quoi Serge Bouchard excellait. Sa verve et sa sagesse vont beaucoup nous manquer.