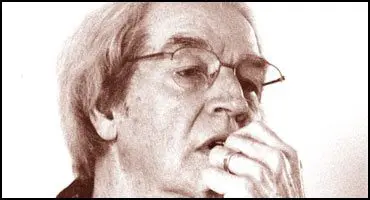Dans la quiétude de la maison où me parviennent les cris des premières bernaches, le soleil de fin d’hiver tombe à plein sur le livre ouvert devant moi. Ô saisons, Ô châteaux : l’exercice d’un esprit toujours en éveil, mais qui se donne avec calme, voire nonchalance, sans apitoiement, sans rigidité théoricienne et métaphysicienne, qui, cependant, touche l’essentiel.
Et une verve savoureuse, une langue à la fois charnue et légère. Une merveilleuse fraîcheur. Cette lecture : un moment de pur bonheur.
Sous ce nostalgique titre emprunté à Rimbaud sont assemblées des chroniques nées du quotidien. Un arrêt à un feu rouge, la sieste dans un hamac, une lettre d’amis, et voilà que surgissent une méditation sur le temps, un art poétique là où on l’attendait le moins ! Et alors que la réflexion risque de s’appesantir ou de se draper, une drôlerie la ramène à plus de modestie et à moins de sérieux : la référence à Montaigne dans toute l’œuvre donne le ton juste.
Voilà bien en effet cet homme d’une extrême, d’une profonde simplicité, courtois, discret, souriant, qui nous reçoit dans sa maison d’une petite ville de l’Estrie. Ses voisins ignorent qu’il est l’un des grands écrivains de sa génération. Ce citadin né dans un quartier populaire de Montréal dont le souvenir traverse la poésie comme une lumière grise, avec les ruelles, les trottoirs sous la pluie, la neige, où l’on marche le cœur lourd comme si jamais l’horizon ne devait s’ouvrir, cet universitaire spécialisé dans la littérature médiévale, a choisi loin de la foule et des gratte-ciel, une retraite. Il se consacre au soin des fleurs et des arbres, il dessine, il relit Tchekhov et Hölderlin, les philosophes, Platon, Cioran, Charles Taylor, quelques romans. Il note dans ses cahiers des images, des bouts de phrases, des vers, dont sortiront patiemment des livres patients, recueils de poèmes ou courts essais. Ou bien les notes resteront à l’état de notes – et c’est sans importance. Jacques Brault n’a jamais conçu la création comme la construction méthodique et laborieuse d’une pyramide, il n’a pas connu l’obsession narcissique de « faire une œuvre ». Un titre s’est ajouté aux autres, presque sans que l’auteur l’ait voulu. Combien de ses livres sont nés ainsi, à peu près dans tous les genres, à la jonction de la curiosité et des circonstances?
Hasards de la prose
Dans les années soixante, il écrit des pièces radiophoniques habilement conduites, Trois partitions – « pour voir comment c’est fait » : elles auraient pu verser dans le naturalisme misérabiliste, mais elles émeuvent par la compassion pour la souffrance des très petites gens, leurs vies sans joie. Les essais ? Pour répondre aux offres de Liberté ou d’autres revues. Agonie (1984), l’unique récit publié à ce jour ? Peut-être pour donner forme à un vieux souvenir : un étudiant raconte, et un professeur, vieux garçon moqué de tous, un jour, stupéfie son auditoire en expliquant un poème de Giuseppe Ungaretti, avant de disparaître pour on ne sait quelle destinée. Jacques Brault est conscient qu’il ne lui appartient pas d’inventer des personnages, des situations, une intrigue. Bâtir un roman implique tant de longueurs, de temps faibles, d’artifice aussi, avant d’arriver à l’essentiel. Cet essentiel que permet – et qu’exige – la poésie.
« La poésie sert à désigner la région où tend notre voyage »
Si chez Brault les formes que prend le langage ont beaucoup évolué depuis les premiers recueils des années soixante, sa poésie trouve tôt ses sources et ses fidélités. Les titres mêmes les désignent et ponctuent l’itinéraire. Mémoire, La poésie ce matin, L’en dessous l’admirable, Il n’y a plus de chemin. Très tôt aussi se révèle à lui la nudité de la vie. « Visitation » (qui ouvre l’anthologie du Noroît) est l’entrée de l’œuvre et déjà, comme par anticipation, son résumé (si tant est qu’on puisse parler du résumé d’une œuvre poétique !), sa substance. Chez ce poète nourri de littérature médiévale, bien plus qu’une influence, passe l’appel pathétique de Villon :
« Mes amis moissonneurs mes amis au profil de matin maigre mes amis souvenez-vous
« Quand vous serez revenus à la patrie du sommeil et dociles enfants de votre mort […]
« Souvenez-vous mes amis souvenez-vous de ceux
« Qui demeurent et de leur exil ».
Jour après jour, nuit après nuit, la solitude, la pauvreté, l’errance à travers la grande ville, les rues sous le crachin, le ciel plombé de novembre, la neige sale. Le cœur lourd paraît à tout moment vouloir renoncer. Mais il continue de battre, obstinément. L’image de l’ami, l’image d’une femme, éclairent la nuit intérieure comme des petites flammes, comme des icônes.
Quel étrange pays que celui où vit le poète ! Mais en est-ce bien un ? Où sont ses frontières, qui l’habite, quelle langue y parle-t-on, où est son âme ? S’il en a une. Pays hostile, inerte, « d’où l’on ne part jamais », qu’on voudrait accabler encore plus, et fouetter, haï et aimé. Tout comme pour « Miron le magnifique » – c’est Brault qui le nomma ainsi –, conquérir le pays est infiniment plus qu’un projet politique. Jacques Brault s’est expliqué là-dessus – un peu savamment dans ses premières chroniques de Liberté à une époque où, dit-il, il se prenait au sérieux –, et sur un mode combien plus direct, charnel, affectif, dans ses poèmes. Par son histoire personnelle il appartient à l’histoire du pays, les deux indissociables : le père silencieux, humilié, « balayeur appointé » devient, préservé par la mémoire et sans cesse résurgent, le signe de cette histoire. La pauvreté de l’enfance, à la limite de la misère, l’écrivain l’a vécue, et quand il parle des humbles, des clochards, des réprouvés, les souvenirs se lèvent, des ombres qui ne s’effacent que pour revenir, qui forment une cohorte muette, attentive, obsédante. Une foule familière. Parfois l’une des ombres parle, ou le poète s’adresse à elle, à moins qu’il ne se parle à lui-même, à ce Personne d’Il n’y a plus de chemin, paroles pauvres comme celles qu’articulent, plutôt qu’ils n’échangent, les personnages du « vieux Sam » (Beckett). Un soliloque où celui qui parle rit de lui-même, et du langage qui voudrait devenir trop noble, trop précieux, dérisoirement éloquent. Il arrive que le poème se brise sous l’excès de souffrance, le langage se désarticule (« Bruit et silence », La poésie ce matin) : il n’en reste qu’un peu de bruit sur fond de silence. Ou bien des rumeurs perdues dans la conscience qui en charrie le flux. Des voix se superposent, interfèrent. Des états vagues que la perception, le sentiment, la pensée sont impuissants à cerner. Un monde cotonneux, celui de l’intérieur aussi bien que celui de l’extérieur, jeu de reflets et d’ombres, évanescent et incompréhensible. Plus qu’une expérience ponctuelle, qu’un événement daté, ce glissement, cet enfoncement vers une vie minimale est le mal-être. Monte parfois une invocation, ou une incantation, ou une supplique « À l’inconnue » :
« Écris-nous que c’est beau un matin comme les autres matins
« comme un malgré tout lucide et tranquille […]
« ô ma nouvelle-née en image ta bouche endormie sur l’oreiller
« c’est ma bouche ouverte en espérance la tendresse
« oui la tendresse du temps » (La poésie ce matin).
Souffrance, espérance, désespérance perdent alors leur signification – ou laissent entrevoir un au-delà, qui est sans doute la mort. « Ce fut atroce, nul amour, nulle haine ne me rejetaient même du côté de la mémoire » (L’en dessous l’admirable). Le poème ne peut plus être un chant, tout au plus un cri étouffé, des bribes de voix qu’au sortir de l’épreuve des fragments de journal rétrospectif pourront à peu près cerner et relier. Le miracle est que, en acceptant « la descente en solitude », la remontée est possible : « Mais au retour – par je ne sais quelle alchimie – j’ai vu, j’ai touché l’impensable et le plus simple. Je ne dirai pas son secret ; le dirais-je qu’il ne subsisterait plus parmi nous ». Ce qui a alors été entrevu ? « Le chant de l’indicible », L’en dessous l’admirable.
Métamorphose du poème
La « descente en solitude », Jacques Brault la partage avec Alain Grandbois, qu’il a connu. « Nous étions ensemble dans la subtile lumière de septembre, rieurs et graves, accordés aux petites choses si aptes à signifier les grandes » (Ô saisons, Ô châteaux). Cet homme à la fois brillant et secret possédait l’art de narrer ses aventures hors du commun – se laissant parfois emporter par ses récits au-delà de la vérité historique Il avait connu les mondains et les gens de sac et de corde, les palaces et les bouges, les monuments de l’Europe et les déserts d’Asie centrale sur les traces de Marco Polo. L’auteur de Mémoire, à son tour, est fasciné, et il pratique alors lui aussi une poésie au souffle ample, volontiers oratoire, qui parfois doit se défendre contre une tendance à la dilution et des pointes de rhétorique. Mais Jacques Brault ne s’en tient pas là, le mouvement intérieur qui le porte impose d’autres formes. Le poème se fait à l’occasion tâtonnant, lacunaire, cassé, anguleux. Il vise, de plus en plus, à l’économie. L’expression se décante, s’épure, se condense à l’extrême : « L’effet haïku résulte d’une traversée de la sensation et d’un retentissement consécutif, de la pensée inchoative et qu’on n’arrive plus à congédier, même en état de rêve ou de rêverie » (La poussière du chemin). Rigueur et éclat : un rapprochement parfois fulgurant s’est produit, le lecteur en reçoit à son tour le choc dont les échos se prolongent en lui.
« l’eau ne fait pas d’ombre
« au temps qui coule en l’obscur clapotis des jours » (Au bras des ombres).
La poésie, croit-on généralement – le surréalisme a beaucoup contribué à nous en convaincre – est affaire d’images. Elle repose essentiellement, affirme Jacques Brault avec vigueur, sur le rythme. Hector de Saint-Denys Garneau l’avait bien compris1. Grandbois aussi. Dans l’anthologie qu’il lui a consacrée, Jacques Brault montre avec une grande subtilité combien Grandbois cherche en diverses retouches le rythme le plus juste, le plus expressif. Ou encore, à l’occasion d’une autre anthologie qu’il a composée, combien Jules Laforgue – pour qui il a gardé une ancienne tendresse –, sous beaucoup de clinquant verbal et d’effets trop voyants, donne au poème son assise rythmique, puis la bouscule, la fait basculer à l’improviste.
On l’a répété : il faut à la poésie sans cesse se réinventer. Ce n’est pas là programme d’un manifeste, ni formule à graver au fronton d’une académie, mais pratique d’artisan qui agence la phrase, le vers. Les poètes et la poésie se donnent parfois de grands airs. Humblement, Jacques Brault déclare : « J’écris pour avoir lu et pour mieux lire. Écrivain amateur, je considère l’écriture comme un bricolage, comme une débrouillardise à la fois angoissée et désangoissante » (La poussière du chemin). Ce n’est pas prendre le contrepied de la facile mythification de la création poétique, ni la déprécier mais bien la saisir dans son geste et, sous le paradoxe apparent, en affirmer l’efficacité et la grandeur.
« Si la poésie commence par une rupture, elle s’achève par une soudure ». Après le déchirement des fibres intimes, il faut essayer de guérir, et réconcilier. D’abord faire en sorte que la vie soit possible dans son quotidien. Comme pour Apollinaire dont Brault a si bien parlé, chaque matin apporte ses surprises, ses richesses qu’on ne voyait pas. Mais c’est désormais un quotidien éclairé des profondeurs – peut-être par une lumière noire ? Elle traverse les couches de l’existence, dont les plus superficielles, les plus immédiates, qui par là se trouvent métamorphosées. On pourrait dire mieux : transfigurées. Combien d’entreprises jugées importantes, d’attitudes dites sérieuses deviennent dès lors nulles et non avenues ! Jacques Brault cultive depuis toujours l’art et le plaisir de dégonfler la cuistrerie où qu’elle soit, dans le jargon critico-universitaire, dans le discours politique ou médiatique, partout où « la confusion joue à la complexité ». « L’homme du quotidien » qu’il est considère la vie moderne avec une curiosité non dénuée de crainte. Il cherche à voir clair, refuse de se « laisser téléguider par les normes sociales ». L’esprit de Montaigne, bien sûr ! Il consiste à préserver en tout temps une intransigeante liberté de jugement et de mouvement.
La main au travail
En 1979, Jacques Brault écrivait cette phrase étonnante, qui nous pousse à nous récrier : « Je ne suis pas un écrivain très doué », que complète celle-ci : « Apprenti je reste et je resterai ». Comment mieux dire la modestie de l’écrivain, mais aussi la conscience qu’il a de la création : toujours en marche, jamais arrivée. Disponible, ouverte, à l’écoute du temps et des présences, attentive au souffle même de la vie, donc à la fois fugace et continue, imprévisible. « Sitôt qu’on a trouvé on a perdu ». Le constat vaut pour le poème tout autant que pour le dessin. Jacques Brault le pratique depuis longtemps : l’encre, le crayon (et aussi la gravure), mais, dit-il,
« J’aime l’aquarelle à l’égal
« de la pluie au fort de l’hiver
« quand de longs poils très souples
« effacent d’une haleine liquide
« le blanc des rues et des champs » (Au bras des ombres).
Traces d’un geste qui se suffit à lui-même, effleure le papier ou appuie, s’étale en tache ou s’enlève dans le délié d’une volute. Touches de couleur denses, serrées – et cela peut être un sous-bois d’automne –, frottis dans le vert, le gris, le rose – et cela devient un jardin suspendu. Le pinceau chargé d’eau fait un lavis, revient presque à sec, et voici un envol d’oiseaux au-dessus du marais, une grue, un héron dans son équilibre parfait. Ici, des couleurs en replis secrets, là un calligramme à déchiffrer à notre convenance, là encore un trait capricieux comme une branche de pommier (Transfiguration). Mais la main ne cherche pas à représenter, à l’occasion elle rencontre une forme reconnaissable, puis à nouveau elle s’échappe.
Jacques Brault a beaucoup fréquenté les ateliers de peintres et de graveurs : Albert Dumouchel, Roland Giguère, Gérard Tremblay, Jeanine Leroux-Guillaume, Paul Beaulieu. Il leur a consacré des chroniques, s’est interrogé sur les rapports entre écrire et dessiner. Il convient de réfléchir, certes, mais surtout de faire. Sa curiosité le pousse à toujours expérimenter, qu’il s’agisse de découvrir des formes visuelles neuves, de mettre à l’épreuve, d’essayer un procédé pictural. Ou d’écrire un livre à deux voix : Au petit matin (avec Robert Melançon), Transfiguration (avec E.D. Blodgett). Autrefois il lui arrivait de fabriquer des épouvantails, aujourd’hui il leur consacre un texte : « Saurons-nous un jour de folie venteuse, et comme les pissenlits neigeux et tenaces, nous envoler vers un autre nous-mêmes? – en patrie profonde? » (Trois fois passera).
Le dessin, la poésie, toute l’œuvre de Jacques Brault connaît le poids de la matière, de la chair, la douleur tapie au creux de l’âme, qui enchaîne, aveugle, asphyxie, tout ce qui en nous est pesanteur. Mais aussi elle connaît l’envol, la légèreté qu’on peut nommer – que l’on donne ou non au mot sa connotation religieuse –, la grâce de plus en plus présente.
Le sourire du Tao2
Que s’est-il passé chez Jacques Brault depuis le temps de la pauvreté journalière, des petits métiers alimentaires, des études, des luttes contre l’étouffement, depuis la résistance aux orthodoxies de tout bord, les polémiques, l’Université, l’époque des premiers poèmes souvent lourds d’angoisse et de déréliction, des plaies à vif, de la grisaille ou de la noirceur ? Rien n’a été oublié, la mémoire continue de faire inlassablement son travail, rien n’a été renié, mais, me semble-t-il, il s’est produit en profondeur une détente. Jacques Brault aime parler du cerf-volant qui s’envole, plane, plonge, se relève selon les courants de l’air. Non pas passivité et fatalisme – il convient seulement (mais tout est là!) de permettre aux événements de se produire. Le non-agir. Nous y sommes ! Jacques Brault se réfère explicitement au taoïsme, il le fait passer en lui, ou plutôt, à sa manière, il se coule dans le Tao.
« Ne rien laisser derrière soi au moment de partir, pas une miette, pas l’ombre d’un souffle, tel est l’enseignement. Il ne s’agit pas d’une facilité, encore moins d’une démission, mais d’une reconnaissance de l’inconnu. » (Ô saisons, Ô châteaux)
Tout à l’opposé d’une religion dogmatique ou d’un système philosophique, d’une construction cérébrale : une sagesse.
Dans cette œuvre nous frappe l’action des pôles opposés entre lesquels elle se développe et se vivifie. Création dans le verbal et dans le pictural ; ampleur du poème et sa réduction à la concision du haïku ; attention à la banalité parfois triviale du quotidien et éclat fulgurant de l’intuition ; déchirement de l’âme et contemplation apaisée ; rigueur de la réflexion et finesse de la sensation. On pourrait citer bien d’autres oppositions, que résume le jeu du yang et du yin.
Ajoutons celui-ci encore : humour et gravité. « Quel humour insondable gît au cœur de la mélancolie ». Je suggère à Jacques Brault que la formule pourrait être retournée, et qu’elle pourrait composer un autoportrait… Une mélancolie qui n’est pas sentiment d’impuissance mais plutôt effet de la lucidité face au monde, aux hommes, à soi-même.
L’écriture intimiste
Dans une chronique de La poussière du chemin (1989), Brault faisait remarquer que la littérature québécoise présente des poètes plus que des penseurs, et que le passage du sensible à l’intellectuel n’y est pas encore vraiment opéré. Parfois « elle bafouille ou se guinde ». « La légèreté, l’ellipse, la limpidité, l’humour souvent en sont absents, ou bien dévalués ». En lisant Au fond du jardin (1996), l’évidence s’impose : Jacques Brault a trouvé le passage, Accompagnements d’écrivains rencontrés au détour d’un livre, et qui se prolongent secrètement ; on devine qu’ils sont Tchekhov et Virginia Woolf, Proust et Kafka, Mme de Sévigné et Crébillon, Katherine Mansfield, Borges ou « le vieux Sam », et, bien sûr, « maître Michel » (Montaigne). Propos de deux pages, dans la lignée d’Alain , complets en soi mais poussant de fines antennes, où chaque phrase est une pensée vivante. Admirable prose d’une totale maîtrise, toujours appropriée à son objet, variée dans l’attaque, le rythme, le ton, pleine d’imprévu, rebondissante, libre, allègre et tranquille. En deux mots : probe et juste. L’auteur dit de Valery Larbaud qu’il « tient à honneur de ne pas écrire plus haut et plus large que nécessaire ». Telle est la vertu de ce que Jacques Brault désigne lui-même comme l’écriture intimiste : « Les intimistes, les vrais, qui ne cèdent pas d’un millimètre à l’intimidation, vivent pour l’ordinaire dans l’utopie et l’anarchie. Leur vie est ailleurs. Où? Trouver à répondre annulerait l’ailleurs ». Écrire à partir de soi-même mais par la pratique d’autres écrivains, d’autres esprits, dans l’échange avec eux. Écriture qui ne refuse pas le lyrique au profit du laconique, mais qui unit l’un à l’autre.
Nous ne sommes qu’au matin de nous-mêmes. Tout est possible.« J’habite une espérance désespérée qui n’a pas besoin de se dire, encore moins de se justifier », écrivait Jacques Brault vers 1980. Ou encore : « Je n’ai rien à donner que la tendre et cocasse dilection qui m’empêche de tout à fait désespérer ». Aujourd’hui on peut sans doute dire que l’homme et sa poésie tendent vers un point qui n’est plus une conscience tragique de notre condition irrémédiablement déchirée, mais un au-delà de la désespérance et de l’espérance, une acceptation du vieillissement, un consentement à la mort comme à la vie dans sa douleur et ses émerveillements, une paix.
Silence, retraite, compassion et détachement, tendresse, vibration intérieure, perception aiguë de la beauté partout où elle se trouve : peut-on encore distinguer ce qui définit un art poétique et ce qui anime une vie ? Parfois entravé et retombé mais renaissant, multiple en ses gestes, ses formes, ses couleurs ; un dans son élan, irrésistible: le mouvement vers l’être !
1. Rappelons que Jacques Brault a établi avec Benoît Lacroix une édition critique des Œuvres de Saint-Denys Garneau, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1970.
2. Pour reprendre le titre du livre de Lawrence Durrell.
Jacques Brault a publié entre autres :
Poésie : La poésie ce matin, Parti Pris, Montréal, 1973 ; Poèmes des quatre côtés, Le Noroît, Montréal, 1975 ; Les hommes de paille, Grainier, Montréal, 1978 ; Vingt-quatre murmures en novembre, Le Noroît, Montréal, 1980 ; Trois fois passera précédé de Jour et nuit, Le Noroît, Montréal, 1981 ; Moments fragiles, Le Noroît, Montréal, 1984 et Le Noroît, Montréal/Le Dé bleu, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 1994 ; Poèmes I (regroupe Mémoire, La poésie ce matin, L’en dessous l’admirable, Moments fragiles, Il n’y a plus de chemin), Le Noroît, Montréal/La table rase, Cesson, 1986 ; Il n’y a plus de chemin, Le Noroît, Montréal/La table rase, Cesson, 1990 et Le Noroît, Montréal, 1993 ; Au petit matin, avec Robert Melançon, L’Hexagone, Montréal, 1993 ; Poèmes choisis de Jacques Brault, cassette audio, textes lus par l’auteur, Le Noroît, Montréal, 1994 ; Poèmes choisis (1965-1990), Le Noroît, Montréal, 1996 ; Au bras des ombres, Le Noroît, Montréal/Arfuyen, Orbey, 1997 ; Transfiguration avec E.D. Blodgett, Le Noroît, Montréal/Buschek Books, Toronto, 1998.
Prose : Trois partitions, théâtre, Leméac, Montréal, 1972 ; Agonie, roman, Le Sentier, Montréal, 1984 et Boréal, Montréal, 1985 et 1993 ; La poussière du chemin, Boréal, Montréal, 1989 ; Ô saisons, Ô châteaux, chroniques, Boréal, Montréal, 1991 ; Au fond du jardin, Accompagnements, Le Noroît, Montréal, 1996.
Essai : Chemin faisant, La Presse, Montréal, 1975 et Boréal, Montréal, 1994 ; Alain Grandbois, Seghers, Paris, 1968 ; St-Denys Garneau, Œuvres, avec Benoît Lacroix, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1970 ; Que la vie est quotidienne, anthologie d’œuvres de Jules Laforgue, La Différence, Paris, 1993.