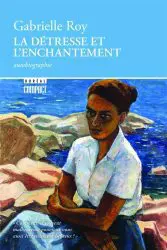Superbe livre1 écrit au soir d’une vie, qui la rassemble et la raconte.
Cette vie a d’abord été celle des Canadiens français vaillants et fiers abandonnés dans les plaines du Manitoba, et l’auteure serait demeurée prisonnière de leur solitude n’eût été le désir obstiné de suivre son « instinct migrateur » qui, après avoir poussé ses ancêtres vers l’ouest, la ramène vers l’est. Et n’eût été l’écriture.
À un premier degré de lecture le livre, comme maints autres qui l’ont précédé et dont celui-ci paraît la synthèse, porte témoignage de l’exil d’une communauté distincte par sa langue, sa religion, ses racines, son héritage culturel. Gabrielle Roy dit « avoir beaucoup souffert de cette distance que les Québécois mettaient alors et mettent encore entre eux et leurs frères du Canada français ». Elle veut rapporter « la pauvre histoire tout embrouillée de vies humaines égarées dans l’histoire et dans l’espace ». Ces lignes impliquent qu’elle ne se préoccupe pas seulement du sort de son entourage : elle veut donner une voix à tous ceux qui souffrent de solitude et d’abandon. Alors qu’on a pu constater chez elle l’attention extrême qu’elle portait à sa personne et à l’élaboration de son œuvre, ce livre est tout empreint de tendresse, d’une sollicitude héritée des parents, spécialement de la mère, qui par leur travail incessant et l’économie ont voulu assurer le bien-être de la famille et préserver son unité menacée de se rompre. Sa compassion, elle la prouve, entre autres circonstances, quand peu avant son retour de France elle prête assistance aux réfugiés espagnols qui, traqués par les soldats de Franco, tentent de passer la frontière.
Les principaux épisodes de sa vie sont bien connus puisqu’ils nourrissent l’ensemble de l’œuvre. La naissance à Saint-Boniface, les études à Winnipeg, l’enseignement dans des villages perdus, le théâtre, qu’elle crut d’abord sa vocation, dans une troupe de jeunes amateurs, les séjours à Paris puis à Londres, la Provence, le retour au Canada peu avant qu’éclate la guerre. Le récit s’achève sur l’installation dans une chambre de Montréal alors que ses premiers écrits lui permettent de gagner quelque argent. Elle revient avec le sentiment d’un échec.
L’autobiographie n’est donc que partielle puisqu’elle couvre la période de l’enfance jusqu’au début de l’âge adulte. Même si elle envisageait de la compléter2, il n’y avait sans doute plus rien d’essentiel à raconter puisque les romans prenaient la relève et que sa vie désormais s’identifiait à leur écriture. La narration, témoignant du goût de raconter que l’auteure dit hériter de sa mère, atteint ici sa perfection. Dense, animée, fluide, elle se déploie avec un égal bonheur dans le dessin des personnages et des scènes, la description des paysages, l’évocation des ambiances, l’émotion et la réflexion, le drame et l’humour.
Un récit et un autoportrait, celui-ci se nuançant et se montrant en situation à travers celui-là. Gabrielle Roy ne semble guère portée ici à s’épargner quand elle avoue ses « manquements », la mauvaise conscience attachée à ses silences envers sa mère – on s’étonne qu’à son retour d’Europe elle n’aille point la voir. Le trait dominant et fortement souligné est le passage rapide et répété du « côté gai » de sa nature au côté gris ou noir. D’une part, la recherche du contact et la facilité à l’établir en toutes circonstances, à charmer, à entraîner, à appeler la confiance et la confidence. De l’autre, elle se refuse, s’enferme dans les ruminations et l’apathie. Mais elle rebondit ! À l’image de ses personnages les plus attachants, vulnérable, fragile et forte, exultante dans la joie ou plongée dans la noirceur. Après la folle équipée en Provence alors que la guerre est imminente, la dépression dans une lugubre chambre de Montréal. L’alternance si justement signalée dans le titre et qui se répète selon un rythme inéluctable confère au récit son mouvement, sa respiration profonde. L’attente passive, la difficulté à choisir et à décider et un certain « effroi » devant l’amour finissent par la paralyser dans sa relation avec Stephen comme ce fut déjà le cas dans sa jeunesse, années de tâtonnements, d’irrésolution, de doute, avec ce malaise récurrent de se sentir partout étrangère, en France, en Angleterre comme déjà au Manitoba. Elle est comme une boussole qui oscille longtemps avant de se fixer sur le nord mais quand elle y parvient, elle ne s’en écarte plus. Gabrielle Roy y parviendra : elle trouve son lieu en l’écriture.
Dualité aussi dans les paysages qui, bien plus que les décors d’une vie – et ses symboles –, en sont les éléments actifs, donc inséparables. Entre la maison, « partie vivante » d’elle-même, la « quiétude du petit coin à soi » et l’appel irrésistible de l’immense plaine, inlassablement décrite, présence inoubliable qui inspire une véritable « folie ». Les routes qui la sillonnent suscitent ensemble « un espoir fou » et la mélancolie profonde toujours affleurante, toujours de grandes émotions, mais elles délivrent enfin la souffrance retenue.
À travers ces réalités sensibles est vécue une expérience fondamentale, celle de l’être. Gabrielle Roy en est bien consciente même si elle n’en parle pas en ces termes. Plénitude connue dans « l’enchantement », en des moments de bonheur parfait, d’expansion intérieure, en ces « haltes merveilleuses » qui ont ponctué son existence. Puis elle s’efface pour retomber dans la « détresse », proprement le vide. La vie se passe ainsi dans ces basculements où la personne redécouvre ce qu’elle a voulu oublier, le transitoire et la perte, sa condition mortelle et la peur – pour Gabrielle Roy terrible – d’être abandonnée dans la mort.
On ne peut guère lui attribuer une « philosophie » en ce sens qu’elle ne manie pas des concepts et des abstractions, encore moins n’échafaude un système, mais à coup sûr une « vision » du monde fortement, intensément incarnée : elle réagit aux lieux et aux êtres et en  écrit magistralement en les restituant dans leur présence immédiate. Le désir lui est tôt venu de faire passer dans des mots la « palpitation » qu’elle sentait en elle. Elle griffonnait avec ardeur mais l’exaltation retombée, ne restaient que des phrases inertes. Il fallait tout reprendre pour, comme Tchekhov y réussit entre imagination et réalisme, « dire vrai ». Peu à peu vient la confiance « et, dit-elle, alors j’ose m’élancer dans ce travail sans fin, sans rivage, sans véritable but ». Travail qui fait d’elle comme elle le dit ailleurs « une sorte de guetteuse des pensées et des êtres », mais qui oblige à négliger les devoirs quotidiens, l’amour et l’amitié, qui absorbe toutes les énergies au point que peut-être il n’en reste plus pour vivre. Pour elle comme pour tous les grands créateurs le conflit s’est présenté, qui semble ne devoir se résoudre que par le sacrifice et dans l’insatisfaction. Elle le sait mais persiste avec courage, au prix de bien des souffrances. Certes elle s’est donné le droit de ne pas tout dire mais elle nous communique avec une force qui nous émeut en profondeur l’enchantement qui parfois l’a habitée, la lumière qui parfois l’a éclairée. Et aussi un inépuisable étonnement condensé dans cette phrase de La route d’Altamont : « Oh, que cet univers est donc étrange où nous devons vivre, petites créatures hantées par trop d’infini ! »
écrit magistralement en les restituant dans leur présence immédiate. Le désir lui est tôt venu de faire passer dans des mots la « palpitation » qu’elle sentait en elle. Elle griffonnait avec ardeur mais l’exaltation retombée, ne restaient que des phrases inertes. Il fallait tout reprendre pour, comme Tchekhov y réussit entre imagination et réalisme, « dire vrai ». Peu à peu vient la confiance « et, dit-elle, alors j’ose m’élancer dans ce travail sans fin, sans rivage, sans véritable but ». Travail qui fait d’elle comme elle le dit ailleurs « une sorte de guetteuse des pensées et des êtres », mais qui oblige à négliger les devoirs quotidiens, l’amour et l’amitié, qui absorbe toutes les énergies au point que peut-être il n’en reste plus pour vivre. Pour elle comme pour tous les grands créateurs le conflit s’est présenté, qui semble ne devoir se résoudre que par le sacrifice et dans l’insatisfaction. Elle le sait mais persiste avec courage, au prix de bien des souffrances. Certes elle s’est donné le droit de ne pas tout dire mais elle nous communique avec une force qui nous émeut en profondeur l’enchantement qui parfois l’a habitée, la lumière qui parfois l’a éclairée. Et aussi un inépuisable étonnement condensé dans cette phrase de La route d’Altamont : « Oh, que cet univers est donc étrange où nous devons vivre, petites créatures hantées par trop d’infini ! »
1. Gabrielle Roy, La détresse et l’enchantement, Boréal compact, Montréal, 1996.
2. En 1997 est paru Le temps qui m’a manqué, suite inachevée de La détresse et l’enchantement. Voir « L’empreinte des grandes rivières », p. 45.
EXTRAIT
J’allais, moi une étrangère, en toute liberté au milieu de cet inimaginable bouleversement, et je me demande encore comment cela a été possible. Je crois me rappeler qu’il y eut jusqu’à cent mille réfugiés d’entassés, certains jours dans ce village de Prats-de-Mollo qui ne devait pas compter plus de deux mille habitants à demeure. On faisait des prodiges […]. J’apportais ma petite aide […]. J’errais à travers ces errants un peu comme Pierre Bouzoukow de Guerre et paix sur le champ de bataille, incrédule, confondue, ne croyant pas au fond de mon âme à ce que je voyais […]. J’imagine avec peine avoir été un témoin – privilégié ? – de ces terribles heures de l’Histoire.
p. 489