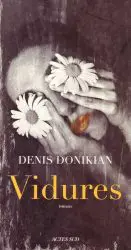Vidures. Ce qui est vidé et jeté. Les ordures crevées par des chiffonniers dans une décharge en Arménie. Les hommes, les femmes et les enfants qui en vivent. Des vies dures. Elles sont devenues les rebuts d’une société malade, elles s’empoisonnent le sang des émanations pestilentielles, empestent la décomposition, suintent, grognent, de plus en plus courbées, pour finalement disparaître sous les tonnes de détritus d’Erevan, la capitale arménienne. Elles n’auront pas droit à une tombe dans le cimetière bâti juste à côté ; le revers d’une même pièce.
Dans ce pays très enclavé, réduit à dix pour cent de son territoire originel, chacun essaie comme il peut de survivre à un passé traumatisant : le génocide de 1915, encore nié du côté turc, et plus récemment, en 1988, le tremblement de terre qui a dévasté une partie du pays. Il y a aussi la corruption que ne manque pas d’évoquer l’auteur dans de savoureux dialogues entre chiffonniers philosophes, et ses corollaires, l’arbitraire, l’injustice, l’écart entre riches et pauvres. « Aujourd’hui, poursuivit Edik, quand je pense à Noubarachèn, à ses prisonniers d’opinions, à ses chômeurs, à ses vieux, je pense à un stockage de vidures. »
On suit ainsi pendant une journée un abonné de la décharge, Gam’, dans sa quête quotidienne des bouts de métal et autres trésors dont la population ne veut plus. Empruntant à l’Ulysse de Joyce, Vidures donne une multiplicité de points de vue de cette journée tout en faisant éclater les formes : dialogues de théâtre, chants grecs, portraits, etc. disent ici de façon tragi-comique la souffrance du petit peuple. Il en résulte une certaine surcharge, beaucoup de paroles, dont les allusions souvent politiques demeurent obscures pour le néophyte. Quelques notions d’histoire sont donc essentielles pour apprécier l’humour de l’auteur, mais son style vivant, coloré, pour ne pas dire libre, donne des ailes à un message parfois lourd.