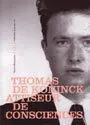La préfacière Catherine Morency a raison : le devoir de mémoire est trahi lorsque disparaît une personnalité significative avant que quelqu’un en ait obtenu une forme ou l’autre de testament spirituel. Dans le cas de Thomas De Koninck, mission accomplie, longtemps d’avance espérons-le.
L’homme, en effet, est de ceux qui, déjà, ont marqué la vie collective, mais plus encore l’âme et l’esprit de ceux et celles qu’il a côtoyés, formés, équipés. Rares sont, en tout cas, les universitaires qui auront autant que Thomas De Koninck rempli et dépassé les exigences fondamentales de leur statut, d’abord celles de la pédagogie, mais aussi celles de la compétence, celles d’une pensée profonde, celles d’un intérêt pour tous les savoirs. Thierry Bissonnette, qui a profité des cours du philosophe et qui, longtemps après, a repris contact avec lui, en fait la démonstration adéquate et chaleureuse. De Koninck, pourrait-il affirmer, n’a pas choisi, il a tout pris. La philosophie l’occupe jusqu’à sa dernière fibre, mais les sciences en font presque autant, comme la littérature, les arts, le sport. Le temps et l’espace eux-mêmes se plient à ses ambitions, puisque De Koninck fréquente les présocratiques sans jamais négliger les penseurs modernes, d’où qu’ils soient. Aucune dispersion là-dedans, pas non plus de survol en lointaine altitude, mais l’amour et la proximité pour tout ce qui nourrit l’être humain, l’exhausse, l’interroge. Tout s’intègre à une ample unité, car tout est recentré sur « l’expérience intérieure qui caractérise la phénoménologie, afin de dénouer l’antagonisme entre le concept et la singularité humaine ». Bissonnette souligne, à juste titre, le culte que porte à l’émerveillement le pédagogue De Koninck. Sans lui, rien ne pénètre en profondeur. Lorsque surgit son étincelle, la capacité d’accueil s’amplifie.
De Koninck n’en arrive jamais à la possession béate de la vérité. Non seulement sa recherche demeure active et vigilante, mais telle forme de doute lui paraît souhaitable : « […] il y a la pratique du doute qui est un point de départ indispensable à toute authentique réflexion, philosophique ou autre ». Il pourra, par conséquent, écouter en lui la foi et la raison, sans les fracasser l’une contre l’autre, sans demander aux deux la même chose.
Très sagement, Thierry Bissonnette a choisi le ton de l’hommage, remettant à plus tard et peut-être à d’autres mains le soin de décrire les positions de De Koninck sur l’université, la violence, la télévision, la lecture…