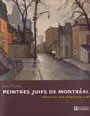Dans la première moitié du XXe siècle, à cause de la valeur symbolique des villes dans l’esprit des artistes et du public canadien, leur goût pour le paysage rendait inintéressantes les images que pouvaient suggérer les grandes métropoles comme Montréal. Pourtant, dans les années trente et quarante, à Montréal, les peintres juifs ont fait de la ville et de la vie urbaine les sujets dominants de leur production. Les raisons de ce fait sont diverses et peuvent être recherchées dans les domaines socioéconomique et politique mais aussi, et pourquoi pas, dans le domaine de l’esthétique pure. L’exposition Peintres juifs de Montréal, Témoins de leur époque 1930-1948 nous en apporte la preuve.
Pour accompagner cette exposition, les éditions de L’Homme ont réalisé un catalogue richement illustré avec un texte clair et méthodique d’Esther Trépanier sur les peintres juifs et la modernité, texte publié initialement en 1987, repris et mis à jour. La peinture dont il est question dans cet ouvrage se caractérise par une nette dominance de la forme par rapport au contenu, d’une part, et, d’autre part, par un contenu résolument de son temps puisqu’il montrait un mode de vie que l’on disait « moderne » et qui, à l’époque, ne se trouvait que dans des villes comme Montréal. Ces artistes juifs ont donc joué un double rôle dans les débuts de la modernité de la peinture canadienne.
Ce catalogue nous instruit sur les différents sujets traités par ces peintres. Il y a bien entendu la ville, avec les formes nouvelles, plus rectilignes qu’elle propose, avec aussi des thèmes que suggère son industrialisation. Il y a les portraits réalisés par des peintres partageant les mêmes conditions précaires que leurs sujets, des portraits d’autant plus vrais qu’ils sont en quelque sorte créés de l’intérieur. Il y a des scènes du quotidien, de la vie de jour avec ses inquiétudes, de la vie de nuit et ses dérives. Il y a aussi des œuvres qui abordent le politique en veillant à cet équilibre fragile qui empêche l’art d’abandonner ses fonctions premières pour se faire outil de propagande. Il est intéressant, enfin, que cet ouvrage de référence nous fasse connaître la vision qu’en avait la critique de l’époque, francophone ou anglophone, sachant que chacun de ces groupes linguistiques et culturels ont eu leurs propres idées esthétiques et politiques.