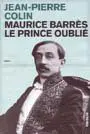Quand il en va de Maurice Barrès, écrivain autrefois adulé, on sent que l’histoire a tranché. Le voilà devenu « infréquentable », ainsi que le résume un blogueur. Malgré quelques tentatives récentes : une biographie signée Sarah Vajda chez Flammarion, un premier roman de Jérôme Fronty en 2005, Cavale-toi, Barrès, ou l’édition de correspondances inédites (avec Verlaine, Rachilde, Anna de Noailles ), rien n’y fait : c’est toujours la vision (hélas fondée) de l’historien Zeev Sternhell, associant Barrès à un proto-fasciste, qui l’emporte. L’actuelle mise au ban de Barrès a des précédents jusqu’aux dadaïstes, qui intentèrent en 1921 à cet ancien « Prince de la jeunesse » un simulacre de procès au chef d’accusation éloquent : « attentat à la sûreté de l’esprit ». C’est dans un tel contexte d’antipathie que l’ouvrage ‘ fin et complet ‘ de Jean-Pierre Colin vient redonner l’heure juste.
Sans doute l’auteur du Culte du moi ne retrouvera plus un lectorat aussi étendu qu’au tournant du XXe siècle. Mais Stendhal (qu’il admirait tant) ne s’adressait-il pas à des happy few ? On croit tout savoir sur Barrès ; pourtant, Maurice Barrès, Le prince oublié est un texte important pour signaler toute la part (elle est considérable) de ce qui n’a guère été dit sur l’écrivain-député, notamment en ce qui concerne son rôle de « visionnaire méconnu ».
Cette bibliographie subjective, qui suppose un minimum de familiarité avec l’œuvre barrésienne, constitue une contribution remarquable à l’histoire des idées littéraires et politiques. Colin semble avoir tout lu Barrès, ce qui n’est pas un mince exploit. Que retenir de Barrès en cette aube du XXIe siècle ? Le Barrès styliste, affirme Colin, qui le dépeint comme le Saint-Simon de la IIIe République, un Barrès davantage soucieux de cultiver son style que de contrôler la cohérence de ses propos. D’où son insoupçonnable actualité.