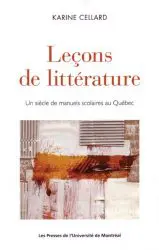De l’Histoire de la littérature canadienne (1874) d’Edmond Lareau à l’Histoire de la littérature québécoise (2007) de Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafargue, nombreux sont les tableaux, panoramas et autres études synthétiques sur le sujet. Karine Cellard a retenu de cet ensemble particulier douze manuels utilisés dans les institutions scolaires en vue d’examiner le discours pédagogique sur l’histoire littéraire québécoise, dont elle procède à « la lecture […] comme texte » ; d’où l’utilisation abondante des concepts de mise en intrigue ou en récit, de structure ou de configuration narrative, de stratégie discursive, d’organisation temporelle, de posture d’énonciation… Karine Cellard suit ainsi « la lente consolidation d’une tradition d’interprétation du corpus national et les variations importantes qui ont marqué les visées identitaires, civiques ou culturelles de cet enseignement ». Elle note au passage les influences et les modèles (français) suivis, rappelle le contexte scolaire dans lequel s’inscrivent les manuels convoqués et fait état du développement de la critique et de la recherche universitaire au fil des ans.
La traversée panoramique de Karine Cellard va de la description de la « triple inspiration française, nationale et catholique » du Manuel d’histoire de la littérature canadienne-française (1918 ; remanié en 1930 et en 1939) de Camille Roy à l’analyse de la fonction critique cédant son rôle à l’histoire dans les trois manuels publiés en 1996 dans la foulée de la « réforme Robillard » (1994), soit ceux de Michel Laurin (Anthologie de la littérature québécoise), de Heinz Weinmann et Roger Chamberland (Littérature québécoise des origines à nos jours) et de Luc Bouvier et Max Roy (La littérature québécoise du XXe siècle). Entre les uns et les autres, l’essayiste évalue l’« idéologie implicite du consensus social » du Précis d’histoire littéraire (1928) des Sœurs de Sainte-Anne, et l’approche humaniste de Samuel Baillargeon dans sa Littérature canadienne-française (1957), de Roger Duhamel dans son Manuel de littérature canadienne-française (1967) et de Paul Gay dans Notre littérature, Guide littéraire du Canada français (…) (1969). Elle expose de même les méthodologies variées de l’Histoire de la littérature canadienne-française par les textes (1968) de Gérard Bessette, Lucien Geslin et Charles Parent, et de l’Histoire de la littérature française du Québec (1967-1969) publiée en quatre volumes sous la direction de Pierre de Grandpré.
Malgré un échenillage incomplet, repérable notamment lors de voyantes coquilles et dans des graphies onomastiques erronées (par exemple Luc Lacoursière [huit fois], David Haynes [neuf fois], Gustave Lanctôt, Jean-Pierre Hudon, pour Jean-Paul), l’ouvrage de Karine Cellard affiche une qualité de contenu indéniable et l’on comprend que la thèse de doctorat qui en est l’origine ait obtenu le Prix d’excellence 2008 de l’Association des doyens des études supérieures au Québec.