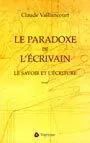Romancier et nouvelliste, Claude Vaillancourt se fait cette fois essayiste, manifestant que ses activités de professeur l’ont conduit à scruter non seulement les œuvres et les textes, mais aussi l’écrivain tel qu’en lui-même. Il aurait été regrettable qu’il n’ose pas ce regard, car il effectue cet examen avec une double compétence et une grande finesse.
Les questions de Claude Vaillancourt ouvrent de stimulantes perspectives. Jusqu’où le romancier doit-il pousser la recherche ? Peut-on espérer que la littérature se libère des contraintes de l’immédiateté ? Quel espoir s’offre à l’auteur d’une petite nation ? Pourquoi, après avoir tant profité de l’État-nation, les cultures qui comptent plusieurs siècles tiennent-elles tant à réduire les aspirations des jeunes collectivités au rang de folkloriques et obsolètes « crispations identitaires » ? La lecture est-elle désormais soustraite à l’accusation d’amollir les âmes ?
Certaines réponses de l’auteur ne feront pas l’unanimité, mais toutes forceront ses lecteurs à explorer à sa suite ou avec lui les paradoxes débusqués au cours de son survol. Il n’est pas certain, par exemple, que la création littéraire soit incompatible avec la spécialisation. Le roman dit historique mérite peut-être un peu plus de considération, surtout si l’on songe, en plus du Roman de la rose d’Umberto Eco, aux oeuvres de Jeanne Bourin, de Jean Bédard ou de Maryse Rouy. Et les auteurs des débuts du XXe siècle reçoivent chez Jean d’Ormesson par exemple des éloges dont Claude Vaillancourt est un peu avare. Cela dit, ses réflexions se fondent sur de vastes lectures, une fréquentation intelligente des meilleures plumes et, répétons-le, une appropriation personnelle du métier d’écrivain. Cela donne le droit d’exprimer des préférences.