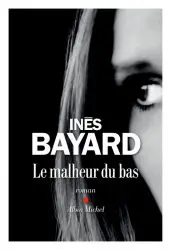Ce premier roman d’Inès Bayard, Le malheur du bas,expose la lente dépossession de soi d’une jeune femme, Marie, à travers une série d’agressions sexuelles qui l’amènent à perdre la raison, jusqu’à retourner la violence contre elle-même et sa famille. C’est sur cette scène proleptique, celle de meurtres disséqués méthodiquement par l’entremise d’une narration externe, que s’ouvre le roman. Le mari gisant à terre, dans le sang et le vomi. L’enfant, dans son rehausseur, la tête enfouie dans les restes de son repas. Et Marie, « la seule à être restée droite autour de la table », dont on comprend qu’elle est l’instigatrice du drame. Mais gardons-nous d’émettre des jugements, nous dit la narration. La suite du roman servira donc à expliquer le drame.
Marie mène une vie bourgeoise dans le XIearrondissement de Paris, dans un grand appartement où elle reconduit avec bonheur les schémas familiaux traditionnels. Un mari avocat, un poste de conseillère en patrimoine financier dans une grande banque et un projet d’enfant viennent compléter le tableau. Marie maîtrise parfaitement sa vie. Un soir, alors que son vélo est vandalisé, le directeur de la banque lui offre de la reconduire chez elle. Avant de la laisser partir, il la viole sauvagement, par tous les orifices, sur le siège de sa Mercedes. Marie n’en parlera à personne, choisira d’étouffer sa colère au creux de sa chair, plutôt que de connaître la honte et l’humiliation d’une dénonciation, malgré l’enfant qui grandit dans son ventre, dont elle est persuadée qu’il est le fruit de son agression, qu’elle haïra comme elle haïra son mari, aveugle à sa détresse, qui utilise son corps comme un objet sexuel.
Le viol est décrit dans les moindres détails, avec des mots crus, jusqu’à la nausée et l’écœurement, comme les viols rejoués dans le cadre conjugal. Les figures du directeur et du mari se mêlent si intimement qu’il n’est plus possible pour Marie de les distinguer. Il s’agit de la même bête sadique incapable de refréner ses pulsions. Même le sexe de son fils la dégoûte. Tel est le malheur du bas, n’être « qu’un trou. Un immense vide de chair molle. Un désert coupable et humide au centre duquel l’homme, tel Dieu, perce sa voie ». Ce qui dérange dans le roman d’Inès Bayard, ce n’est pas la représentation du viol, mais le discours que cette représentation soutient, les clichés qu’elle reconduit, malgré le scandale de l’agression, en essentialisant les rôles sociaux et en naturalisant les rapports de domination. Les hommes ont des besoins sexuels qu’ils ne peuvent refréner et les femmes sont fragiles, innocentes. Érotisme et prédation vont de pair, et le viol s’avance comme une fatalité entre les sexes, dont on ne parvient à s’extraire qu’en retournant la violence contre soi, en faisant d’autres victimes.
L’écriture tranchante d’Inès Bayard montre le viol sans détour et pénètre à l’intérieur du corps, dans la chair, pour en exposer les souffrances. Si l’agression n’est pas banalisée, elle se présente néanmoins comme un châtiment bien mérité, une sorte de prix à payer pour la vie confortable que Marie a menée jusque-là. Ni la culture du viol, ni les rapports d’emprise au sein de la relation conjugale ne sont pris en considération. Le viol est traité hors de sa dimension sociale, pérennisant dans l’imaginaire l’impunité de l’agresseur.
LE MALHEUR DU BAS
- Albin Michel,
- 2018,
- Paris
267 pages
26,95 $
Loading...
Loading...
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...