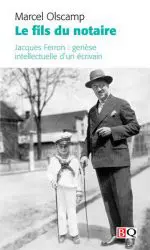Publiée en 1997, la biographie aujourd’hui mise à jour retrace le parcours de l’écrivain et certains mouvements intellectuels, politiques et sociaux qui traversent le Québec des années 1920 à 1950.
Qu’on connaisse bien, un peu ou pas du tout la vie de Jacques Ferron, qu’on l’ait lu ou qu’on ne sache rien de son œuvre ou à peu près, on gagne à lire cette biographie et à la méditer : l’époque qu’elle couvre, l’approche somme toute simple du biographe, les incursions dans une partie du système scolaire de ce monde disparu – le plaisir que j’y ai pris logeait dans l’un ou l’autre des différents aspects du livre. On pourra compléter cette lecture par une ou deux des études sérieuses que suggère Olscamp. Quant à la prose du biographe et à sa méthode, je me limiterai à dire qu’elles sont efficaces et claires. Les interprétations d’Olscamp empruntent à gauche et à droite, jusque dans les contes ferroniens, emprunts qui soulèvent encore une fois la question délicate du caractère documentaire des fictions, de ce qu’on peut ou non leur « faire dire », et de quelle manière un conte parle de la vie de son auteur. Le caractère documentaire de certains contes semble évident pour le biographe.
La perspective biographique adoptée ici réside dans le titre, capital. Le fils du notaire repose ainsi sur le rapport au père (qui traîne aussi, un tant soit peu, un rapport à la mère), le rapport à l’autorité qui fonde en grande partie notre conception du monde et nos regards sur lui. Je suppose que ce titre a été réfléchi, soupesé. Appuyé sur les témoignages de Ferron lui-même, sur ceux de ses sœurs, sur sa correspondance et d’autres documents et témoignages directs et indirects, Olscamp dévoile le rapport ambivalent de Jacques Ferron aux Caron (le côté maternel, famille fortunée, prêteuse) et aux Ferron (le père, milieu modeste, humilité), ainsi que son dualisme face au passé. D’ailleurs, c’est toute l’enfance de Jacques qui semble avoir été habitée par cette dualité, si l’on en croit Olscamp, et par une sorte de pirouette où la modestie des Ferron va les rendre tout à coup plus honorables, et où la gloire rattachée à l’ascendance maternelle devient surannée et entachée.
J’ignorais à peu près tout de la vie de Ferron, et c’est pourtant une vie passablement autre que je me serais imaginée ou que je lui aurais prêtée. Je ne savais pas et je n’aurais jamais conçu la tendresse du collégien Ferron pour Paul Valéry. Je n’aurais pas imaginé ses louvoiements idéologiques (qui n’en a pas ?), sa « méfiance ontologique devant les privilèges ». Ni sa mauvaise conscience, son ambivalence, sa culpabilité, le reniement politique : « Ferron est amené à nier son adhésion au communisme […] ; il semble ainsi se désolidariser de ses camarades ». Ferron était jeune, excusons-le.
Je ne suis pas d’accord avec l’idée qu’une vie a une direction et un sens, qu’une vie se règle, se planifie, s’organise comme un projet. Olscamp le suggère par endroits. Il travaille à coups d’hypothèses, il construit, c’est un choix peut-être obligé, analogue à celui de Ferron lui-même, qui s’est également fabriqué une image de soi satisfaisante. Olscamp présente à deux ou trois occasions des hypothèses comme des faits ou des quasi-faits, mais il ne s’en cache pas : il observe ainsi à propos du communisme ferronien que si le « moment et la cause précise de cette conversion ne peuvent être déterminés avec exactitude ; les textes de l’époque […] permettent cependant d’identifier une conjonction de facteurs qui paraissent avoir influé sur son comportement » (je souligne).
L’étude de Marcel Olscamp s’interrompt en 1949. On attend la suite avec curiosité.