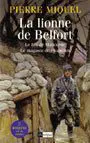Publiés d’abord en 1987, 1990 et 1992, les trois romans donnent une éloquente idée du style et des perspectives de ce prolifique historien et conteur. La guerre occupe une place privilégiée dans son œuvre gigantesque, mais on aurait tort de réduire l’ensemble ou même ce trio à une chronique des tranchées, des collaborateurs ou du maquis. La stratification sociale dont Zola et Balzac, en leur temps, ont vertement dénoncé les méfaits, Miquel la constate dans la France du XXe siècle. Il la met en scène et l’analyse avec rythme, culture, lucidité. Elle sévit dans l’armée au point d’en tirer un décalque du pays usuel. Elle y maintient les privilèges de la naissance et répartit sans la moindre équité risques et tributs. Le noble, respectable ou baudruche, passe du salon à un poste de commandement, tandis que l’humble conscrit sert de chair à canon et de hochet. Du moins jusqu’à ce que gronde l’indiscipline et que le peloton d’exécution fasse retentir la sanction suprême. Cela constituerait une charge par trop monolithique si Miquel n’y faisait pénétrer une rigueur d’ordre sociologique en même temps qu’une compassion offerte à tous les humains, riches ou pourvus. Dans toutes les strates, se côtoient l’humanité et le sadisme. Dans La lionne de Belfort, l’officier au sang bleu est capable d’héroïsme gratuit en même temps que d’amitié hors cadre, capable aussi d’aimer une femme au passé incertain et à la culture inexistante ; sa lâcheté, ce sera de laisser déferler l’orgueil de classe de sa mère, orgueil meurtrier et pourtant étale. Dans Le fou de Malicorne, le clivage ignore les origines familiales pour leur substituer la force des convictions personnelles : le père et le fils se dressent l’un contre l’autre d’implacable manière. Dans Le magasin de chapeaux, toute la société française subit la tentation du compromis avec l’occupant, le vertige de la dénonciation dictée par la rancune et le mercantilisme, le soupçon généralisé et la fuite éperdue vers une sécurité quotidiennement remise en question. « Cette guerre, déclare un personnage, ne laissera personne indemne. C’est de l’intérieur que les hommes souffriront le plus ». Toujours et partout la guerre, mais la guerre comme catalyseur du meilleur et du pire. Entre le premier roman et le troisième, Pétain lui-même perd son prestige et connaît le naufrage dont se moquait de Gaulle.
Une dimension retient l’attention : le poids, toujours sous-évalué, que la guerre jette sur les épaules des femmes. L’humble et amoureuse Gabrielle se rebiffera quand elle croira entendre dans la voix de Jean la condamnation de sa liberté sexuelle. « Un garçon de ta force, solide et sain, ne connaît pas le désespoir. Vous mourez à la guerre, mais vous avez un grade, un matricule, ils vous saluent, ils vous encensent. Vous êtes les héros de la nation. Laissez-nous mourir en paix. Nous n’avons d’autre monde que celui du silence et de l’anonymat. Grises de visage, grises de peau, grises des pieds à la tête… »
À la fois roman et enseignement historique.