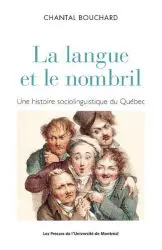Compte tenu de l’actualité du sujet et de la qualité du contenu, une réédition de cet ouvrage paru à l’origine en 1998 était tout à fait indiquée.
Les Québécois ont toujours entretenu un rapport équivoque avec leur langue. Toujours ? Non ! Au temps de la Nouvelle-France, la question de la « qualité de la langue » ne se posait pas, et d’ailleurs les visiteurs sont unanimes à l’époque pour dire que le français de la colonie est le même qu’à Paris. Après la Conquête (que notre auteure appelle ici « Cession »), on surfe allégrement sur cette idée acquise pendant quelques décennies, jusqu’à ce que, épouvantés, on se rende compte autour de 1840 que notre langue est devenue « rustre » aux oreilles des rares Français qui nous entendent. C’est alors tout un branle-bas de combat qui s’organise : il faut à tout prix préserver notre français, le laver de ses taches. Naissent alors les guides « Dites / Ne dites pas », qui proliféreront pendant plus d’un siècle. Le discours alarmiste proprement dit prend son essor après la Confédération (« L’anglicisme, voilà l’ennemi ! » – J.‑P. Tardivel, 1879) pour atteindre un paroxysme culpabilisateur avec la querelle sur le « joual » dans les années 1960. Aujourd’hui, les Québécois assument mieux leur spécificité linguistique, mais un déchirement demeure entre « la norme » et « l’usage », déchirement d’autant plus complexe que la définition de « la norme » (québécoise ? française ? « internationale » ?) ne fait pas elle-même l’unanimité.
C’est l’histoire du regard que les Canadiens français jettent eux-mêmes sur leur langue que nous raconte ici Chantal Bouchard sur la base des sources écrites sur la question de 1850 à 1970 environ. Il est intéressant de constater qu’avant cette période, les écrits sur le français au Canada ne portaient pas sur la qualité de la langue, mais bien sur le droit de l’utiliser dans un pays tombé dans l’escarcelle britannique.
Encore aujourd’hui, les livres qui abordent directement ou indirectement la question de la langue sous l’angle sociologique ne manquent pas au Québec. Celui de Chantal Bouchard se démarque en ce qu’on n’y détecte aucun programme politique : son but n’est pas de défendre l’idée qu’il faille préserver la « pureté » ou la qualité de notre langue, mais il n’est pas non plus de chercher à décomplexer à tout prix les Québécois en invalidant la notion même de norme. La chercheuse se positionne dans une optique neutre qui vise à comprendre nos ancêtres et à décrire leurs attitudes et comportements, sans préjugés téléologiques. Non seulement c’est tout à son honneur, mais cela révèle un respect de l’intelligence du lecteur qui mérite d’être mentionné.
De fait, beaucoup de linguistes, sociolinguistes et autres commentateurs de notre époque s’emploient à critiquer l’idée que les Québécois doivent s’en remettre à la France pour établir leur norme linguistique. Cette position se justifie indéniablement sous plusieurs angles, mais dans la foulée, on en vient assez fréquemment à mépriser, voire à ridiculiser cette idée d’un alignement sur la France et les origines de cette vision des choses, qui découlerait d’une mentalité de « colonisés » dont les Québécois devraient à tout prix s’affranchir. À l’issue d’une mûre analyse des textes de nos ancêtres, Bouchard met au jour une autre cause de cette position : en 1841, le gouvernement britannique adopte officiellement une politique d’assimilation des francophones, et à partir de la fin du même siècle, l’idée que les Canadiens francophones ne parleraient pas le « vrai français » mais plutôt un French Canadian Patois décadent devient courante et profondément ancrée dans le monde anglophone nord-américain. Or, si les Canadiens français veulent faire reconnaître leur langue comme langue officielle dans un pays conquis par la plus grande puissance de la planète, ils doivent absolument s’appuyer sur le prestige de la langue de Molière ; si leur langue n’est plus qu’un patois, c’en est fini de sa reconnaissance politique. D’où la nécessité absolue de réaligner la langue française des Canadiens sur le français de France, afin de déjouer les arguments méprisant de la classe dominante canadienne-anglaise.
Cette dimension essentielle n’élimine certes pas les autres, et l’étude des arguments avancés pour accepter ou non tel ou tel aspect du français canadien recèle des questions sociolinguistiques intéressantes que l’auteure analyse aussi avec rigueur. On ne peut que savoir gré à Chantal Bouchard d’avoir fait ressortir cet enjeu particulier dans son étude, un ouvrage passionnant qui nous fait traverser plusieurs époques en décrivant les faits avec une clarté digne de mention et des anecdotes mémorables.