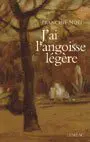Le dernier roman de Francine Noël est un addenda inattendu à la trilogie lancée avec Maryse. œuvre imprévue mais reçue comme une agréable surprise, J’ai l’angoisse légère répond néanmoins à la hantise première de tout critique : parler pour la première fois d’une auteure vraiment aimée pour dire qu’il s’agit là du texte le moins réussi d’une carrière littéraire autrement exemplaire. Ce qui ne veut pas dire que le lecteur n’y trouvera pas son compte : les personnages de la Tribu sont toujours là, attachants, bien construits, l’intimité de quelques familles se conjugue toujours avec aisance dans le monde social médiatisé, l’ironie est encore fine. Tout, pris individuellement, est intéressant : le portrait du milieu des performances artistiques, l’examen du deuil de François, les amitiés sincères qui survivent aux douleurs et au passage du temps, l’oscillation entre les générations, les nouveaux départs qui butent contre des blessures mal guéries.
Autrement dit, retrouver Myriam, François, Marité, Elvire, découvrir Garance, approfondir le regard de Félix, refaire connaissance avec l’intelligente ironie de Francine Noël, voilà une perspective exaltante. Mais ce roman urbain, célébrant le parc La Fontaine, centré sur la création littéraire et théâtrale, sur la dissidence et la question épineuse de la réaction des jeunes femmes émancipées devant les voiles religieux, abandonne en quelque sorte la trajectoire antérieure des trois romans. Si les œuvres sortaient de la chronique pour intégrer une trame narrative de plus en plus serrée, bien que fondée sur la multiplicité des personnages de provenances diverses, et surtout si elles prenaient faits et causes pour une lecture continentale de la réalité québécoise, notamment en inscrivant la langue espagnole (ce que le dernier roman poursuit) au cœur du récit et en déplaçant l’intrigue au Mexique, dans un grand geste d’ouverture, le dernier tome de la série effectue une certaine déflation. Récit du repliement devant la petite apocalypse ayant frappé le clan, J’ai l’angoisse légère compromet, à mon sens, la cohérence des trois premiers romans, en circonscrivant puis en abandonnant l’utopie baroque formulée à la fin de La conjuration des bâtards. Même si les évocations des Métis de l’Ouest, les parties de soccer et de hockey visionnées dans l’effervescence multiculturelle et les provocations de Garance rejouent ces thèmes chers à Noël, l’ensemble du portrait est d’abord intimiste, plus proche de La femme de ma vie que de Myriam première.