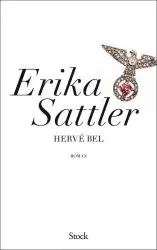L’essentiel de ce quatrième roman d’Hervé Bel est constitué de la fuite, à partir du 16 janvier 1945, d’une jeune militante fanatique nazie, Erika Sattler, alors que les troupes russes avancent résolument vers l’Allemagne. Hitler, en plein désarroi, se suicidera trois mois plus tard.Malgré la débâcle, Erika garde foi dans le Reich, au nom duquel les exactions commises à l’encontre des Juifs et des ennemis du parti sont à ses yeux nécessairement justifiées. Zélée, elle a d’ailleurs dénoncé le frère de son mari parce qu’il critiquait le Parti ; son mari lui-même, un SS déchu auquel le roman consacre plusieurs pages, ne reçoit d’elle que mépris en raison de son indulgence envers les prisonniers dont il a la charge. Depuis son adhésion aux Jeunesses hitlériennes, en 1936, puis au Parti nazi au début de la guerre, Erika vit le national-socialisme comme un « poème épique ». En dépit de mille difficultés, elle parviendra à échapper aux bombes, à la violence et à la mort, car la beauté étincelante de cette femme à l’âme noircie lui vaudra l’aide inestimable d’officiers allemands.L’intérêt du roman est évidemment dans les détails de cette trame générale, dans la couleur des scènes, la portée des images, la netteté de l’écriture, l’harmonie de la composition. Hervé Bel est trop attentif au contexte historique pour qu’il ne serve que de toile de fond ; néanmoins, le véritable sujet de ce roman plein d’une maîtrise incisive, c’est la détresse d’une femme, fût-elle collective, comme c’était aussi le sujet de ses deux romans précédents. Hervé Bel est moins le romancier de l’événement que celui de la psychologie, toujours juste et fine. D’où cette structure narrative, qui est aussi celle de ses autres romans : alternance à la fois des points de vue (ici entre ceux d’Erika et de son mari) et des récits au présent et au passé. Car les personnages, chez lui, ne vivent au présent que pour essayer de justifier leur vie ou tenter d’y échapper. Le temps, comme dimension narrative, est l’allié le plus sûr de ce romancier.Erika Sattler est un autre de ces cas innombrables qu’Hannah Arendt appelait « la banalité du mal ». Le danger était que le personnage soit écrasé par l’énormité des événements. Or, c’est tout le contraire, Hervé Bel ayant su trouver un juste équilibre entre la médiocrité du personnage et la grandeur des événements. C’est du très bel art.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...