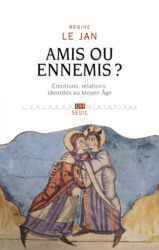Cousine K est si belle qu’en sa présence l’on n’existe plus, et quand elle s’en va, le monde est vidé. Mais cousine K est méchante. Vouloir être son ombre, c’est sacrifier la beauté, la vie, la vérité. Plongé dans le noir, son cousin en vient à ne plus savoir distinguer le mal du bien. On peut faire le bien mal, comme lui, ou le mal si bien que l’on est sanctifié, comme elle. Le garçon de quatorze ans visite ce qu’il est convenu d’appeler le côté obscur du cœur. Une violence irrépressible s’empare un jour de lui. Des années plus tard, terré, l’enfant devenu homme sent le besoin de se justifier. Et Cousine K est son acte de confession.
Qui n’est pas tenté de se servir des événements malheureux de son enfance pour s’absoudre de ses torts ? Une société intégriste et misogyne n’est certainement pas étrangère au drame intérieur d’un adolescent refermé sur lui-même. Dans le petit village de Douar Yatim, il ne manque pas de morts pour que soit célébré l’enterrement rituel du vendredi. Mais l’individu coupable l’est-il moins pour autant ? L’opération de charme du narrateur brouille la réflexion sur la nature du mal, intimement liée à la notion de vérité et l’écriture, comme il le dit lui-même, relève d’un « pathétique dédoublement de la personnalité ». Un questionnement souterrain refait surface, par endroits : l’écriture, parole ininterrompue, toute de subjectivité, sourde à l’autre, contribuerait-elle à nourrir la violence à l’égard des autres ? Les phrases ampoulées de la narration (agaçantes parfois ) sont peut-être, de ce point de vue, un effet voulu de la part de l’auteur. Dire que la boule de feu s’est éteinte derrière la limite du monde pour dire que le soir tombe n’est pas un mensonge, mais évoque une appropriation et du soir et de l’autre caché derrière ce soir : l’autre refait. En ce sens, l’écriture n’est qu’une fuite devant ce qui lui est étranger.