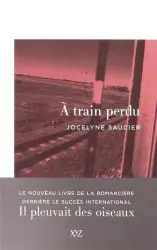Avec Il pleuvait des oiseaux (2011), l’auteure a passé un bon coup de chasse-neige dans les récompenses littéraires nationales et internationales. Prix littéraire des collégiens (2012), Prix littéraire des Collégiens de la décennie (2013), prix Ringuet (2012), prix France-Québec (2012) et Prix des 5 continents de la Francophonie (2012), entre autres, ont consacré la qualité remarquable du roman traduit en une quinzaine de langues.
L’adaptation cinématographique de Louise Archambault, où l’on a pu admirer une dernière fois le jeu d’Andrée Lachapelle, a également profité d’un accueil chaleureux.
Neuf années se sont écoulées entre la publication de ce méga succès et celle d’À train perdu, son cinquième roman en près de vingt-cinq ans de carrière. L’écrivaine couve patiemment ses livres, les dorlote, les ouvrage avec délicatesse. C’est un gage de qualité. La voici de retour, toute en sensibilité, avec une autre histoire débordante d’humanité, de mystères et de silences, de célestes amitiés et de terrestres préoccupations. Une histoire de disparation préméditée, de fuite éperdue, d’amour maternel qui survit à tout, à la distance, au temps, à la mort.
Rédigée sous forme d’enquête, cette cinquième publication suit les tribulations de Gladys Comeau, disparue dans le Northlander par un beau matin de septembre 2012. Celle-ci s’est lancée dans une errance à train perdu, sur les voies ferroviaires faisant le pont entre le nord de l’Ontario et du Québec. Puis, plus rien. Dans un petit hameau comme Swastika ‒ Swas pour les intimes ‒, soudé par l’amitié communautaire, l’absence fait grand bruit, le vide prend beaucoup de place. Surtout que Gladys, née du bon côté de la vie, est appréciée de tous.
Pourquoi erre-t-elle dans les tortillards poussifs du Nord ? Que recherche-t-elle ? À quoi ou à qui tente-t-elle d’échapper ? Gladys désire-t-elle prendre congé de Lisana, sa fille plombée par des idées noires ? Un élan de nostalgie amoureuse la pousse-t-il à revivre le souvenir de sa rencontre avec Albert Comeau ? Est-ce son enfance, égrenée dans les improbables school trains, qui la rappelle à elle ? Défilant à la barre de l’enquêteur, ses proches ont tous leur hypothèse sur les raisons de la fuite.
En attendant, Gladys erre à destination du vide, bercée par le roulis apaisant des wagons, leur « touk-e-touk » sonore et répétitif. Elle révèle sur son passage les secrets d’univers méconnus. Celui, par exemple, des train buffs, ces vagabonds du rail en quête des dernières images qui subsistent d’un mode de transport en voie d’extinction. Celui, révolu, des écoles sur rails qui garantissaient jadis aux « enfants de la forêt » un apprentissage ad hoc.
La vieillesse et la mort sont ici encore imprimées au cœur de l’œuvre, de même que la vie, si l’on accepte de voir celle-ci comme l’histoire en marche d’une disparition, comme un trajet en train, à destination de nulle part, dont on ne revient jamais. Et il n’y a pas que les personnes qui disparaissent dans À train perdu. Les modes de vie et les villages aussi. Le sort de Chapleau ou de Metagama, par exemple, est suspendu à celui du réseau ferroviaire, ligne de vie d’un écosystème humain relégué aux marges du territoire habité. C’est dire leur entière fragilité. À Clova, d’ailleurs, le cimetière compte plus de croix qu’il ne reste d’habitants dans le village.
Les paysages dépeuplés et bellement inhospitaliers de Saucier, ses personnages de femmes fortes, généreuses, et l’esprit de sororité qui les anime, offrent quelque chose comme une continuité logique de certains récits de Gabrielle Roy. Avec ses descendants d’origine bigarrée ‒ finlandaise, yougoslave, ukrainienne ‒, Swastika passe à la fois pour un carrefour du monde et un décalque de Portage-des-Prés. Les autrices campent en effet aux deux extrémités d’un même spectre qui est celui de la colonisation du territoire. Alors que Roy se présente dès l’aube, à l’ère de tous les possibles ouverts par le chemin de fer, Saucier établit le bilan, regrette l’obsolescence du transport ferroviaire et constate les difficultés qu’il y a à se cramponner à un territoire aussi revêche. À la vivacité de Luzina Tousignant répond la morosité de Lisana Comeau.
Pourtant, si le roman est à bien des égards teinté de crépuscule, tout n’y est pas gris, au contraire. Contre l’isolement et la solitude prévalent l’amitié et l’entraide communautaire ; contre la disparition, les rencontres et le partage perpétuent la mémoire d’une personne à travers le temps. Et Saucier réussit un tour de force en puisant dans les sujets les plus graves ‒ dont le suicide et la mort ‒ la part de lumineuse beauté qu’ils renferment ou peuvent faire naître. Elle dispose en plus de la retenue et de la justesse de ton nécessaires pour les sublimer en incontestable réussite. Pleuvra-t-il des prix sur Saucier, cette fois ? Préparez le chasse-neige, au cas où.