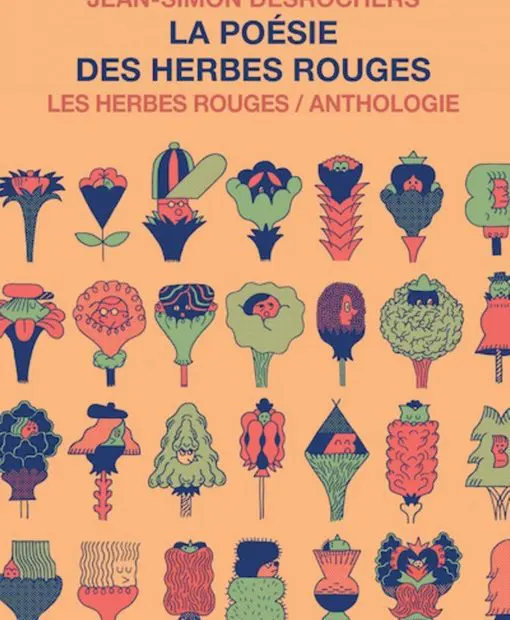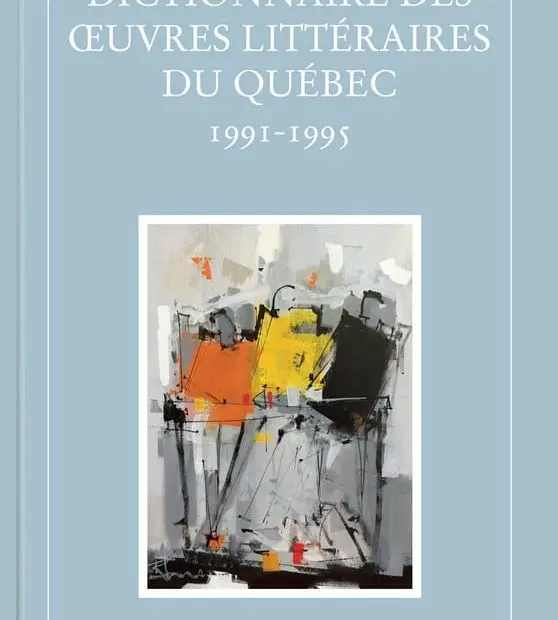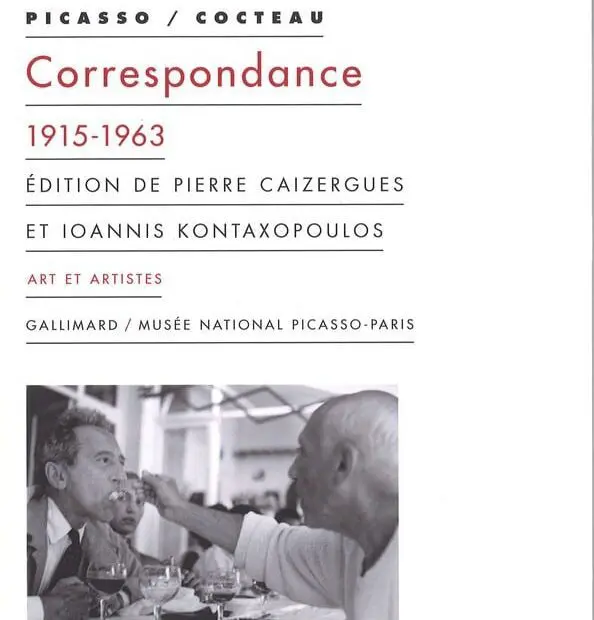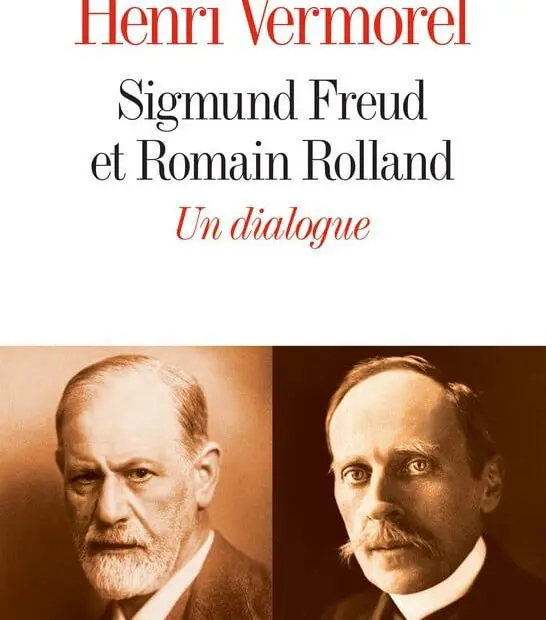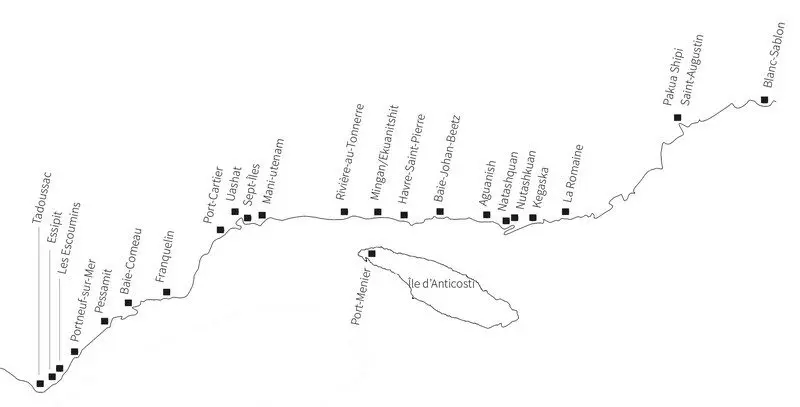Les Herbes rouges
La figure éditoriale est une chose aussi familière qu’étrange. Fédérateur par nature, l’éditeur est aussi destiné à se poster en marge ou à l’arrière-plan des auteurs et des œuvres, bien que sa présence soit difficile… Les Herbes rouges