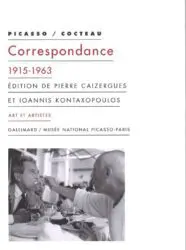Entre 1915 et la mort de Cocteau en 1963 s’échangèrent 450 billets et télégrammes1– le téléphone étant à l’époque encore peu utilisé – et guère de lettres de quelque longueur. La majorité de ces pièces, à vrai dire presque toutes, sont signées de Cocteau, sans surprise quand on connaît son désir d’entretenir une relation et l’aisance de sa plume ou de son crayon pour orner ses missives d’amusants croquis. Sans cesse il se plaint des silences de Picasso et le relance avec insistance. Picasso répond par de brefs messages dans un français approximatif.
Ils se sont connus par Edgar Varèse, « rencontre inscrite dans les astres ». Tout préoccupés de leur nombril, de leurs travaux et de leurs fréquentations, ces jeunes gens sont bien légers… Aucune mention de la guerre – si ce n’est une ligne de Cocteau qui déplore la mort d’un ami. En fait, l’événement ne les concerne pas, ni les tranchées où meurent par centaines de milliers leurs contemporains, ni l’issue de la guerre. La grande affaire est alors pour Cocteau les préparatifs fébriles pour monter le ballet Parade,auquel collabore Picasso pour les décors, Bakst pour les costumes, Satie pour la musique et les Ballets russes de Diaghilev, au milieu de manœuvres, conflits, brouilles et scandales dont le moindre n’est évidemment pas la représentation elle-même en mai 1917. Dans cette effervescence culturelle on croise Apollinaire et Cendrars, Max Jacob, Modigliani, Kisling et Stravinsky.
Document sur l’époque sans doute, mais elle est vue par le petit bout de la lorgnette braquée exclusivement sur les publications et spectacles et les mondanités qui les entourent. Un éclairage latéral est projeté sur le travail du poète et sur celui du peintre, les circonstances de leurs créations, leurs projets, les rapports amicaux mais compliqués avec l’entourage et les trahisons. En fait, comme la plupart des correspondances entre écrivains et artistes, celle-ci ne livre que l’écume de leur création respective et porte rarement sur des questions de fond.
Picasso, fantasque et infatigable, peint des toiles que mentionne Cocteau, son admirateur éperdu dont il aimerait s’inspirer ou se nourrir dans ses propres œuvres, poétiques autant que picturales. Il lui donne du « cher seigneur », « cher magnifique », « mon cher merveilleux » qui annoncent des déclarations d’amour alambiquées dont il est friand à travers cette correspondance décousue et folle. « Un demi-siècle d’amitié et d’affection » ? Oui, mais à voir de plus près car cette relation fut ponctuée de temps forts et d’intervalles qui laissent des doutes sur la profondeur des sentiments déclarés. Cocteau s’interroge beaucoup sur ceux de Picasso, qui a de brusques accès de tendresse, mais le poète soupçonne à diverses reprises sur son propre compte des jugements défavorables et des propos désobligeants. Cocteau, qui a tenté de s’inspirer de l’œuvre de Picasso, toujours en mutation en particulier dans une commune période « classique », se considère comme l’élève et un des seuls à comprendre son œuvre. Il écrira et réunira sur lui des textes remarquables reproduits en partie dans l’ouvrage.
Des événements surviennent qui, cette fois-ci, ne peuvent laisser les deux correspondants indifférents. En 1937 au moment de la guerre civile espagnole, Picasso s’engage dans le Parti communiste et peint son célèbre Guernica. En 1944 ils entreprennent des démarches pour faire libérer Max Jacob du camp de Drancy, mais trop tard. Jacob meurt.
En réalité, « Picasso m’intimide », déclare Cocteau vers la fin de sa vie, avec le sentiment d’avoir perdu son ami. On ne peut s’empêcher de penser à l’écart, voire l’abîme séparant les deux hommes pour ce qui est de leur personnalité et de leurs réalisations : à côté de la vitalité prodigieuse de Picasso, Cocteau semble bien chétif, souvent malade et fragile, sensible aux attaques des surréalistes dans leur revue Littérature,littéralement dévasté par la mort de Radiguet, qu’il essaiera d’oublier dans l’opium, travaillé par « une angoisse de ratage ».Disproportion évidente, entre leur force créatrice respective, leur audace, leur capacité de se renouveler.
Il est manifeste que cette correspondance, enrichie par des lettres échangées avec Jacqueline Roque et Françoise Gilot (compagnes successives de Picasso) qui se confiaient souvent à Cocteau, l’ami discret et fidèle, ne dit pas tout. Ce sont, semble-t-il, les journaux substantiels tenus par Cocteau qui vont au cœur de la relation. Il éprouve parfois un malaise devant les déguisements de l’artiste et ses outrances. Ses réserves sur la prétendue révolution en peinture opérée par Picasso sont plus étonnantes parmi le flot de louanges et de reconnaissance dont il l’a submergé. (« Ton génie ne me quitte jamais. C’est même mon bon génie. ») Ailleurs : « Je connais ses jeux de cape par cœur. L’ami imprudent ne s’en tire jamais sans un coup d’épée ». Mais malaise réciproque : « Il se sent vu, dit Cocteau, et je me sens vu jusqu’à l’os » (1962). Le « charmeur d’objets », le « grand perturbateur du trafic », le génie, le monstre sacré se révèle ici dans ses noirceurs. Un égocentrisme qui culminera dans sa vieillesse et une puissance de destruction dont Cocteau fait les frais et, plus encore comme on sait par effet de sa misogynie, les compagnes du peintre (Jacqueline se suicidera). Quand Cocteau oublie les contorsions poétiques de son écriture, il signe des pages étonnamment lucides et inspirées sur Picasso, car « il captait mieux les rayons que les autres ». En l’occurrence il capte son art d’utiliser les autres, qui s’accentue avec les années et l’enveloppe d’une grande solitude contre laquelle se cogne celle de Cocteau. Picasso n’assistera pas aux funérailles de ce dernier – il se fera représenter par son fils – et il lui survivra dix ans.
En même temps qu’elle jette une lumière crue sur Picasso, cette correspondance, et c’est là un de ses mérites, fait ressortir chez Cocteau l’homme hypersensible, délicat, courtois, fidèle, parfois profond. Indéniablement il mérite beaucoup mieux que sa réputation de funambule doué mais superficiel, mondain et touche-à-tout.
Cet ouvrage soulève bien d’autres questions. Le travail critique réalisé par deux spécialistes est admirable de précision. Des milliers de notes éclairent tous les recoins, les allusions, références aux personnes, codes et clins d’œil ainsi que la description, la datation et la répartition des pièces. Rien n’est laissé dans l’à-peu-près, avec des commentaires qui synthétisent les échanges de chaque année et, par bonheur !, font une large place en annexe aux Journaux de Cocteau et à divers témoignages. Néanmoins, on ne peut manquer de se demander : ce travail de fourmi, pourquoi et pour qui ? En vaut-il vraiment la peine ? Si indéniablement il justifie et confirme des faits, apporte-t-il du nouveau à notre connaissance des deux correspondants ? Plus généralement la question vaut pour les innombrables correspondances d’écrivains et d’artistes, la manne des chercheurs patients et appliqués. Elle ne peut être éludée. À côté de l’extrême richesse de contenu et de la qualité littéraire des échanges entre Stefan Zweig et Romain Rolland, ou celle, proche de nous, entre Pierre Vadebonœur et Paul-Émile Roy, l’ensemble Zola-Cézanne contient nombre de lettres adolescentes sans originalité ni qualités particulières. Combien d’autres s’embourbent dans le ressassement ennuyeux, l’anecdotique et la banalité. La question se double d’une autre : faut-il tout publier de ces miettes, brindilles, broutilles et bavardages ou faire un tri, choisir seulement le plus révélateur, le plus nouveau, l’inattendu, l’insolite chez des créateurs qu’on croyait bien connaître ? Pour ma part, ayant dû accomplir semblables opérations relevant de l’édition critique, je demeure avec mes doutes et ma perplexité.
1. Pablo Picasso et Jean Cocteau, Correspondance 1915-1963, Édition de Pierre Caizergues et Ioannis Kontaxopoulos, Gallimard/Musée national Picasso-Paris, Paris, 2018, 563 p. ; 66,95 $.