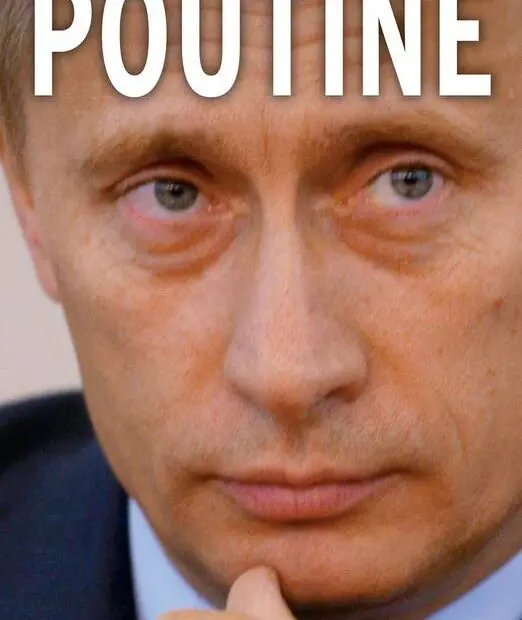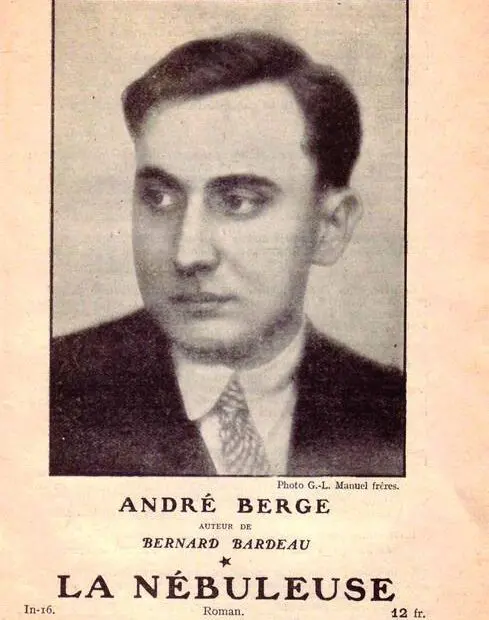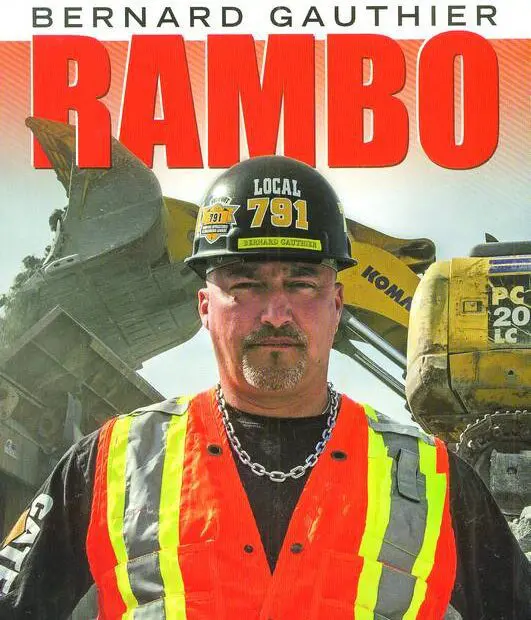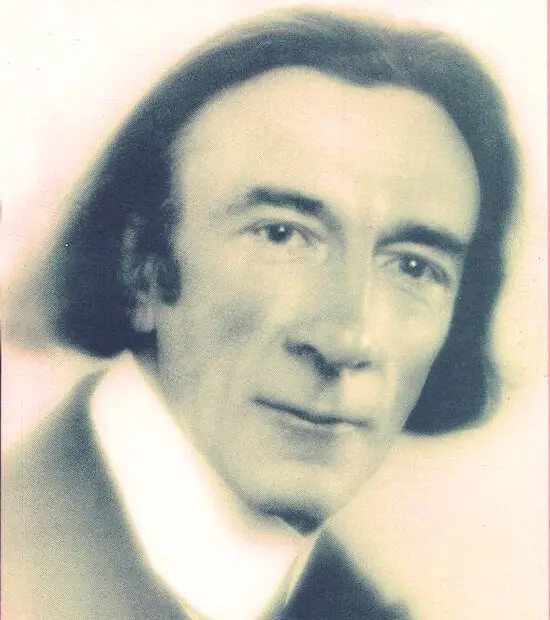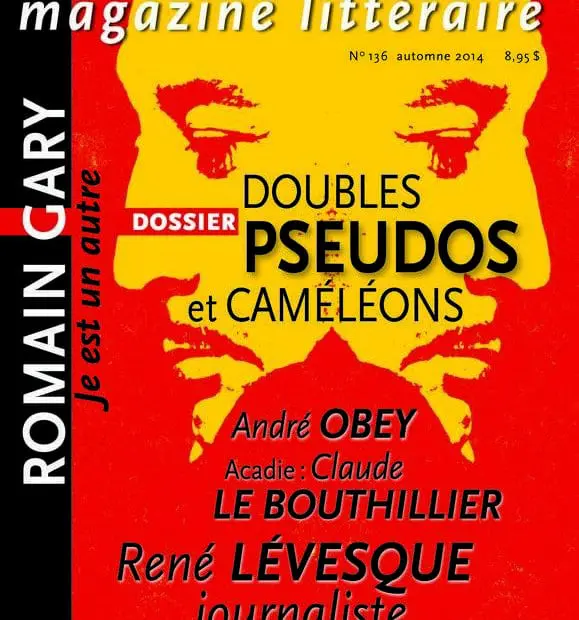Sans doute faut-il attendre d’être en pleine possession de ses moyens d’écrivain avant d’entreprendre d’écrire sur ses père et mère. Avoir amorcé le renversement des rôles, être à son tour devenu parent, permet sans doute de poser un regard à la fois juste et renouvelé sur l’image, réelle ou sur celle que l’on s’est forgée au fil des ans, de ses parents.
Oser même porter ce regard qui interroge notre empreinte et la révèle sans fard nécessite du recul. Et du temps qui, avec la distance, peut nous dévoiler la véritable nature de ces personnes jusque-là réduites, circonscrites, enfermées dans leur rôle de parent, comme nous l’étions dans notre rôle filial. Et soudain, la figure parentale qui hier, aux yeux de l’enfant,