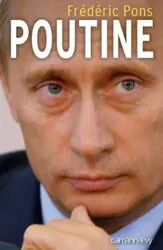Frédéric Pons jette un regard sans a priori sur un pays en pleine mutation et sur l’ascension d’un homme qui – qu’on le veuille ou non – est en train d’écrire l’histoire de notre temps.
Quand, en 1999, Vladimir Poutine est nommé président intérimaire de la Russie, il hérite d’un État en pleine déliquescence. Après l’effondrement du communisme, le pays a en effet connu une décennie calamiteuse sous Eltsine. Le produit intérieur brut (PIB) a fondu de 50 % et la productivité industrielle du pays n’atteint plus que 20 à 25 % de celle des États-Unis. À l’effondrement économique s’ajoutent les troubles provoqués par les séparatistes tchétchènes. Moscou, le cœur même du pays, est la cible d’attentats sanglants. Sur le front politique, le nouveau maître du Kremlin doit faire face à une puissante classe d’oligarques en mesure de dicter ses volontés à un pouvoir jusque-là miné par l’incompétence, la corruption et l’alcoolisme.
Comment ce fonctionnaire timide, discret et un peu falot, qui avait mené une carrière sans éclat d’abord comme agent du KGB à Dresde, puis comme adjoint au maire de Saint-Pétersbourg avant d’être appelé à Moscou, se retrouve-t-il à la tête du plus grand pays du monde ? S’il n’explique pas toutes les raisons de cette ascension, Frédéric Pons en analyse les grandes étapes dans la biographie politique qu’il consacre à Vladimir Poutine1.
L’auteur, militaire, journaliste et professeur à Saint-Cyr, passe rapidement sur l’enfance et l’adolescence de Poutine vécues dans un milieu de modestes ouvriers à Saint-Pétersbourg. Signalons, pour la petite histoire, que son grand-père fut le cuisinier de Lénine jusqu’à la mort de celui-ci, puis celui de Staline. À part ce détail signalé au passage, ce qui intéresse Frédéric Pons, c’est de démêler l’écheveau des événements qui ont fait de ce fonctionnaire effacé l’homme d’État qu’il est devenu.
Ce fut d’abord sa riposte à la crise tchétchène qui lui valut ses premiers succès auprès de la population russe. Cette petite république du Caucase, islamiste et profondément antirusse, menait depuis dix ans ce qui nous paraissait être, vue de l’Occident, un combat d’indépendance, alors qu’il était aussi une guerre religieuse pour établir un État islamique dans le Caucase. Les séparatistes tchétchènes comptaient dans leurs rangs 40 000 djihadistes venus de Syrie, d’Arabie saoudite, de Jordanie, du Yémen, du Pakistan et d’Azerbaïdjan. À la lumière des événements récents, on comprend mieux maintenant pourquoi Poutine affirmait que cette guerre était d’abord un affrontement contre le terrorisme international.
Après avoir maté la révolte dans le Caucase et consolidé son pouvoir, Poutine entreprend de mettre au pas les oligarques qui avaient pris la mauvaise habitude de mettre leur nez dans les affaires de l’État. Boris Berezovsky, l’homme le plus riche et le plus influent de Russie, est contraint à l’exil. Il mourra à Londres en 2013 dans des circonstances mystérieuses. Mikhaïl Khodorkovski, président-directeur général de Ioukos, la plus puissante compagnie pétrolière du pays, est condamné à la prison officiellement pour fraude, mais surtout pour avoir voulu mêler ses intérêts à ceux du puissant groupe financier américain Carlyle.
Les premiers échecs militaires au Caucase, suivis du naufrage du sous-marin nucléaire Koursk dans la mer de Barents en 2000, ont mis au jour les faiblesses de l’armée et convaincu Poutine d’entreprendre simultanément une réforme militaire et un rapprochement avec l’OTAN. Fort de la promesse des pays membres de ne pas chercher à s’étendre aux pays autrefois sous domination russe, il donne son accord à la création du conseil OTAN-Russie. Mais la promesse rompue de non-extension de l’OTAN et la crise provoquée en 2008 par le désir manifeste de la Géorgie de rejoindre l’Alliance, ruinent à jamais les possibilités de rapprochement avec l’OTAN. Pour faire contrepoids à l’axe occidental, Poutine élabore un projet d’union eurasienne qui regroupe aujourd’hui cinq États. Enfin, la crise ukrainienne qui, du point de vue de la Russie, a été provoquée par des interventions étrangères (ce qui n’est pas totalement faux, selon Pons), vient consacrer le divorce de Poutine avec l’Occident.
Ces événements ont forgé un homme qui a repris à son compte le vieux credo de la Russie tsariste, à savoir qu’un pays qui compte 145 millions d’habitants et 160 ethnies répartis sur 11 fuseaux horaires ne peut être gouverné que par un pouvoir central fort. C’est ce que Poutine appelle « la verticale du pouvoir », qui n’est que l’avatar de l’autoritarisme des tsars. C’est également en puisant aux sources de la tradition russe et orthodoxe que l’expansion du clergé est non seulement tolérée mais encouragée, que les lois sur la famille sont resserrées pour rendre plus difficiles l’avortement et le divorce et que l’homosexualité est rendue quasi illégale. En tournant le dos à la culture consumériste et matérialiste de l’Occident et en multipliant ses alliances avec ses voisins orientaux, Vladimir Poutine veut recréer la multipolarité perdue avec l’effondrement du communisme. Surtout, il veut restaurer la puissance et le rayonnement de la Russie.
Touffu sans être confus, bien documenté sans être lourd et débarrassé du « filtre médiatique » qui fait souvent de Poutine le croque-mitaine de service, l’essai de Frédéric Pons raconte la trajectoire d’un homme que les circonstances ont amené à prendre en main la destinée de son pays. Même s’il souligne à gros traits la duplicité de l’Occident dans ses rapports avec la Russie, Pons ne fait pas pour autant de la Russie une victime. Son Poutine est un battant infatigable, déterminé dans ses objectifs, brutal dans ses méthodes. À un carrefour de son histoire, la Russie de demain sera en grande partie celle que Vladimir Poutine aura façonnée.
EN COMPLÉMENT : LES OLIGARQUES, LE SYSTÈME POUTINE
1. Frédéric Pons, Poutine, Calmann-Lévy, Paris, 2014, 363 p. ; 29,95 $.
EXTRAITS
Poutine s’était d’abord imaginé marin. Il avait ensuite rêvé d’aviation […]. Les livres et les films d’espionnage ont tout changé. Des années plus tard, il se veut lucide sur sa vocation : « Je voulais travailler dans les renseignements. C’était un rêve, mais aussi réalisable que d’aller sur Mars » […]. Ce qui lui plaît, dans ce métier, un peu fantasmé à travers les films, c’est la capacité d’un agent solitaire à changer le cours de l’histoire.
p. 55
Au tournant des années 1990-2000, il est le seul à prendre le dossier tchétchène à bras-le-corps […]. Les Russes lui reconnaissent dès cette époque cette double qualité de courage et de franchise […]. Ils se reconnaissent aussi sans difficultés dans sa fameuse formule : « Nous irons buter les terroristes jusque dans les chiottes ». Prononcée par ce dirigeant jeune et vigoureux, elle rassure les Russes habitués au visage bouffi de Eltsine, fatigués de la criminalisation de la société, humiliés par les renoncements de puissance et les humiliations répétées.
p. 115
On sait aujourd’hui que [Poutine] quitte le Kremlin chaque année pour aller passer quelques jours de retraite au milieu des moines, dans le cadre du monastère de la Transfiguration du Sauveur de Valaam […]. C’est là qu’il nourrit son argumentaire et son admiration pour le destin singulier de la Russie chrétienne, rescapée du matérialisme athée des Soviétiques, confrontée aujourd’hui au matérialisme libéral des Occidentaux.
p. 243