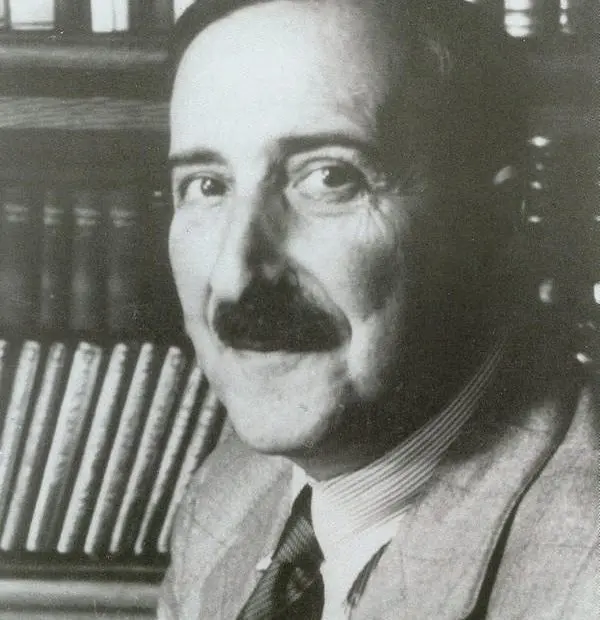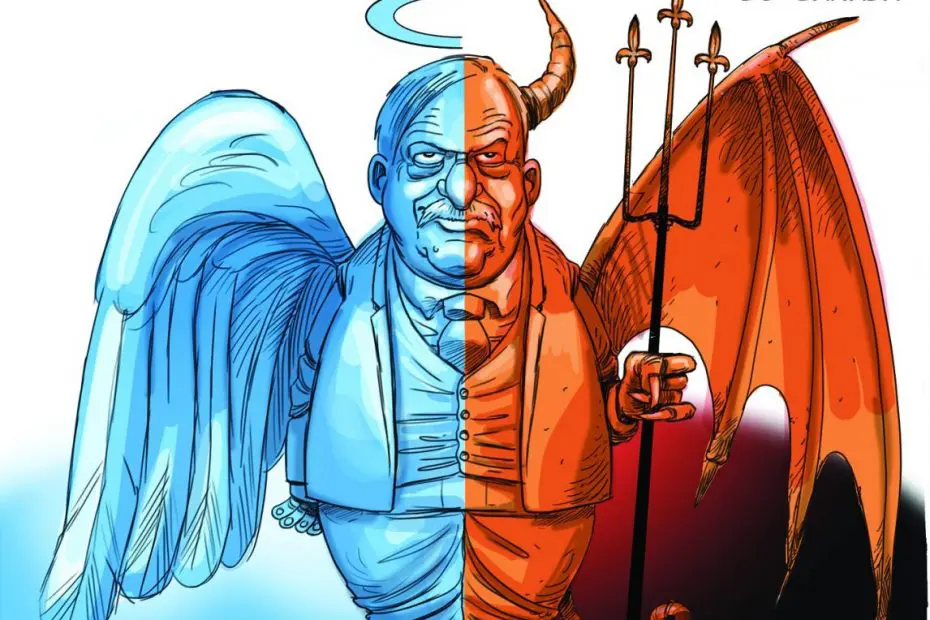Lettres de Gaston Miron : Une voix frustrée de son cri
En publiant les lettres écrites par Gaston Miron entre 1949 et 19651, Mariloue Sainte-Marie propose au public lecteur un profil bouleversant du Magnifique-encore-jeune et un retour déroutant à un Québec révolu. La voix dont la… Lettres de Gaston Miron : Une voix frustrée de son cri