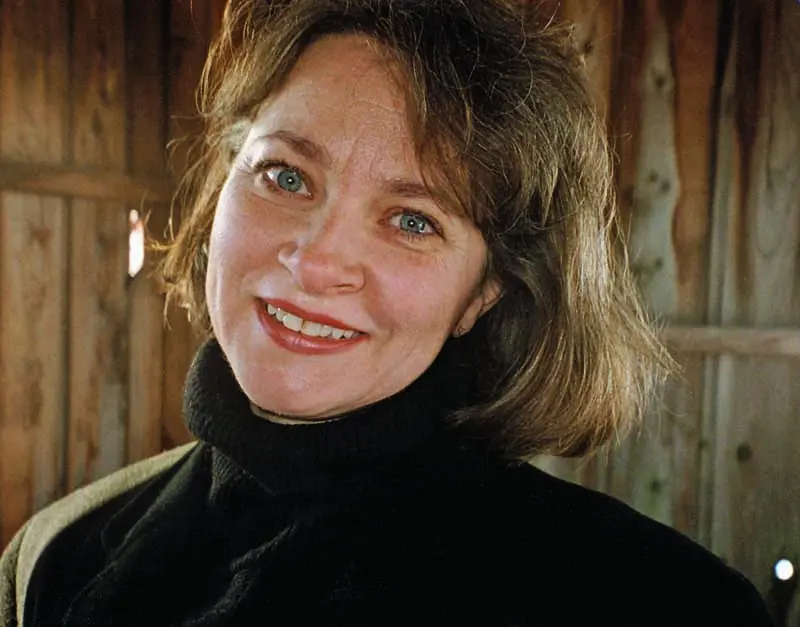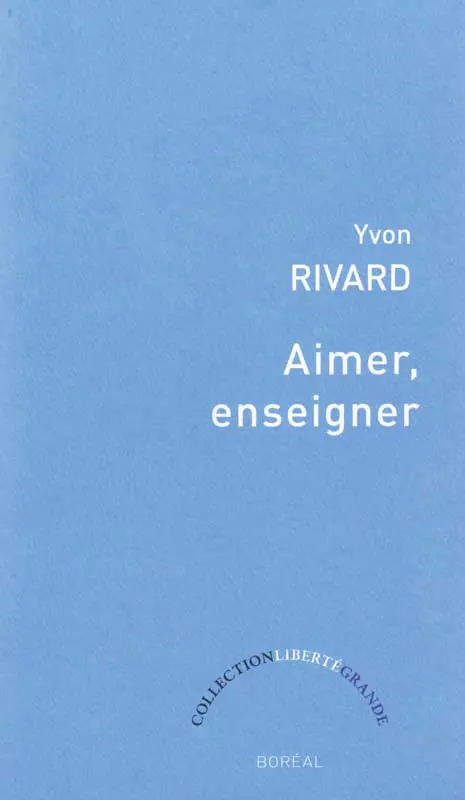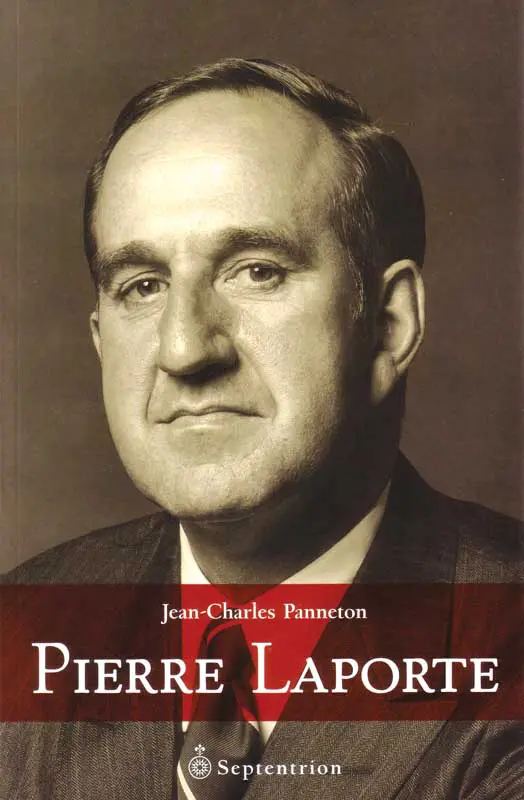Colette Peignot, dite Laure (1903-1938)
Écrivaine française née à Meudon (Hauts-de-Seine) en 1903 et décédée de la tuberculose à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) en 1938, Colette Peignot a laissé une série d’écrits à la prose torturée et exaltée, dont Histoire d’une petite fille,… Colette Peignot, dite Laure (1903-1938)