« On a le plus grand tort de le ranger parmi les auteurs gais : son rire est amer », écrit Henri 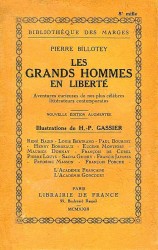 Martineau en 1922 à propos de celui qu’il qualifie de « romancier observateur très proche parent d’un Courteline1 ». Romancier gai, romancier moraliste, Pierre Billotey (1886-1932) a travaillé d’une plume légère et sensible l’art sérieux du roman.
Martineau en 1922 à propos de celui qu’il qualifie de « romancier observateur très proche parent d’un Courteline1 ». Romancier gai, romancier moraliste, Pierre Billotey (1886-1932) a travaillé d’une plume légère et sensible l’art sérieux du roman.
Les quatres syllabes d’un bonheur impossible
L’œuvre de Pierre François Billotey est réapparue à la toute fin du XXe siècle, annoncée par quatre syllabes promettant le bonheur : Sao Kéo. Les éditions Kailash, spécialisées dans les livres sur l’Asie, ont réédité en 1997 Sao Kéo ou Le bonheur immobile, l’avant-dernier roman de Billotey, paru en 1930 chez Albin Michel. Billotey, romancier exotique ? Il semblerait, à première vue. Billotey, romancier colonial ? Son nom est en effet mentionné en 1996 dans l’ouvrage d’Alain Ruscio consacré à l’idéologie coloniale en France, Le credo de l’homme blanc2.  L’historien cite à juste titre l’exemple de Sao Kéo pour illustrer la pensée selon laquelle l’homme blanc des colonies est « doublement maître » vis-à-vis des femmes, en tant que colonial, et en tant qu’homme. L’histoire de Sao Kéo est en effet celle de Lucien Payel, un jeune notaire qui trouvera momentanément le bonheur auprès d’une Laotienne. Cependant, le personnage de Billotey n’incarne pas tant la puissance que les faiblesses de l’homme occidental. À mesure que le récit avance, le gai jeune homme se révèle dénué de volonté, manipulable, soumis au point de recevoir le mépris de la femme qui l’aime, qui veut l’épouser… mais aussi le dominer. On comprend que l’attrait qu’il éprouve pour l’aventure, et particulièrement pour le Laos, n’est avant tout qu’un prétexte de fuite devant son incapacité à être l’homme que l’on attend qu’il soit. Lui ne le réalise qu’une fois sur place ; il oublie le trésor pour lequel il était venu et s’unit à Sao Kéo, une jeune Laotienne qui l’aime, mais plus encore, l’admire. La femme de couleur est soumise dans Sao Kéo, et Pierre Billotey se fait le relais d’une idéologie raciste que d’autres à son époque ont réprouvée, mais le roman ne cache pas la faiblesse de l’homme blanc. Payel croit avoir trouvé le bonheur, Sao Kéo, bien plus sage, comprend qu’il n’aura pas la force de le conserver : « Je sais que tu partiras, comme les autres… », les autres coloniaux, dont la cupidité n’a pas su résister à l’appel de l’Occident. Appâté par les gains que peut lui faire réaliser son mariage, Payel abandonne en effet la jeune fille et retourne en France. Il la regrette vite pourtant, et part la retrouver. Il meurt en chemin dans un accident de train ; comme s’il n’y avait pas de seconde chance pour ceux qui n’ont pas su saisir le bonheur qui leur a été offert. C’est au cousin de Payel, porte-parole des bien-pensants, que revient l’honneur de conclure le roman : « Ainsi donc finit cet homme bizarre, plutôt sympathique, paraît-il, mais par trop fantaisiste. Il faudrait certes se garder de prendre pour exemple de pareils rêveurs. L’idéal de mon pauvre cousin, c’est un idéal de poète, de fainéant, et la négation du progrès ». Les rapports de forces qui opposent l’individu et la société, l’homme et la femme, le rêve et la nécessité inspirèrent plus que tout ce romancier qui commença sa carrière non par des romans exotiques, ni par des romans d’aventures, mais par des romans gais. Pierre Billotey, romancier moraliste, moraliste joyeux : voilà l’optique selon laquelle je me propose de faire découvrir ce romancier méconnu.
L’historien cite à juste titre l’exemple de Sao Kéo pour illustrer la pensée selon laquelle l’homme blanc des colonies est « doublement maître » vis-à-vis des femmes, en tant que colonial, et en tant qu’homme. L’histoire de Sao Kéo est en effet celle de Lucien Payel, un jeune notaire qui trouvera momentanément le bonheur auprès d’une Laotienne. Cependant, le personnage de Billotey n’incarne pas tant la puissance que les faiblesses de l’homme occidental. À mesure que le récit avance, le gai jeune homme se révèle dénué de volonté, manipulable, soumis au point de recevoir le mépris de la femme qui l’aime, qui veut l’épouser… mais aussi le dominer. On comprend que l’attrait qu’il éprouve pour l’aventure, et particulièrement pour le Laos, n’est avant tout qu’un prétexte de fuite devant son incapacité à être l’homme que l’on attend qu’il soit. Lui ne le réalise qu’une fois sur place ; il oublie le trésor pour lequel il était venu et s’unit à Sao Kéo, une jeune Laotienne qui l’aime, mais plus encore, l’admire. La femme de couleur est soumise dans Sao Kéo, et Pierre Billotey se fait le relais d’une idéologie raciste que d’autres à son époque ont réprouvée, mais le roman ne cache pas la faiblesse de l’homme blanc. Payel croit avoir trouvé le bonheur, Sao Kéo, bien plus sage, comprend qu’il n’aura pas la force de le conserver : « Je sais que tu partiras, comme les autres… », les autres coloniaux, dont la cupidité n’a pas su résister à l’appel de l’Occident. Appâté par les gains que peut lui faire réaliser son mariage, Payel abandonne en effet la jeune fille et retourne en France. Il la regrette vite pourtant, et part la retrouver. Il meurt en chemin dans un accident de train ; comme s’il n’y avait pas de seconde chance pour ceux qui n’ont pas su saisir le bonheur qui leur a été offert. C’est au cousin de Payel, porte-parole des bien-pensants, que revient l’honneur de conclure le roman : « Ainsi donc finit cet homme bizarre, plutôt sympathique, paraît-il, mais par trop fantaisiste. Il faudrait certes se garder de prendre pour exemple de pareils rêveurs. L’idéal de mon pauvre cousin, c’est un idéal de poète, de fainéant, et la négation du progrès ». Les rapports de forces qui opposent l’individu et la société, l’homme et la femme, le rêve et la nécessité inspirèrent plus que tout ce romancier qui commença sa carrière non par des romans exotiques, ni par des romans d’aventures, mais par des romans gais. Pierre Billotey, romancier moraliste, moraliste joyeux : voilà l’optique selon laquelle je me propose de faire découvrir ce romancier méconnu.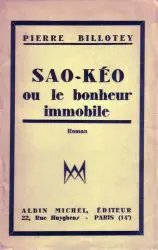
Peintre, journaliste, professeur, romancier
Un « écrivain obscur3 », c’est ainsi qu’Alain Ruscio présente Pierre Billotey en 1996. À ma connaissance, l’auteur ne figure en effet dans aucun ouvrage d’histoire littéraire. Comme nombre de méconnus et d’oubliés, il obtint pourtant une certaine reconnaissance de son vivant. Henri Martineau, fondateur du Divan, décrit en 1922 « […] un auteur heureux à qui une belle carrière dans la société semble promise4 ». Billotey obtient en 1923 le Prix du Merle Blanc, la revue d’Eugène Merle, qui récompense un roman gai. La revue La Pensée française, à laquelle il va collaborer, le présente en 1924 comme « […] un de nos plus brillants romanciers5 ». À plusieurs reprises on utilise les termes de « spirituel auteur » pour parler de lui. Ces éloges discrets sont nombreux, jusqu’au Figaro qui regrette, à l’annonce de sa mort, « [u]n délicieux conteur et un romancier de talent6 ». Journaliste, romancier, professeur, ancien combattant ; la consultation des revues et journaux de l’époque nous fournit quelques indices sur les multiples carrières d’un homme dont on semble avant tout avoir apprécié l’esprit mordant et le sens de l’ironie.
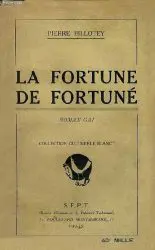 Il est difficile de retracer avec précision le parcours de Pierre Billotey. Né à Paris en 1886, il est le frère cadet du peintre Louis Billotey, Prix de Rome en 1907. Il semble qu’il se soit d’abord lui-même orienté vers la peinture. Sa carrière littéraire ne débute véritablement qu’après la Première Guerre mondiale – il est grièvement blessé durant le conflit et reçoit la Médaille militaire ainsi que la Croix de guerre, en plus d’être fait chevalier de la Légion d’honneur. Dès 1919, il signe une courte histoire de guerre, « Hissam Roi7 », dans la rubrique « Mille et un matins » du journal Le Matin. La même année, il participe à la fondation de l’Association des écrivains combattants, dont il sera élu secrétaire adjoint quelques mois avant sa mort. C’est d’abord par la presse que Billotey se fait connaître. Il publie des articles polémiques, des contes (il est membre, aux côtés de Pierre Benoit entre autres, du club des Conteurs du Vieux-Logis), des histoires drôles et morales, entre autres dans Le Matin, Le Crapouillot, La Pensée française, La Muse française, Le Gaulois et a été un moment le secrétaire de la revue Les Marges. Son premier ouvrage paraît en 1922. Les grands hommes en liberté, Aventures curieuses de nos plus célèbres contemporains est un ouvrage satirique, une série d’historiettes qui croque les grandes plumes de l’époque. Sacha Guitry est arrêté pour attentat à la pudeur, René Bazin est persuadé qu’Anatole France est l’Antéchrist, Henry Bordeaux tente d’assassiner Georges Clémenceau pour obtenir un sujet de roman, un savant invente une potion permettant de faire rajeunir l’Académie… et bien plus encore. Le livre obtient un certain succès et est rapidement réédité accompagné d’illustrations de H.-P. Gassier, le cofondateur du Canard enchaîné. Par la suite, Billotey publie coup sur coup deux romans gais, Le pharmacien spirite (1922) et La fortune de Fortuné (1923), pour lequel il obtient le Prix du Merle Blanc, ainsi qu’une parodie de roman d’aventures, Raz Boboul (1923). En 1923 également, paraît Un cœur ardent, qui annonce le ton des romans suivants de Billotey. Tout en conservant le goût de la satire, l’auteur délaisse les gauloiseries qui ont fait le piquant de ses premiers récits pour développer la psychologie des personnages. Et Billotey de varier sur les thèmes de l’amour et de l’argent. Un cœur ardent est le cas pathologique d’une femme qui ne peut pas s’empêcher d’aimer, peu importe qui, et de donner chaque fois tout ce qu’elle possède. Le narrateur de La fausse amoureuse (1925) est au contraire pris au piège d’une femme qui ne peut que feindre l’amour, et n’aime que l’argent. Le trèfle à quatre feuilles (1926) et Le miroir aux alouettes (1927) racontent les amours de jeunes héritières dont l’entourage convoite les richesses. Rien que la chair (1928) est l’histoire d’un jeune homme dont on vole l’âme et qui se met à haïr l’amour pour adorer l’argent. En 1928, Pierre Billotey est désigné comme titulaire de la bourse de voyage accordée par le gouvernement général de l’Indochine à l’Association des écrivains combattants. De son voyage il rapporte L’Indochine en zigzag (19929), et certainement l’inspiration pour Sao Kéo ou Le bonheur immobile (1930). Six mois avant de succomber à une crise d’urémie, il livre à son éditeur les épreuves de La tour des abeilles (1932), les confessions d’une jeune femme qui se croit responsable de la mort de son escroc de mari. À son décès, en plus de ses activités d’écrivain et de journaliste, Pierre Billotey enseignait à l’école Arago. Professeur, le romancier semble l’avoir été toujours un peu, ayant fait sienne dès ses premiers écrits la classique doctrine du placere et docere. « Romancier moraliste » nous disions…
Il est difficile de retracer avec précision le parcours de Pierre Billotey. Né à Paris en 1886, il est le frère cadet du peintre Louis Billotey, Prix de Rome en 1907. Il semble qu’il se soit d’abord lui-même orienté vers la peinture. Sa carrière littéraire ne débute véritablement qu’après la Première Guerre mondiale – il est grièvement blessé durant le conflit et reçoit la Médaille militaire ainsi que la Croix de guerre, en plus d’être fait chevalier de la Légion d’honneur. Dès 1919, il signe une courte histoire de guerre, « Hissam Roi7 », dans la rubrique « Mille et un matins » du journal Le Matin. La même année, il participe à la fondation de l’Association des écrivains combattants, dont il sera élu secrétaire adjoint quelques mois avant sa mort. C’est d’abord par la presse que Billotey se fait connaître. Il publie des articles polémiques, des contes (il est membre, aux côtés de Pierre Benoit entre autres, du club des Conteurs du Vieux-Logis), des histoires drôles et morales, entre autres dans Le Matin, Le Crapouillot, La Pensée française, La Muse française, Le Gaulois et a été un moment le secrétaire de la revue Les Marges. Son premier ouvrage paraît en 1922. Les grands hommes en liberté, Aventures curieuses de nos plus célèbres contemporains est un ouvrage satirique, une série d’historiettes qui croque les grandes plumes de l’époque. Sacha Guitry est arrêté pour attentat à la pudeur, René Bazin est persuadé qu’Anatole France est l’Antéchrist, Henry Bordeaux tente d’assassiner Georges Clémenceau pour obtenir un sujet de roman, un savant invente une potion permettant de faire rajeunir l’Académie… et bien plus encore. Le livre obtient un certain succès et est rapidement réédité accompagné d’illustrations de H.-P. Gassier, le cofondateur du Canard enchaîné. Par la suite, Billotey publie coup sur coup deux romans gais, Le pharmacien spirite (1922) et La fortune de Fortuné (1923), pour lequel il obtient le Prix du Merle Blanc, ainsi qu’une parodie de roman d’aventures, Raz Boboul (1923). En 1923 également, paraît Un cœur ardent, qui annonce le ton des romans suivants de Billotey. Tout en conservant le goût de la satire, l’auteur délaisse les gauloiseries qui ont fait le piquant de ses premiers récits pour développer la psychologie des personnages. Et Billotey de varier sur les thèmes de l’amour et de l’argent. Un cœur ardent est le cas pathologique d’une femme qui ne peut pas s’empêcher d’aimer, peu importe qui, et de donner chaque fois tout ce qu’elle possède. Le narrateur de La fausse amoureuse (1925) est au contraire pris au piège d’une femme qui ne peut que feindre l’amour, et n’aime que l’argent. Le trèfle à quatre feuilles (1926) et Le miroir aux alouettes (1927) racontent les amours de jeunes héritières dont l’entourage convoite les richesses. Rien que la chair (1928) est l’histoire d’un jeune homme dont on vole l’âme et qui se met à haïr l’amour pour adorer l’argent. En 1928, Pierre Billotey est désigné comme titulaire de la bourse de voyage accordée par le gouvernement général de l’Indochine à l’Association des écrivains combattants. De son voyage il rapporte L’Indochine en zigzag (19929), et certainement l’inspiration pour Sao Kéo ou Le bonheur immobile (1930). Six mois avant de succomber à une crise d’urémie, il livre à son éditeur les épreuves de La tour des abeilles (1932), les confessions d’une jeune femme qui se croit responsable de la mort de son escroc de mari. À son décès, en plus de ses activités d’écrivain et de journaliste, Pierre Billotey enseignait à l’école Arago. Professeur, le romancier semble l’avoir été toujours un peu, ayant fait sienne dès ses premiers écrits la classique doctrine du placere et docere. « Romancier moraliste » nous disions…
Les choses graves, légèrement
Le 10 janvier 1924, La Pensée française publie une « Apologie du roman » signée Pierre Billotey. Dans ce court texte, l’auteur défend la capacité du roman à porter, avec un style que la théorie n’a pas, les idées que longtemps on lui a refusées : « Et maints traités philosophiques, et maints ouvrages tout gourmés de science, ne sont que de futiles élucubrations auprès de La comédie humaine et des Scènes de la vie de province. Voulez-vous me citer un psychologue patenté, un essayiste académicien, qui soit allé plus loin aux profondeurs des âmes et des cœurs, qui ait mieux compris et expliqué les passions ? C’est donc peut-être un genre sérieux que le roman, puisque ses chefs-d’œuvre éclipsent, dépassent, dans leur objet même, ces graves parents pauvres qui se plaignent de leur décadence8 ». L’année suivante, le 29 mars 1925, La Lanterne publie les réponses de Pierre Billotey à une enquête littéraire. À la question « Pour qui écrivez-vous ? », le romancier insiste sur la dimension pédagogique de son écriture romanesque : « Entendez-donc que je m’efforce d’être simple, clair, et singulièrement lorsque je veux exprimer une idée compliquée9 ». Billotey est donc de ceux pour qui la fiction, et en particulier le roman, peut constituer un vecteur de savoir. Toutefois, que l’on ne fasse pas de Billotey un vulgarisateur moral, un romancier à thèse, un docte amuseur, mais bien un romancier. La simplicité est chez lui une question de légèreté. C’est avant tout une narration concise, vive, dialoguée, qui permet aux personnages de porter leurs souffrances, parfois profondes, et leur condition jusqu’à la fin du roman. C’est un roman qui n’a pas honte d’en être un et dont les personnages eux-mêmes parfois soulignent le romanesque. Un roman qui, affranchi du sérieux de l’illusion sans verser dans le merveilleux, met toutes les coïncidences, les amours soudaines, les sortilèges, les voyages, les trésors et les inconstances dont il est capable au service de la connaissance de l’homme. On pense à certains romanciers du XVIIIe siècle, à Lesage, à Marivaux, à Diderot. Billotey aime les fausses préfaces et les récits rapportés (Sao Kéo, La fortune de Fortuné), les confessions (Le trèfle à quatre feuilles, La tour des abeilles), les adresses au lecteur (Rien que la chair, Le pharmacien spirite), les déguisements et les fausses identités (Le trèfle à quatre feuilles, Le miroir aux alouettes), les escrocs un peu picaresques (Le pharmacien spirite, La fortune de Fortuné, La tour des abeilles, Rien que la chair) et les jeunes filles qui sortent de pension ou du couvent (La fausse amoureuse, Le miroir aux alouettes). Mais que l’on ne se méprenne pas ; Pierre Billotey est bien un romancier des années 1920. Il dit la geste et les manières de son époque, de personnages désemparés qui, au sortir de la guerre, n’ont qu’une préoccupation : être quelqu’un dans la nouvelle société qui se construit.
Libido dominandi
Le monde des romans de Billotey est double. Il y a d’une part ce que le narrateur de La fortune de Fortuné appelle « notre époque » : un jeu pour le pouvoir, soit argent, soit séduction, soit institution bourgeoise. Et d’autre part, il y a l’insouciance, la gaîté, l’amour, en un mot, la gratuité. En moraliste, le romancier met donc en scène deux types d’hommes qui s’opposent : l’homme amoureux (la gratuité chez Billotey tient toujours d’un sentiment d’ordre amoureux, peu importe l’objet de cet amour) à l’insouciance heureuse, et l’homme inquiet que tourmente le besoin de pouvoir. Mais voilà, un personnage reste rarement l’un ou l’autre, et le jeu des sentiments, des forces et des faiblesses de chacun informe le parcours de tous. Les héros masculins de Billotey sont des hommes faibles, soumis, dirigés par une force qui les dépasse. Un des motifs favoris du romancier est l’ensorcellement, magique, amoureux, passionnel. Fortuné Lorillard, fils de chiffonnier né dans les détritus, éprouve un besoin maladif de réussite financière ; Octave Mégéat, le protagoniste du Cuistre ensorcelé, est sous le charme de la divinité aztèque Téoyamiqui, déesse de l’amour exalté ; Lucien Payel et son vieil employeur M. Huot ont l’âme tourmentée par le maskoui, un diable annamite, tandis que Marcel Berthomieu, dans Rien que la chair, se fait voler la sienne et devient un escroc adorateur de l’argent. Ces héros masculins ont également des difficultés à affirmer leur virilité, ou plutôt des difficultés à être à la mesure du rôle qu’ils s’imposent. En tant qu’hommes ils se veulent forts, fiers, maîtres de leurs actes et sont d’autant plus pathétiques qu’ils offrent le spectacle d’une vanité creuse qui se nourrit de demi-succès et de belles paroles. L’argent, le pouvoir, les institutions les dominent, et ces rapports de forces se traduisent souvent dans leurs rapports aux femmes. En plus de vivre les tourments des sens – la robe rouge est un élément récurrent des romans de Billotey –, les hommes sont souvent dépendants des femmes, financièrement et amoureusement. À titre d’exemple, Lucien Payel a besoin de l’amour de Sao Kéo et de l’argent d’Alice Huot, Marcel Berthomieu de l’amour de Germaine Villeneuve et de l’argent d’Else Van den Droek, Fortuné Lorillad de l’amour et de l’argent de la plantureuse Angèle, plusieurs personnages masculins du Miroir aux alouettes comptent sur l’argent de la jeune Madeleine. Si les jeunes filles de Billotey sont généralement positives et plus maîtresses de leur destin, le reste des personnages féminins est également animé d’une recherche de pouvoir affectif ou financier, mais sans être pris par les mêmes exigences de réussite que les hommes. Mais peut-être ces hommes aiment-ils la domination ? « Je n’aurais jamais cru qu’un homme pût manquer de dignité à ce point-là. Vous ne voyez donc pas qu’Alice Huot est orgueilleuse, et qu’elle se fait un jeu de vous humilier ? » dit-on à Lucien Payel dans Sao Kéo, ce à quoi il répond : « Il n’est pas impossible que ce jeu-là soit beaucoup plus intéressant pour moi que pour Mademoiselle Huot ». Souvent, le désir concilie les sexes, à l’exemple de René Farges, le héros du Trèfle à quatre feuilles, jeune agrégé, bourgeois déjà rangé, qui trouve dans les activités frauduleuses de sa fiancée un excitant à son désir, ou de Fortuné Lorillard dont le corps obèse de sa femme Angèle satisfait l’avidité. L’acte sexuel est généralement dénué de culpabilité chez Billotey. Il est parfois source de rire (Fortuné Lorillard dont le postérieur est, dans le noir, par une malencontreuse équivoque, entrepris par l’homme qu’il fait cocu), et en tant que plaisir, il est du côté de la gaîté et de l’amour, les deux vertus essentielles de ses romans. Le plaisir mène à l’amour et tout finit bien généralement pour le héros. Pourtant, on hésite à faire de Billotey un optimiste. Que penser des morts soudaines des héros de Sao Kéo et d’Un cœur ardent au moment où ils vont toucher au bonheur ? Fortuné Lorillard s’est révélé être un monstre… comme tout le monde, nous dit-on. Le narrateur de Raz Boboul revient bredouille de l’aventure, et retourne à la vie misérable qu’il exècre. Le trèfle à quatre feuilles se termine par un mariage ? Oui, mais qui fera de la piquante Marie-Louise une petite bourgeoise rangée. À quel point tout cela est-il sérieux ? Telle est la question, à propos de la vie, à propos d’eux-mêmes, que les romans de Pierre Billotey ont l’art délicat de nous poser.
1. Le Divan, 1922.
2. Alain Ruscio, Le credo de l’homme blanc, Regards coloniaux français, XIXe-XXe siècles, Complexe, Bruxelles, 1996.
3. Ibid. p. 203
4. Le Divan, 1922.
5. La Pensée française, n° 66, 10 janvier 1924.
6. Le Figaro, 7 avril 1932.
7. Le Matin, 28 septembre 1919.
8. La Pensée française, 10 janvier 1924.
9. La Lanterne, 29 mars 1925.
Pierre Billotey a publié :
Le cuistre ensorcelé, « Nouvelle collection Albin Michel », Albin Michel, 1922 ; Le pharmacien spirite, « Bibliothèque du Hérisson », Edgar Malfère, 1922 ; Un cœur ardent, Albin Michel, 1923 ; Raz Boboul, « Bibliothèque du Hérisson », Edgar Malfère, 1923 ; La fortune de Fortuné, Roman gai, « Merle Blanc », Société d’édition et de publicité technique, 1923 ; La fausse amoureuse, Albin Michel, 1925 ; Le trèfle à quatre feuilles, Albin Michel, 1926 ; Le miroir aux alouettes, Albin Michel, 1927 ; Rien que la chair, Albin Michel, 1928 ; Sao Kéo ou Le bonheur immobile, Albin Michel, 1930 ; La tour des abeilles, Nouvelle Société d’édition, 1932.
EXTRAITS
Après onze années de ménage, de soin plutôt, il mourut pendant la guerre, comme il atteignait la cinquantaine. Il mourut parce qu’il se portait mieux, que le temps était beau ce jour-là, et qu’Ernest, donc, avait éprouvé l’envie de se promener un peu. Une automobile l’écrasa sur le bord de la route. Il ne l’avait pas entendue venir, parce qu’il n’entendait rien du tout. Ernest, somme toute, mourut de surdité. S’il avait possédé de bonnes oreilles, il vivrait encore aujourd’hui.
Le miroir aux alouettes, p. 76.
M. Macadré tira de sa poche une feuille sur laquelle il avait récemment recopié un texte sanscrit, très court, puisqu’il se bornait à une seule phrase. Mais c’était une phrase merveilleuse. On pouvait, à force d’étude, y discerner jusqu’à sept sens, tous différents, et difficiles à concilier. Macadré entreprit de les analyser de nouveau. Et il s’absorba si profondément dans cette analyse que le temps cessa d’exister pour lui. Vers minuit, il se dressa, illuminé par une béatitude auguste : il venait de découvrir dans la phrase sanscrite un huitième sens, qui renfermait tous les autres d’une manière transcendante.
Rien que la chair, p. 198.
C’est sous un pommier, derrière la maison, que la table est mise, – une toute petite table, avec une nappe à carreaux rouges. Dans la carafe ronde, dans le vin blanc, il y a un reflet du ciel. Et un rayon perce le feuillage, jaunit le pain dans la corbeille, donne à la volaille fumante sur son plat la couleur des Rembrandt. À mon appétit, je mesure combien périclitent en moi les scrupules et l’inquiétude.
Le trèfle à quatre feuilles, p. 182.











