Depuis toujours à l’écoute de Daniel Poliquin, François Ouellet est, plus que quiconque, en mesure de porter un jugement juste, pénétrant et audacieux sur l’œuvre frémissante de Daniel Poliquin.
Non seulement il sait tout de la production de l’auteur, mais encore il scrute avec la délicatesse requise le lien entre Daniel et son père, Jean-Marc Poliquin. L’analyse de Ouellet dans La fiction du héros1 connaîtra ainsi deux registres : d’une part, le rôle du parricide dans la littérature ; d’autre part, la place de cette constante littéraire dans le parcours de Daniel Poliquin. D’autres aspects attireront cependant l’attention de Ouellet. Par exemple, le désir de vie nouvelle qu’éprouvent les personnages de Poliquin, ou encore la culpabilité que combattent nombre d’entre eux avec un succès souvent limité.
La vision que Ouellet prête à Poliquin situe la paternité au cœur des débats entre mâles. Qui n’est pas père entend le devenir, qui est père refuse de partager son trône avec le rejeton. Les personnages ont beau se déporter d’un roman à l’autre en changeant de peau, toujours ils se retrouvent face à leur géniteur ou à leur progéniture : « Du reste, souligne Ouellet, le retour des personnages ne fait que mettre en valeur la primauté de la structure symbolique, la préséance de cette structure dans l’ordre du discours, et dévoiler, exactement à l’encontre de la confidence du héros à son père, l’enjeu œdipien qui définit le projet de toute l’œuvre de Poliquin ». Bien sûr, la mère facilite ou entrave cette quête, mais père et fils ne se tiendront pas quittes pour autant. Ouellet résume ainsi le traitement requis : « 1) pour devenir père, il faut trouver l’amour ; 2) pour trouver l’amour, il faut être en règle avec son identité ; 3) pour être en règle avec son identité, il faut renouer avec son père ». Il n’en faut pas plus pour pénétrer au vif des romans de Poliquin. Saisissant une illustration, Ouellet décrit le conflit : « L’Obomsawin, c’est autant le roman d’un fils incapable de devenir père (Tom Obomsawin) que celui d’un père qui a oublié trop vite qu’il n’était qu’un fils (Louis Yelle) et de pères qui, sous leur apparence de pouvoir symbolique – figures de pères des grands récits mémoriaux –, apparaissent condamnés par une sorte de fatalité à n’être jamais que des fils (Charlemagne et Byron) ». D’où sourd cette malédiction ? De ce que les pères s’identifient au pouvoir sous toutes ses formes et refusent de troquer leur avantage vertical contre une horizontalité faite d’égalité. Mais les fils ne font pas mieux quand, trop pleutres pour « tuer le père », ils subissent le joug sans le secouer.
Le parricide comme source
Une citation d’Oscar Wilde ouvre l’analyse de Ouellet : « Dans la littérature, il faut tuer son père ». Il le faut, parce que, enchaîne Ouellet, « cette notion désigne, dans l’univers culturel qui est le nôtre et hier encore patriarcal, tous traits caractéristiques qui font office d’autorité dans l’imaginaire collectif : la Loi, l’Institution, l’Église, Dieu, la monarchie, le père de famille, etc. ». De là à identifier cette révolte filiale comme la base de l’univers de Poliquin, il n’y a qu’un pas vite franchi par Ouellet. Il a d’ailleurs beau jeu de retrouver partout cette nécessité. Certains des fils créés par Poliquin s’enfuient, d’autres écrasent autrui plutôt que d’affronter le tuteur, d’autres encore attendent la mort naturelle du géniteur, et bien des pères oublient qu’eux non plus n’ont pas mûri… Ouellet suit pas à pas Poliquin qui, de bouquin en bouquin, s’approche d’une solution faite de courage, de lucidité, d’amour pour le père, la mère et la femme.
Un des aspects les plus émouvants du travail de Ouellet, c’est la confidence qu’il obtient d’un Poliquin à la fois pudique et transparent, fils 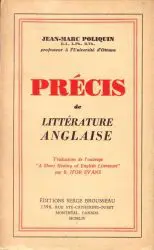 discret et héritier sans complaisance. « Dans ma vie privée, raconte Poliquin, j’avais un père que j’adorais, mais qui en même temps pouvait être un homme très étouffant, très dur. Je n’ai pas voulu en parler comme tel, et c’est la première fois qu’on me pose la question. » C’était en 1995 (Nuit blanche, no 62).
discret et héritier sans complaisance. « Dans ma vie privée, raconte Poliquin, j’avais un père que j’adorais, mais qui en même temps pouvait être un homme très étouffant, très dur. Je n’ai pas voulu en parler comme tel, et c’est la première fois qu’on me pose la question. » C’était en 1995 (Nuit blanche, no 62).
Dans cet article, Ouellet reprend de magnifique façon l’aveu mesuré de Poliquin. Celui-ci raconte, en fixant moment et décor. Père et fils se retrouvent en Allemagne en 1973. Le père revient de Varsovie pour rencontrer son fils qui poursuit des études en Allemagne. « Mon père, dit le fils, lisait Goethe dans le texte, mais il n’avait pas oralisé l’allemand, que moi je parlais. » Quand le père éprouve des difficultés à acheter son billet de train, le fils vole à son secours. « Avant de me quitter, il m’a fait un clin d’œil et m’a dit ‘Tu es content, hein ?’ J’ai répondu ‘Oui. Je te prends en charge comme si tu étais mon enfant, parce que je t’aime’. Il a dit ‘Moi aussi je t’aime mon petit gars’ ». Scène magnifique grâce à laquelle le parricide qu’explore Ouellet trouve sens et fécondité : il fonde l’écriture et peut déboucher sur l’amour.
Il faut convenir que le mystère n’est pas totalement dissipé. D’une part, les dédicaces de Daniel Poliquin à son père évitent d’évoquer la paternité. « À la mémoire de Jean-Marc Poliquin, journaliste », écrit-il en exergue à son René Lévesque (Boréal, 2009). « À la mémoire de Jean-Marc Poliquin, iconoclaste clandestin », écrit-il au départ des Nouvelles de la Capitale (Québec Amérique, 1987). D’autre part, une note infrapaginale de Ouellet amplifie le doute. « On ne peut pas ne pas songer ici [L’Obomsawin] au rapport du romancier avec Jean-Marc Poliquin, ‘qui n’avait jamais osé écrire que sous pseudonyme’ (Roman colonial, p. 115) et qui est mort la veille de la parution de Temps pascal. » De lui-même Daniel Poliquin insiste sur la charge symbolique de ce décès : « Il est mort le vendredi, le livre [Temps pascal] est sorti le lundi. Cela m’a toujours blessé, parce que c’était vraiment le bras de fer ultime. Mon père qui était écrivain anonyme, qui écrivait sous pseudonyme… » Mystère il y a ici puisque les contemporains du père (dont moi) ont pu lire les ouvrages signés Jean-Marc Poliquin et entendre soir après soir à la télévision de Radio-Canada ce journaliste racé, cultivé, fiable. Clandestin ? (Peut-être ai-je mal lu quelque chose.)
Cette confrontation du fils avec le Père, parricide symbolique compris, Poliquin la vit donc dans son être comme dans son œuvre. « Comme tout romancier, dit Ouellet, Poliquin n’écrit pas ses textes à partir du point de vue du père, mais à partir de celui du fils. » Démonstration aussi délicate que concluante.
Renaissance et expiation
À cet enjeu se joignent deux soucis majeurs : celui qu’entretient chacun de « refaire sa vie » et celui, connexe, de liquider la culpabilité qui colle à la peau. L’art de Poliquin, tel que décrit par Ouellet, sera de fusionner ces riches et douloureux écheveaux. Poliquin le fera en multipliant les personnages récurrents, en les insérant dans des intrigues qui soulignent d’autres facettes de leur être, en les laissant terminer dans un calme relatif le périple né ailleurs. Au total, la mission est accomplie : sur ceux (et celles) qui ont consenti à aimer autrui et soi-même, à privilégier l’égalité plutôt que la domination, à confesser mensonges, roueries et cruautés du passé, une certaine paix descendra. Tous ne sauront pas la retenir, chacun en aura senti le souffle.
Œuvre puissamment unifiée que celle-là malgré les différences qui sautent aux yeux. Poliquin avouera à Ouellet (cf. Nuit blanche) n’avoir guère pris conscience de « l’idée obsessionnelle » qui traversait à son insu ses premiers livres : « J’étais certain d’écrire des romans différents chaque fois. La belle illusion ! Maintenant je me rends compte que finalement on écrit un seul roman ». Peut-être Michel del Castillo tomberait-il d’accord, lui qui n’a cessé, depuis le Tanguy de 1957, de chercher ses parents à travers une cinquantaine de romans. Ouellet aura ainsi réussi, à force de doigté et de lucide accompagnement, à rendre justice à la puissante œuvre personnelle de Poliquin.
Quelques scories
Regrettons les coquilles qui affligent une écriture par ailleurs exemplaire. Dès la première page (note 1) : « […] entretiens que je vais parfois cités » ; page 13 : « […] horizon que l’écrivait n’atteint jamais » ; page 44 : « […] qu’il avait autrefois réclamer… » et « qui parfois confine jusqu’à l’ambiguité » ; page 144 : quatre vers de Shakespeare nous valent trois fautes : « All the world’s a [omis] stage, / And all the men ane [sic] women merely players / They have their exists [sic] and their entrances, / And one man in his time lays many parts » (As You Like It, acte 2, sc. 7) ; page 151 : « […] ce qui solda [souda ?] leur amitié » ; page 160 : « […] qui s’accorde à la oisiveté de l’affabulation ». Etc. Dommage.
1. François Ouellet, La fiction du héros, L’œuvre de Daniel Poliquin, Nota bene, Québec, 2011, 224 p. ; 27,95 $.
EXTRAITS
Pouvoir refaire sa vie, chez Poliquin, c’est au sens fort une affaire d’identité. Et de Père. À cet égard, la légende animalière (l’écureuil noir) ne fait que symboliser toute l’œuvre romanesque de Poliquin.
p. 17
Malgré son passé glorieux, Médéric Dutrisac n’est pas un père, il a gâché son effort à le devenir : quand le roman commence, Médéric recommence – par-delà le parricide qui a eu lieu il y a longtemps, mais qu’il n’a toujours pas su assumer.
p. 30
Or, je tiens pour acquis que, dans l’œuvre d’un romancier, il n’est de véritable manière que celle, transcendante, qu’impose la métaphore paternelle. À cet égard, L’écureuil noir vient clore un cycle de quatre romans inauguré par Temps pascal.
p. 116











