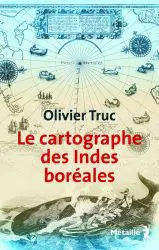À l’image même de la scène d’ouverture, l’inauguration du Vasa, somptueux navire de guerre construit pour le roi Gustave II Adolphe de Suède, qui sombra quelques minutes après sa mise à l’eau, Le cartographe des Indes boréales1 pèche par un excès de grandeur. En pleine guerre de Trente Ans, le Vasa devait rejoindre la flotte de la Baltique et permettre à la Suède de régner sans partage sur les eaux nordiques. Les causes du naufrage furent multiples, mais l’excédent de poids, notamment dû au nombre imposant de canons devant assurer une force de frappe à nul autre navire comparable, figure sans doute en haut de liste. Instable, le Vasachavira à la première bourrasque sous le regard incrédule des curieux venus assister à son baptême. Leur rêve de suprématie venait de couler à pic. Telle est l’image, injuste me reprochera-t-on, qui ne m’a pas quitté tout au long de ma lecture du roman d’Olivier Truc, journaliste qui vit à Stockholm et qui a publié plusieurs polars ayant pour cadre la Laponie.
Le cartographe des Indes boréales ne fait pas moins de 631 pages et est composé de 109 chapitres, chacun précédé d’un extrait de psaume luthérien. Malgré les coupures proposées par l’éditrice, le texte aurait gagné à être épuré davantage. S’y entremêlent, non sans habileté il faut le reconnaître, guerres de religion, luttes territoriales pour l’appropriation des routes commerciales, étude anthropologique des mœurs laponnes, évangélisation des populations nordiques, histoire d’amour et intrigues politiques. Le tout servi dans un style vif et entraînant, mais qui force peut-être un peu trop sur les descriptions par moments. À elle seule, la gamme des odeurs qui émane des différents lieux pourrait constituer un sujet d’étude. Rien à voir toutefois avec Le parfum de Patrick Süskind.
Le récit se déroule entre 1628 et 1693. Il repose sur une documentation tout aussi impressionnante que l’aventure qu’entreprend Izko, le protagoniste du roman que l’on suit dans ses multiples péripéties. Izko rêve de devenir harponneur baleinier, comme l’était avant lui son père, mais le cours de sa vie change radicalement lorsqu’il est témoin d’un double événement : un meurtre commis sur le Vasa, le jour même de sa mise à l’eau, et la naissance d’un enfant sur l’un des ponts du vaisseau. Les deux événements sont-ils liés ? La femme qui lui a lancé un regard du pont du bateau a-t-elle voulu lui jeter un sort pour avoir été témoin de l’événement ? S’agit-il, comme certains le prétendront dans le cadre du récit, d’une sorcière ? La chasse aux sorcières (et aux sorciers dans le cas présent) prend dès lors le dessus sur la chasse à la baleine.
Au moment où surviennent ces événements, la guerre de Trente Ans fait déjà rage depuis une dizaine d’années. Tout-puissant, le cardinal Richelieu a des yeux et des oreilles partout en Europe. Lorsqu’il apprend qu’un jeune Basque détient peut-être des informations stratégiques sur ce qui est survenu sur le Vasa, il mandate l’un de ses évêques pour s’enquérir de ce qu’a vraiment vu Izko, et en faire son espion. C’est ainsi, à son corps défendant, que le jeune Izko devient espion pour le compte du cardinal après avoir étudié la cartographie à Lisbonne, ce qui lui procure une couverture essentielle pour mener à bien la mission qui lui est confiée tout en faisant œuvre utile. Cartographier les mers et les terres nordiques permettra d’en revendiquer plus facilement leur possession, et d’assurer la circulation du commerce. Izko explorera la Laponie en quête de mines d’argent qui serviront tout autant à financer les guerres que mène Gustave II Adolphe contre ses rivaux qu’à évangéliser les populations autochtones. Régner sur la terre, sur les mers et dans les cieux. Nul doute que le cardinal Richelieu entrevoyait ce monde comme étant son royaume.
En arrière-plan des multiples aventures que sera appelé à vivre Izko, la guerre de Trente Ans oppose luthériens et papistes qui cherchent à imposer de force aux populations locales la seule foi digne de ce nom, la leur. Le but avoué n’est autre que d’éradiquer la culture et les coutumes laponnes pour permettre à la foi chrétienne de s’imposer. Malgré lui, Izko est amené à jouer un rôle dans la domination des populations nomades qui vivaient de l’élevage des rennes et honoraient la mémoire de leurs ancêtres par des pratiques ancestrales jugées profanes, voire sataniques, par les missionnaires venus sauver leur âme. Mais le salut a un prix : les messagers du Tout-Puissant s’empareront de leurs terres et de leur âme. Solidement documentés, ces chapitres font écho au traitement réservé aux populations autochtones de maints pays. L’évangélisation forcée qu’ont connue ces populations repose toujours sur les mêmes prémisses : le mépris de l’autre. « Ils ressemblaient à des bêtes effrayées, ils restaient collés les uns aux autres, avec leur accoutrement étrange, leur physique disgracieux, leur réputation sulfureuse et leurs manières repoussantes. Des animaux inquiets. Voilà comment je les voyais », avouera candidement l’un des missionnaires.
L’éradication de la culture laponne est au cœur de ce roman brossant le portrait du pire qui advient lorsque religion et politique s’entremêlent. Tout ce qui échappe à la compréhension des uns, donc à leur pouvoir, devient aussitôt suspect et nuisible. Il faut donc s’attaquer à la racine du mal, et offrir magnanimement le salut à ceux que l’on asservit pour leur bien, au singulier comme au pluriel.
Allégé, le Vasa aurait sans doute été à même de rejoindre la flotte baltique, et l’issue de la guerre eut pu être autre. Qu’en sera-t-il du roman d’Olivier Truc ? Il appartient aux lecteurs d’en décider. Certains y trouveront leur compte et leur plaisir ; d’autres trouveront la traversée un peu longue.
1. Olivier Truc, Le cartographe des Indes boréales, Métailié, Paris, 2019, 631 p. ; 39,95 $.
EXTRAITS
Le Vasa sombrait, des objets mal arrimés transperçaient l’espace du pont, des gaffes, des cordages, des seaux, les femmes et les enfants roulaient sur le bastingage, criaient leur désespoir. Des hommes tentaient de se hisser de l’intérieur du navire, apparemment pris au piège. Des mains s’agitaient. D’autres cris. Des cordes claquaient. Le chaos triomphait.
p. 24
J’ai pris du galon, commença enfin Karmelo, je suis passé de mousse à matelot maintenant. Mais par la Vierge, j’ai vu bien du malheur. J’ai vu une baleine briser une chaloupe d’un coup de queue, j’ai vu des hommes éclater comme des noisettes sous la pierre, j’ai vu un homme se noyer dans une cuve d’huile bouillante, j’ai vu des hommes à qui il fallait couper les membres gelés. J’ai vu…
p. 103
Le pasteur grondait, adoucissant son regard lorsqu’il passait sur le commissaire. Izko découvrait les pauvres paysans qui peuplaient ce bout du monde. Ils craignaient Dieu, aucun doute là-dessus. Les femmes portaient un fichu strict qui encadrait leur visage austère tourné vers l’autel. Les hommes se jetaient des regards inquiets les uns aux autres, comme si en chaque parole du pasteur se jouait leur destin, au détriment peut-être du voisin.
p. 133
L’homme se tordait à leurs pieds depuis plusieurs minutes. Son gémissement guttural curetait le cerveau d’Izko. Les autres supportaient, pris d’un balancement lancinant et régulier. Il avait fallu un quart d’heure au chaman pour entrer en transe. Izko regrettait maintenant qu’il ait réussi. Ils frappaient. Aux portes du royaume des morts. C’était la première fois qu’Izko voyait un chaman. L’homme se contorsionnait comme un serpent, un tambour étrange constellé de signes reposait à ses côtés. Il s’en était servi pour entrer en communication.
p. 179