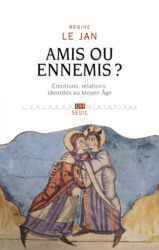Le livre épouse avec tant de puissance et d’emportement le mouvement fluide et constant de la pensée qu’il faut un long moment pour accepter l’apparente anarchie du récit. Peu à peu, on admet que la pensée ne fait pas de pause à l’alinéa et ne s’exprime pas par phrases complètes rangées au creux des paragraphes. Le texte s’abandonne à la pensée et la pensée est un flot ininterrompu, désinvolte, capricieux, une sorte de monologue où une conscience commente sa vie et celle des autres, se joue un théâtre moqueur et rempli de (mauvais) calembours. Écriture déroutante et qu’il faut apprivoiser.
Kurt Janisch est gendarme de son état, mais de tempérament carnassier et d’ambition immobilière. Il n’aime pas les femmes, mais il tient à les séduire, à les soumettre à ses exigences sexuelles. Le sadisme lui plaît, un peu parce qu’il y exprime sa misogynie, beaucoup parce qu’il espère soutirer à ses victimes le don de leur maison. L’homme est avide de pouvoir, avide de propriété. Il fait partie d’une société avide de production qui ne sait pas imiter la nature et son calme équilibre. « La voiture fonce, entre brièvement dans le sillage d’une giboulée de mépris venant du gendarme, lequel méprise par principe tout ce qui ne lui appartient pas. »
La narratrice se raconte la vie et les faiblesses d’autrui avec une sorte de condescendance barbelée. Elle méprise la faiblesse des femmes, elle rumine d’interminables verdicts sur leur manie de s’embellir pour en offrir davantage à la dévastation du sadisme, elle plaisante méchamment quand elle les voit en proie non au désir, mais à l’humiliation. Nouvelle forme d’avidité qui fait le bonheur de l’autre sexe.
Roman policier ? Pas vraiment, car c’est l’avidité la coupable et elle est partout. Immersion dans les plus inquiétants bas-fonds de l’âme humaine.