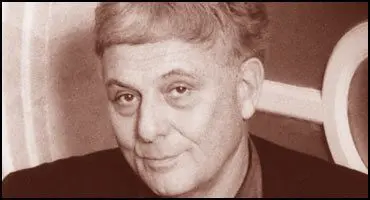Au printemps dernier, Philippe Sollers a occupé le devant de la scène éditoriale française. Pas moins d’une demi-douzaine de ses anciens ouvrages, dont Paradis, Le parc, et Lois, ont été réédités en format poche.
Dans le même temps, Gallimard a fait paraître le volumineux Éloge de l’infini, présenté par Sollers comme la suite de La guerre du goût. Bien que Philippe Sollers insiste sur le caractère inédit d’Éloge de l’infini, il convient de préciser qu’il s’agit d’un recueil d’essais et d’articles publiés, pour la plupart, depuis 1994.
En contrepoint, Gérard de Cortanze a publié un portrait inédit de l’écrivain français : Philippe Sollers ou la volonté de bonheur1. Cet ouvrage présente la particularité de se consacrer exclusivement à l’enfance et à l’adolescence de Philippe Sollers, c’est-à-dire à la genèse de l’écrivain. Agrémentée de documents iconographiques, de témoignages et d’extraits de textes, cette biographie jette un éclairage utile sur l’œuvre d’une figure importante de la littérature française contemporaine.
L’enfance de l’art
Gérard de Cortanze nous avertit d’emblée : « On ne sait rien de Philippe Sollers sauf si l’on se décide à le lire vraiment. Les documents ne sont pas rares, ils existent. C’est beaucoup. Il faut se débrouiller avec eux ». Collaborateur régulier ou occasionnel de nombreux journaux français, l’écrivain est aussi fréquemment invité à participer à des émissions télévisées (dont le défunt Bouillon de culture). Rien d’étonnant, donc, à ce que ce personnage médiatique séduise, fascine ou exaspère. Gérard de Cortanze choisit d’aller au delà des évidences et de ne pas écouter la rumeur. Son objectif : « parler d’un Philippe Sollers antérieur à l’écrivain Philippe Sollers ». Le pari est simple, il consiste à montrer que l’écriture est liée à l’enfance et au corps, ce que Sollers lui-même confirme: « L’œil, l’oreille, la respiration, les réflexes, le sens de la cible, ça s’éduque […]. Un enfant imprime en soi cette réalité brute. Un adulte est écrivain s’il sait retrouver cette inscription ».
C’est sous le nom de Philippe Joyaux que le futur Sollers naît, en 1936, à Talence (en banlieue de Bordeaux). La même année, le Front Populaire accède au pouvoir et la guerre d’Espagne éclate, jetant sur les routes des centaines d’exilés qui remontent jusqu’à Bordeaux. Le jeune Joyaux est un enfant de la petite bourgeoisie de province. Son père et son oncle sont propriétaires d’une usine de métallurgie et jouissent d’un statut de notable. Trois ans plus tard, la France est occupée par les Allemands. Malgré la réquisition d’une partie du domaine familial, la famille Joyaux choisit de cacher des aviateurs anglais dans la cave à vins. Pour le jeune Philippe, le drame de la guerre se résume à d’étranges mots : « Ici, Londres », « spitfires », « Royal Air Force », « Luftwaffe ». Il y a aussi ces étranges étoiles jaunes que certains habitants de la ville sont désormais contraints de porter sur leurs vêtements. Sollers se souviendra de tout cela : « Très jeune, on vit à fond des sensations qu’on n’oubliera pas, nettes, cachées, débordantes ».
Après la guerre, le jeune Joyaux est victime de violentes crises d’asthme et de très fréquentes otites. Tenu à l’écart et choyé, il s’adonne au plaisir de la lecture et découvre la poésie au contact de Baudelaire, Rimbaud et Lautréamont. Ces premières émotions sont empreintes d’une sensualité particulière car l’enfant commence à lire dans le parc de la propriété familiale. Il parcourt les livres à la recherche des textes mais aussi des images : Jean-Auguste-Dominique Ingres, Jean-Honoré Fragonard, Jean-Antoine Watteau, dont le tableau Assemblée dans le parc est accroché dans sa chambre, en face de son lit. Comment, alors, ne pas entendre dans la conclusion de « Paradis de Cézanne » une évocation indirecte aux jardins de l’enfance : « Cézanne ? Il est où Cézanne ? Partout, nulle part. Dans le fond du jardin du Temps, sous le tilleul » ? Être artiste, c’est habiter pleinement son corps et apprendre à faire de celui-ci une formidable machine à percevoir, sentir et enregistrer des sensations. Irrémédiablement marqué par le souvenir de ces maladies enfantines, Philippe Sollers a très tôt réalisé que chez tous les grands écrivains « c’est le corps qui donne à la respiration rythmique sa fluidité, sa puissance ». Paraissent d’abord H, Paradis, Paradis 2 : trois romans, sans ponctuation, qui consacrent la voix et le souffle comme instrument privilégié de la lecture.
Ce qui est vrai pour la littérature l’est tout autant pour les autres disciplines artistiques. Gérard de Cortanze rappelle que chez Auguste Rodin, Pablo Picasso, Willem De Kooning l’œuvre d’art est la signature d’un corps. Les créateurs (musiciens, peintres, écrivains, danseurs) convoqués par Sollers entretiennent tous ce rapport singulier au corps et à la sensation. Il s’agit, en somme, de promouvoir un autre rapport au monde en montrant qu’il est possible de s’arracher au temps collectif et à la finitude de l’être humain en devenant un corps de jouissance.
Le corps insoumis
Enfant dissipé et chahuteur, Philippe Sollers doit très vite composer avec la volonté de normalisation de la société. Issu d’une famille assez libérale, il grandit dans un climat quelque peu incestueux au milieu de femmes (mère, sœurs, tante) dotées d’une forte personnalité. Le nom de la famille lui vaut quelques brimades et quolibets de la part de ses camarades, trouvant vraisemblablement que « Joyaux » a trop d’éclat. « Sollers » devient le pseudonyme sous lequel sera signé, quelques années plus tard, un premier roman : Une curieuse solitude.
Ce récit initiatique, aux accents proustiens, relate l’éveil à la sexualité de son auteur. En 1951, en effet, la famille Joyaux engage une domestique espagnole, jeune, belle et farouchement indépendante. La découverte du désir, de la séduction et de la gratuité du bonheur achèveront de convaincre Philippe Sollers de la nécessité de demeurer réfractaire à tout embrigadement et à toute forme de soumission. Il aura d’ailleurs l’occasion de montrer sa détermination lors de la Guerre d’Algérie, qui débute en 1954. Refusant d’aller combattre les rebelles indépendandistes, Philippe Sollers est interné dans les hôpitaux psychiatriques militaires et ne doit son salut qu’à une intervention d’André Malraux, alors ministre de la Culture. Il faut préciser que son premier roman avait été remarqué et salué par des écrivains tels que François Mauriac, Louis Aragon, André Breton. Paradoxalement, cette paternité se révèle plutôt embarrassante pour un jeune auteur qui ne tient pas à être ramené dans le giron de l’Institution littéraire.
Si, comme l’écrit Gérard de Cortanze, « l’écriture [chez Philippe Sollers] est née d’une dissidence », l’œuvre sollersienne, dans son ensemble, peut être considérée comme le combat d’un homme soucieux de conserver sa singularité et sa liberté. Philippe Sollers le déclare sans ambages : « Tout individu est désormais en guerre contre l’ensemble, quel qu’il soit, dans lequel il se trouve pris. Il ne peut compter rigoureusement que sur lui-même ». La fondation de la revue Tel Quel, en 1960, témoigne d’une volonté de rompre avec le conformisme et le conservatisme qu’incarnent notamment l’Académie française et les universités. Inlassablement, entouré de quelques amis, il défend et réhabilite Antonin Artaud, Georges Bataille, Louis-Ferdinand Céline, Francis Ponge alors même que ces écrivains sont à peu près totalement ignorés en France. L’aventure de Tel Quel cessera avec le passage de Philippe Sollers chez Gallimard, au début des années quatre-vingt.
Certains reprochent précisément à Philippe Sollers d’être un inconstant, voire un vil opportuniste. Celui-ci leur répond: « Sollers est quelqu’un que j’utilise, que je peux instrumentaliser. […] Plus il y a de Sollers, mieux ça vaut. Dans l’exercice du dédoublement productif, le plus fort étant évidemment de se faire passer pour soi ». Aujourd’hui, le meilleur moyen d’échapper à l’emprise de la société du spectacle n’est pas de se tenir à l’écart, mais bien de multiplier les images de soi. Ainsi, l’auteur de Femmes se plaît à apparaître là où on ne l’attend pas. Il avance masqué. L’élaboration de ce que Gérard de Cortanze appelle une « mytho-biographie » procède de ce désir de faire de sa vie une œuvre : « La vie est un roman, aussi vaut-il mieux la mener comme si l’on était un personnage au milieu de personnages de romans qui n’en ont absolument pas conscience ».
Faut-il s’étonner que Philippe Sollers considère son expérience singulière comme un fait littéraire ? La réponse se trouve dans le magnifique texte « La lecture et sa voix » dans Éloge de l’infini2. Citant Guy Debord, Philippe Sollers déclare : « Pour savoir écrire […], il faut avoir lu et pour savoir lire, il faut savoir vivre » . Le problème est que nos sociétés déploient de redoutables moyens pour nous empêcher de lire. La diffusion massive de l’écrit et l’analphabétisme généralisé s’accompagnent de rituels commémoratifs sur fond d’amnésie : « Je peux feindre ou rêver de m’intéresser à la vie étrange et dramatique de Hölderlin, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Artaud, mais me mettre devant leurs mots est une autre affaire. Ces mots ne se laissent pas faire. Ils persistent à résonner malgré le film ou le roman-photo qu’on plaque sur leurs auteurs ». La lecture, on le comprend donc, est un éblouissement, une expérience intérieure. D’où l’urgence d’entendre l’injonction de Saint-Augustin : « Prends et lis ».
L’écriture au combat
Dans la préface à la Guerre du goût, Philippe Sollers déclare vouloir rendre compte du conflit fondamental qui oppose, à travers l’histoire, les écrivains et les artistes à la société dans son ensemble. Le propos ne change pas dans Éloge de l’infini. Le ton, en revanche, se radicalise. L’extrait du traité de Houai-nan-tse placé en exergue de l’ouvrage annonce que le recueil se veut une sorte de manuel de stratégie. Gérard de Cortanze rappelle que Philippe Sollers est un adepte de Karl von Clausewitz et croit, comme celui-ci, à la supériorité de la posture défensive. Pourtant, face à ce que Philippe Sollers nomme l’Adversaire (l’incarnation de la bêtise, du conformisme, de l’ignorance et de la haine), il apparaît nécessaire de mener une véritable guerre. Or, l’Adversaire ne lit pas : il communique, calcule et contrôle. La lutte sera donc autant éthique, esthétique que politique. Comme le rappelle Philippe Sollers, en citant Paul Cézanne, « le goût est le meilleur juge » ; aussi, pour maintenir la pensée en éveil, il faut s’extraire du temps social, « être acteur de sa sensation […] et posséder un sens historique informé et large ». Dès lors, le temps et l’espace cessent d’être cloisonnés : Franz Kafka, James Joyce, Blaise Pascal, Friedrich Hölderlin, Han Fei s’interpellent et se répondent par-delà les siècles et les frontières géographiques. À cet égard, l’essai de Philippe Sollers constitue un sésame pour pénétrer dans l’infini de la création.
Cependant, l’érudition ne cesse jamais d’être alliée au plaisir. Frondeur et polémiste, Philippe Sollers ne cède jamais à la tentation du nihilisme ou de la dépression. Cette volonté de revendiquer la volupté, le jeu et la connaissance comme valeurs suprêmes caractérise un auteur qui déclarait récemment : « La vie est courte, je m’efforce de vivre d’extase en extase ». Gérard de Cortanze rapporte que lors d’un entretien, un journaliste a tenté de faire de Philippe Sollers un disciple de Kant. La réponse a fusé, cinglante : « Pourquoi demander au Français d’être amnésique à sa langue et à sa tradition philosophique ? Le plaisir avant toute chose ! ». Réfutant les systèmes philosophiques et les représentations du monde fondées sur l’absurde et le pessimisme, Philippe Sollers revendique une autre filiation : Michel de Montaigne, Marcel Proust, Jacques-Bénigne Bossuet, Henri de Saint-Simon, le Marquis de Sade, Denis Diderot. Gérard de Cortanze ne s’y trompe pas en affirmant que chez Philippe Sollers « le goût du bonheur vient de loin, de l’enfance ».
1. Gérard de Cortanze, Philippe Sollers ou la volonté de bonheur, Chêne, Paris, 2001, 273 p. ; 49,95 $.
2. Philippe Sollers, Éloge de l’infini, Gallimard, Paris, 2001, 1095 p. ; 39,95 $.
Philippe Sollers a publié, entre autres :
Le parc, Prix Médicis, Seuil, 1961 et « Points Roman », Seuil, 1981 ; L’intermédiaire, Seuil, 1963 ; Drame, Seuil, 1965 et « L’imaginaire », Gallimard, 1990 ; Nombres, Seuil, 1966 et 1968 ; L’écriture et l’expérience des limites, Seuil, 1968 et « Points Essais », Seuil, 1971 ; Logiques, Seuil, 1968 ; Entretiens avec Francis Ponge, Seuil, 1970 ; Lois, Seuil, 1972 ; H., Seuil, 1973 ; Sur le matérialisme : De l’atomisme à la dialectique révolutionnaire, Seuil, 1974 ; Délivrance : face à face, avec Maurice Clavel, « Points », Seuil, 1977 ; Vision à New-York, Grasset, 1981 et Denoël, 1983 ; Paradis, Seuil, 1981 et « Points Roman », 1994 ; Femmes, Gallimard, 1983 et Folio, 1984 ; Légendes, CAPC Musée art contemporain Bordeau, 1984 ; Portrait du joueur, Gallimard, 1984 et Folio, 1986 ; Théorie des exceptions, Folio, 1985 ; Une curieuse solitude, « Points Roman », Seuil, 1985 ; Paradis 2, Gallimard, 1986 ; Le cœur absolu, Gallimard, 1987 et Folio, 1989 ; Photos licencieuses de la Belle Époque, Éditions 1900, 1987 ; Les surprises de Fragonard, Gallimard, 1987 ; Rodin : dessins érotiques, avec alain Kirili, Gallimard, 1987 ; De Kooning, La Différence, 1988 et 1991 ; Sollers vidéo Fargier: une voix sept fois, avec Jean-Paul Fargier, Ad’hoc Xavier d’Arthuys, 1988 ; Les folies françaises, Gallimard, 1988 et Folio, 1990 ; Sade contre l’Être suprême, Quai Voltaire, 1989, 1992 et Gallimard, 1996 ; Le lys d’or, Gallimard, 1989 et 1991 ; Carnet de nuit, Plon, 1989 ; Banlieues, Denoël, 1990 ; L’affaire Kissinger, avec Maurice Girodias, La Différence, 1990 ; Drame, Gallimard, 1990 ; Improvisations, Gallimard, 1991 ; La fête à Venise, Gallimard, 1991 et Folio, 1993 ; Sade contre l’être suprême, Quai Voltaire, 1992 et Gallimard, 1996 ; Lettres de madame de Sévigné: 1626-1696, Images d’un siècle, Scala, 1992 ; Le rire de Rome, Entretiens avec Frans de Haes, Gallimard, 1992 ; Le secret, Gallimard, 1993 et 1995 ; Venise éternelle: les voyageurs photographes au siècle dernier, Lattès, 1993 ; La guerre du goût, Gallimard, 1994 ; César à Venise, Du Regard, 1995 ; Le cavalier du Louvre: Vivant Denon, Plon, 1995 et Folio, 1997 ; Le paradis de Cézanne, Gallimard, 1995 ; Baroque du Paraguay, Hoëbeke / Musée galerie de la Seita, 1995 ; Les passions de Francis Bacon, Gallimard, 1996 ; Picasso portrait, Cercle d’art, 1996 ; Amours, en collaboration, Actes Sud, 1997 ; Aragon, Le mouvement perpétuel, en collaboration, Stock, 1998 ; Casanova l’admirable, Plon, 1998 et Folio, 2000 ; L’année du tigre, Journal de l’année 1998, Seuil, 1999 et Points, 2000 ; R il de Proust, Stock, 1999 ; Nombres, Gallimard, 2000 ; Passion fixe, Gallimard, 2000 ; La divine comédie, Desclée de Brouwer, 2000 ; Éloge de l’infini, Gallimard, 2001 ; Francis Ponge, Seghers, 2001 ; L’intermédiaire, Seuil, 2001 ; Lois, Gallimard, 2001 ; Mystérieux Mozart, Plon, 2001.