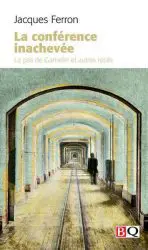Testament littéraire d’un de nos plus rares écrivains, voici quelques histoires pour les fins et pour les fous.
Jacques Ferron avait lui-même réuni la dizaine de récits réédités ici, dont certains sont déjà parus en revue, des contes d’adieu qui allaient être publiés quelques mois après son décès en 1985.
Fortement autobiographique, « Le pas de Gamelin » nous plante d’entrée de jeu à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, où Ferron a travaillé comme omnipraticien en 1970 et 1971, « haut lieu de la folie » individuelle et collective, symbole de ce pays, le nôtre, longtemps et encore dédoublé. C’est là que nous convie le docteur Ferron, en cet Olympe « où les médecins se croyaient redevenus les demi-dieux qu’ils avaient été à l’origine », et où nous croiserons une double aliénation : politique et mentale, celle-ci ayant pour prénom Mariette, Pierrette et Hélène, ou encore Louise, « hébétée par les neuroleptiques, baveuse, allongée par terre », et celle-là se parant des nobles noms de psychiatrie, administration et bureaucratie. Troublant témoignage sur la grandeur et le mystère de la folie, « Le pas de Gamelin » couvre presque la moitié du recueil. « Adacanabran » (eh oui) pousse un degré plus loin cette exploration, à sa façon : ce conte met en scène le docteur Legris, double de l’auteur, qui conte sa propre fêlure et de quelle manière il prépare « un grand livre sur la folie, Le pas de Gamelin ».
Ferron exige un lecteur disponible et bien disposé : la légèreté apparente l’humour de certains récits, la gaieté qui se dégage d’eux n’excluent jamais la richesse thématique et des interprétations qui s’ouvrent les unes sur les autres. Son écriture est poétique sans lyrisme, intelligente, cynique, pleine d’une tendresse sèche pour les déclassés et d’ironie envers les médecins et les prêtres. Dans chacun des récits, Ferron a sa manière bien propre de se bâtir une mythologie plus personnelle que locale ou universelle, faite de rumeurs et de légendes, encore que cette mythologie emprunte constamment à son propre parcours, à l’histoire du Québec, de la plus anecdotique à la plus large, et à la tradition du conte de village.
Un Ferron inactuel rejoint notre actualité. La médecine y goûte et je me ferai plaisir en citant ce passage qui en dit long sur une déconcertante facette de notre société, celle-là même qui nous saute en plein visage depuis (au moins) le printemps de 2020 : « [L]a santé, jusque-là le meilleur moyen de vivre, en devint l’unique fin, le bien suprême, le salut. […] La médecine devint religion d’État. Son culte, engloutissant la fortune publique, fut mis à la portée de tous. J’y perdais mon humble savoir-faire, décidément peu ecclésiastique. D’ailleurs, il ne s’agissait plus de guérir, mais de prévenir la maladie, de médicaliser la santé qui, cessant d’être une ingénue confiance en soi, une euphorie, un plaisir, devint une hypocondrie généralisée, une mise en accusation perpétuelle. Il fallait rendre compte qu’on n’était pas malade devant la sainte inquisition ».
« Le pas de Gamelin » et la majorité des récits du recueil valent très largement le détour ; un seul conte, « Le glas de la Quasimodo », m’a légèrement perdu. Si le Québec accordait à ses écrivains la moindre importance (je ne parle pas de Ricardo et de livres de recettes), comme celle qu’il accorde, par exemple, aux hockeyeurs et aux vedettes instantanées, Ferron serait un de nos monstres sacrés.