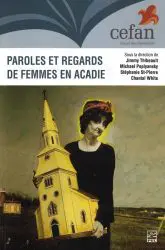La parole des femmes demeure un sujet relativement peu étudié en Acadie. D’où ce colloque universitaire organisé à l’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse), en 2015, qui a donné naissance à cette publication.Cet important ouvrage propose « des études sur l’apport des femmes aux grands questionnements de la société acadienne en faisant ressortir la richesse des paroles et des regards qui permettent une meilleure compréhension de l’Acadie », écrivent les quatre directeurs et directrices.Répartis en trois sections, les douze articles analysent « L’inscription de la femme dans le grand écrit acadien », « La perception féminine dans la parole sociale » et « L’affirmation d’un imaginaire acadien au féminin ».La première section porte sur différentes facettes de l’histoire. Phyllis E. LeBlanc fait la synthèse des travaux antérieurs et constate que les chercheurs n’ont pas « pleinement réalisé l’intégration du sujet femme à notre histoire ». Les trois autres articles répondent, du moins en partie, au constat de LeBlanc. Julien Massicotte trace le portrait de l’évolution des idéologies et des utopies en Acadie des années 1960 à aujourd’hui, Michael Poplyansky analyse la place des femmes au sein du Parti acadien (1972-1982) en insistant sur le rapport entre le féminisme et le nationalisme, et Mélanie Morin revient sur les réactions acadiennes lors de la Commission Bird sur la situation de la femme au Canada (1967-1970).Les quatre articles de la deuxième section analysent les prises de parole de quatre femmes de différentes époques dans des approches qui vont de l’analyse littéraire à la sociolinguistique, en passant par l’ethnologie. Les regards portent sur des œuvres publiées peu connues, mais très intéressantes : Clint Bruce revient sur Les veillées d’une sœur ou le destin d’un brin de mousse, publiée en 1877 à la Nouvelle-Orléans par Marie-Désirée Martin, dont il met en valeur l’acadianité féminine en « contrepoids à l’idéal de la femme véhiculé par la mythologie de la Cause perdue », celle de la guerre de Sécession. Jean-Pierre Pichette établit les divers états des contes de Laure-Irène Pothier-McNeil de Pubnico-Ouest (Nouvelle-Écosse) sans toutefois analyser ces contes. Chantal White analyse les textes de La Ruspéteuse, derrière laquelle se cache la journaliste Marie-Adèle Deveau, publiés en 1980 et 1981 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, une prise de parole savoureuse écrite en « acadjonne » qui défend en particulier l’ouverture des écoles francophones. Enfin, Isabelle LeBlanc, dont le corpus est formé de douze entrevues, traite du « double rapport idéologique à la langue et au genre d’Acadiennes ».La dernière section est consacrée à la littérature. Joëlle Papillon analyse Le grand feu de Georgette LeBlanc à la lueur du Journal de Cécile Murat d’Alphonse Deveau (1950), qui raconte ce même grand feu, soulignant d’une façon lumineuse comment LeBlanc se réapproprie poétiquement l’œuvre pour en faire une tout autre histoire. Benoit Doyon-Gosselin construit son texte autour du roman La conversation entre hommes d’Huguette Légaré (1973), un roman injustement oublié, pour le lier avec la prise de parole des premières poètes acadiennes, Diane Léger, Rose Després et Hélène Harbec. Une analyse fine qui met bien en perspective l’apport de ces quatre femmes. Dans un article qui propose un regard original, Rachel Doherty compare les « performances queers » dans La Mariecomo de Régis Brun (1974) et Chronique d’une sorcière de vent d’Antonine Maillet (1999). Enfin, Jimmy Thibeault réfléchit à l’inscription de l’œuvre de France Daigle dans le récit universel.La réflexion des différents auteurs, tous professeurs à une exception près, enrichit la connaissance qu’on a de l’apport des femmes acadiennes dans la société. Par contre, ces articles sont pour la plupart centrés sur des œuvres littéraires ou paralittéraires ou encore sur des survols historiques. On ne peut que souhaiter que d’autres travaux viennent enrichir notre connaissance de l’évolution des rôles et de la dynamique du féminisme.
PAROLES ET REGARDS DE FEMMES EN ACADIE
- Presses de l’Université Laval,
- 2020,
- Québec
341 pages
35 $
sous la direction de : 1
Loading...
Loading...

ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...