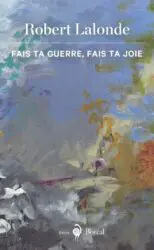D’emblée, le titre surprend par l’injonction, l’appel à la combativité, indissociable ici du ravissement que l’on ressent lorsque l’on parvient, contre vents et marées, à maintenir le cap, à relancer la quête qui nous porte et nous désespère tout à la fois, et à laquelle on ne peut se soustraire. Hymne à la création, à la persévérance, tout autant que méditation sur les motivations qui tenaillent le créateur, Fais ta guerre, fais ta joie, c’est aussi ce regard croisé sur l’écriture et la peinture, cette tentation réciproque d’envier parfois les outils de l’autre qu’il paraît manier mieux que les nôtres. Robert Lalonde n’en est pas à ses premières incursions en ce domaine ; il s’y aventure cette fois en rendant hommage à son père, figure maintes fois évoquée dans son œuvre, à la dérobée, le plus souvent effacée, mais qui ici détermine d’entrée de jeu le point de vue narratif pour témoigner du respect et de l’amour du fils.
« Vous vous souvenez très exactement de quelle manière il s’y prenait. » Ainsi débute la remontée temporelle des souvenirs au sujet de ce père, jamais nommé mais omniprésent, qui va et vient avec ses pinceaux et ses toiles, hanté par le désir de saisir la beauté du monde. Diplômé des beaux-arts, camarade de Riopelle de qui il dira que c’était un enjôleur qui avait le feu au cul, il terminera ses études avec une mention honorable avant de tourner le dos à une carrière d’artiste qui ne lui dit rien dans le contexte qui prévaut alors au milieu des années 1940, lui qui « n’entendait rien aux ‘projections libérantes’ de Borduas, moins encore à cette place qu’à tout prix il fallait faire à ‘la magie des mystères objectifs’ que prônait Refus global ». La flamme de créer, le désir de capter la beauté d’une aube, le mystère de la lumière au lever du jour, ne cessera pour autant de couver en lui sous le regard admiratif du fils qui l’épie à distance lorsqu’il tend ses toiles dans le hangar où il se réfugie pour peindre, le dimanche, après s’être acquitté de ses obligations de barbouilleur-lettreur pour commerçants en gros et détail, comme il se définit lui-même, afin de faire vivre sa famille. Peu importe la manière dont on s’y prend, il faut pouvoir maintenir avec acharnement la flamme vivante en soi, sans autre but que la joie qu’elle nous procure par moments. « Tout grand artiste, écrit Lalonde, ne demande ni à triompher, ni à s’enrichir, ni même à vivre mieux : il demande à continuer, un point c’est tout. »
Encouragement à poursuivre, à persévérer en dépit de tous les revers qui donnent prise au doute, voire au découragement parfois. Lalonde évoque ici le parcours de plusieurs artistes peintres et écrivains, certains vivants et d’autres morts, dont Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Monet, Zola, Fortin, Villeneuve, Suzor-Côté, qui tous, à un moment ou à un autre de leur vie, ont dû affronter le doute. Fais ta guerre, fais ta joie, c’est aussi la somme des souvenirs que garde précieusement en mémoire le fils, admiratif. Les années passant, une complicité se développe entre le père et le fils, le premier apprenant au second à voir, à s’ouvrir au monde qui l’entoure, et bientôt le fils cherchera à son tour à épater le père, à égaler son talent en recopiant dans ses cahiers d’écolier des passages de Giono. La supercherie avouée ne provoquera pas l’ire du père, mais un rire franc et tout aussi complice de l’imposture mise à nu. Pour toute réprimande, il lui demandera de lui relire le passage qui parle d’un hêtre qui danse avant de dire : « Le type peint avec des mots ce que moi j’ai tenté de colorier sur la toile. Un jour tu pourras en faire autant… Patience et tu verras… »
Au même titre que C’est le cœur qui meurt en dernier, livre hommage à la mère, le récit que nous livre Robert Lalonde tient ici du legs dû au père pour la persévérance dont il sait faire preuve lorsque le doute, la fatigue, voire l’envie d’abdiquer prend toute la place certains jours. Il revoit alors son père, allongé à ses côtés, qui lui rappelle qu’« y a jamais eu de tableau réussi. Ça n’existe pas, un tableau réussi. Ça n’existe pas, une vie réussie. Ce qui existe, c’est la lutte. Ce qui existe, c’est l’acharnement. Ce qui existe, c’est l’entêtement. Répète après moi ! » Il faut croire que la leçon a porté fruit.