Né à Westmount en 1954 au sein de la famille O’Brien, vaste tribu sous l’autorité d’un richissime patriarche, Peter Behrens a été élevé par une mère irlandaise et un père allemand, tout comme Hermann « Billy » Lange, le protagoniste et narrateur des Insouciants1.
Dès son enfance, le Montréalais a été séduit par l’appel des horizons lointains et a souhaité ardemment devenir écrivain. Émule de Jack Kérouac, comme lui il voulait prendre la route et vivre de sa plume. C’est d’ailleurs ce qu’il fera, après avoir fréquenté le Lower Canada College, étudié à l’Université Concordia et obtenu un baccalauréat en relations internationales à l’Université McGill. Il bourlinguera à son goût, au Canada et aux États-Unis, publiera des nouvelles, entre autres dans The Atlantic, anciennement The Atlantic Monthly, et écrira des scénarios pour Hollywood.
La cinquantaine venue, Peter Behrens s’établit dans le Maine avec sa famille et publie son premier roman, La loi des rêves, Prix du Gouverneur général 2006. Suivra en 2011 Les O’Brien, fortement inspiré de son clan maternel et bien reçu par la critique. En 2016, il base son troisième roman, Les insouciants, finaliste au prix National Jewish Book, sur la vie des Behrens en Allemagne et sur l’arrivée de son père à Montréal en 1938. Fuyant le nazisme, celui-ci avait quitté Francfort par le dernier train en destination de Rotterdam, avant que n’éclate la Deuxième Guerre mondiale.
L’appache Winnetou ou l’appel du Far West
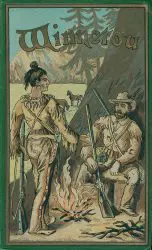 Ayant grandi au sein d’un rassemblement familial dominé par le patriarche John Joseph O’Brien et composé d’une vingtaine de cousins et cousines, vivant les uns à côté des autres et peut-être un peu les uns sur les autres, Peter Behrens a rapidement manqué d’air et d’espace. Son besoin impérieux de s’évader et de partir à l’aventure, il l’imprime à son personnage principal Hermann « Billy » Lange, lequel passera sa jeunesse le nez dans les livres d’aventures de l’écrivain allemand Karl May (1842-1912), rêvant du Far West, des Indiens et des grandes plaines nord-américaines.
Ayant grandi au sein d’un rassemblement familial dominé par le patriarche John Joseph O’Brien et composé d’une vingtaine de cousins et cousines, vivant les uns à côté des autres et peut-être un peu les uns sur les autres, Peter Behrens a rapidement manqué d’air et d’espace. Son besoin impérieux de s’évader et de partir à l’aventure, il l’imprime à son personnage principal Hermann « Billy » Lange, lequel passera sa jeunesse le nez dans les livres d’aventures de l’écrivain allemand Karl May (1842-1912), rêvant du Far West, des Indiens et des grandes plaines nord-américaines.
Le jeune personnage des Insouciants s’identifiera avec enthousiasme à l’Appache Winnetou et partagera sa passion avec son amie Karin, son amour et plus tard sa femme, fille unique des von Weinbrenner, de riches Juifs allemands protecteurs des Lange. À la naissance de Billy en 1909, sa famille habitait la villa d’été des Weinbrenner, sise dans l’île de Wight, en Angleterre.
Pendant une trentaine d’années, Billy et Karin planifient leur fuite vers la Llano Estacado, la terre sacrée des Apaches mescaleros, une région située au sud-ouest des États-Unis, à cheval entre le Nouveau-Mexique et le Texas, un « pays d’ours et de coyotes, de charognards ». La Llano Estacado est leur phare dans la nuit, leur planche de salut. Leur Eldorado.
Lorsque la Deuxième Guerre deviendra inéluctable, lorsqu’ils connaîtront des temps d’orages et d’horreurs, les jeunes gens auront la volonté de quitter Francfort, où ils seront à ce moment-là, tant sera fort leur désir d’aller explorer ces grands espaces de liberté.
Fait troublant, ce sont les mêmes histoires de Winnetou que Hitler avait fait envoyer aux soldats sur le front de l’Est, à ces troupes qui participeront à la folie expansionniste du Führer avant d’aller se faire anéantir en Russie.
L’Angleterre, la prison, puis l’exil
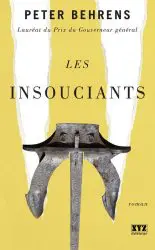 Dans Les insouciants, la fiction rejoint souvent la réalité, telle que l’a voulue l’écrivain et telle qu’il l’a écrite. La vie imaginée des uns s’inspire fortement des expériences des autres. Ainsi, le père du personnage de Billy et le grand-père de l’auteur Peter Behrens ont des points en commun, dont celui d’être des Allemands mariés à des Anglo-Irlandaises et d’habiter l’Angleterre en 1914, à la déclaration de la Première Guerre mondiale. Même si tous deux résidaient depuis longtemps en Grande-Bretagne, ils ont pourtant été considérés comme des espions et emprisonnés pendant plus de quatre ans.
Dans Les insouciants, la fiction rejoint souvent la réalité, telle que l’a voulue l’écrivain et telle qu’il l’a écrite. La vie imaginée des uns s’inspire fortement des expériences des autres. Ainsi, le père du personnage de Billy et le grand-père de l’auteur Peter Behrens ont des points en commun, dont celui d’être des Allemands mariés à des Anglo-Irlandaises et d’habiter l’Angleterre en 1914, à la déclaration de la Première Guerre mondiale. Même si tous deux résidaient depuis longtemps en Grande-Bretagne, ils ont pourtant été considérés comme des espions et emprisonnés pendant plus de quatre ans.
Le jeune Billy et sa mère acceptent mal l’absence du père et pendant que Heinrich « Buck » Lange croupit en prison, ils s’installent à Londres pour être plus près de lui. « Me manquaient les mains de Buck, la force de ses bras, le timbre de sa voix. » Lorsqu’ils comprennent que leurs courtes visites et leurs souffrances sont trop lourdes à supporter pour le prisonnier, mère et fils se réfugient auprès de leurs familles irlandaises à Sligo, sur la côte nord-ouest de l’Irlande. Ils vivent tout d’abord chez le grand-père maternel de Billy et après un bref séjour raté, chez sa grand-mère paternelle, qui ira d’ailleurs les rejoindre en Allemagne après la guerre.
Habitant ainsi chez l’un puis chez l’autre aïeul, Billy aura l’occasion de mieux comprendre l’héritage irlandais qu’il porte en lui, de connaître les us et coutumes du pays et de côtoyer le climat d’ébullition politique, Anglais contre Irlandais, conservateurs contre indépendantistes. Son grand-père verra juste : « Il y aura une élection. Le Sinn Fein se battra pour obtenir un maximum de sièges et ce sera la naissance d’une nouvelle Irlande ».
Après la guerre, en 1919, Billy et sa famille seront rapatriés en Allemagne. Non seulement ils s’étaient tous sentis trahis par leur patrie d’adoption, mais leur arrivée sera difficile dans ce nouveau pays, leur véritable pays en fait, mais qu’ils ne connaissent pas. « Comment allait-il gagner sa vie ? » pense Buck. De plus, « l’Allemagne, dont il avait eu un aperçu entre la gare et le portail de Walden, ressemblait à une terre ravagée ».
Sur le chemin de l’exil, les Lange perdront aux mains de soldats français les quelques biens précieux qu’ils avaient réussi à sauvegarder. « Un étui à argenterie, un collier hérité de sa famille et une broche que Constance lui avait offerte avaient disparu. […] Il n’y avait aucun recours possible. Mes parents s’étaient résignés à ce genre de mésaventure. C’était notre lot de réfugiés, un point c’est tout. »
L’Allemagne en 1938
La saga des Insouciants se déroule sur une centaine d’années et dans plusieurs pays. Elle commence avec la naissance de Heinrich Buck Lange en 1884 et se termine en 1988 avec le dépôt des papiers familiaux, dits les « archives Lange », à la bibliothèque de l’Université McGill. Peter Behrens fait ainsi un clin d’œil à son alma mater, tout en respectant le désir du personnage de Billy, qui avait demandé à son fils « de conserver ces pages pendant vingt-cinq ans, ensuite qu’il fasse ce qu’il veut avec ».
La structure du roman est complexe, faite de multiples allers-retours dans le temps, ce qui peut déranger le lecteur qui ne s’y retrouve pas toujours facilement. L’année 1938 occupe une bonne moitié de la trentaine de chapitres et des quelque 600 pages du livre. Elle est au cœur de l’intrigue. C’est à cette époque-là que le destin parle, en séparant ou en unissant davantage les personnages du roman. Hitler décrète alors l’Anschluss – l’annexion de l’Autriche – et il fera bien pire encore. « Qui pouvait imaginer des camps d’extermination ? Des milliers de bombardements aériens ? Pas moi. Pas Buffalo Billy. »
En 1938, Karin vit à Berlin et travaille dans des studios de cinéma, pendant qu’à Francfort, Billy est employé comme traducteur dans une usine chimique de triste mémoire, démantelée en 1952. Il faut savoir qu’à Auschwitz, « le Zyclon-B, le gaz qui [servait] à se débarrasser des ‘esclaves improductifs’ […] était, à l’origine, un pesticide fabriqué par IG Farben ».
Après la nuit des Longs Couteaux, l’adoption des lois de Nuremberg et la montée de l’hitlérisme, les interdits et les tourments s’abattent sur la population juive et le baron Hermann von Weinbrenner n’est pas épargné. Il sera dépossédé de tout, humilié, privé de son travail, chassé de chez lui, battu avec violence. « De quel droit le vieux Juif posséderait-il des œuvres d’art inestimables faites pour pratiquer la foi chrétienne ? » Il en mourra, miséricordieusement délivré de ses souffrances par ceux qu’il aimait tant, Karin et Billy. Pour eux arrive le moment de rédemption qu’ils attendaient depuis longtemps, en partant enfin aux États-Unis, à la Llano Estacado.
Explorer et comprendre le monde
Peter Behrens a déjà dit qu’il ne voulait pas enseigner l’histoire, mais que le roman Les insouciants était une œuvre sur l’appartenance et l’identité, et que le récit servait plutôt à explorer le monde et à le comprendre. L’habileté de l’auteur à saisir les enjeux du XXe siècle lui aura permis de créer de magnifiques personnages fort plausibles, dotés de mille facettes réalistes.
L’écrivain travaille déjà sur son prochain roman, le premier dont l’action se situera à Montréal. Il y a longtemps que Behrens a quitté le Québec. Voudra-t-il parler de la ville qu’il a laissée derrière lui dans les années 1970 ou plutôt de la métropole économique d’aujourd’hui, multiethnique et multiculturelle, où se côtoient de multiples entreprises à la fine pointe de la technologie – cinéma, multimédia, 3D ou virtualité –, voisinant la pauvreté des laissés-pour-compte ? Ce sera à découvrir, sans pour autant oublier qu’il n’existe pas « de pays des rêves ailleurs que dans nos rêves ».
1 .Peter Behrens, Les insouciants, trad. de l’anglais par Isabelle Chapman, XYZ, Montréal, 2017, 601 p. ; 32,95 $.
EXTRAITS
Ce qui est extraordinaire, avec el llano, Billy, m’avait-elle dit un matin à Charlottenburg, c’est que c’est le monde tel qu’on devrait le préférer. Nu, propre. Sans rien pour le polluer. Sur el llano, tu peux chevaucher pendant des jours sans rencontrer autre chose que le soleil et le vent. Si tu veux mon avis, c’est ça, le salut. Au bout de cinq ans d’Allemagne hitlérienne, l’idée de traverser ensemble el llano semblait une promesse, sinon de salut, du moins de purge. Les rayons caustiques du soleil combinés à la chaleur sèche du désert crameraient sur nos ailes le poids mort de l’histoire.
p. 296
On m’appela Hermann jusqu’à l’arrestation de mon père pour espionnage. Puis Miss Anne Hamilton suggéra à ma mère que mon prénom sonnait « trop germanique ». […] C’est Hamilton qui a commencé à m’appeler Bill, d’après Buffalo Bill. […] Et depuis, j’ai toujours été appelé Billy Lange. […]
Ma mère n’était pas une Boche, mais elle était Irlandaise, ce qui du point de vue des gens de Shanklin n’était guère plus reluisant. Et puis nous habitions une maison dont le propriétaire était un baron allemand, une maison où le Kaiser en personne avait passé une nuit. Cela suffisait à nous mettre au ban.
p. 75
Depuis la mise à sac, nous vivions tous les deux dans la crainte muette d’un retour des SA, même si on pouvait se demander ce qu’ils pouvaient convoiter maintenant, car il ne restait presque rien à Walden. Le plaisir de vandaliser, c’était peut-être un mobile suffisant. Des fantasmes de trésor hébreu enterré. Mettre le feu au bois, brûler les fantômes juifs, brûler les fantômes irlandais, brûler les fantômes de célèbres chevaux de course.
p. 547











